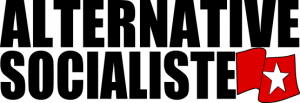Le mouvement syndical prend sa place politique au Québec au milieu des années 1960. Le taux de syndicalisation franchit le cap des 30% en 1965. Quatre ans plus tard, il atteint 39% en raison de la syndicalisation massive du secteur public et parapublic et de la syndicalisation obligatoire dans la construction.
En 1961, le Nouveau parti démocratique (NPD) nouvellement fondé au Canada à partir du CCF tente de s’étendre au Québec. La Fédération des Travailleurs et Travailleuses du Québec (FTQ) soutient ouvertement sa construction et s’y affilie, contrairement à la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Le président de la CSN, Jean Marchand, participe toutefois personnellement à la fondation du NPD-Québec. Cette association est de courte durée puisque Marchand et trois autres militants associés à la CSN (Gérard Pelletier, Pierre Elliott Trudeau et Jacques Olivier) deviennent députés pour le Parti libéral du Canada (PLC) en 1965.
L’essor du nationalisme québécois
À la fin des années 1960, l’assise sociale principale du mouvement nationaliste change. Il passe d’un nationalisme canadien-français promu par les élites traditionnelles à un nationalisme québécois de masse. De nombreux militant·e·s syndicaux épousent ce nouveau nationalisme lié aux idées progressistes et à la gauche étatiste. La CSN appuie la plupart des réformes du Parti libéral de Jean Lesage, époque au cours de laquelle le gouvernement québécois devient le lieu privilégié du changement social.
L’option fédéraliste défendue par la direction de la FTQ dans le NPD-Québec naissant divise ses militant·e·s. Cette situation débouche par la formation de deux partis en 1963 : le NPD-Québec et le Parti socialiste du Québec (PSQ), uniquement actif sur la scène provinciale. Sans liens organiques avec les organisations syndicales, le PSQ – dirigé notamment par le syndicaliste Michel Chartrand – est faible et divisé. Il disparaît deux ans plus tard.
Aux élections provinciales de 1966, le mouvement nationaliste québécois émerge comme nouvelle force politique avec le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) et le Ralliement national (RN). Le NPD-Québec voit ses appuis fondre aux élections fédérales de 1968 à mesure que le nationalisme québécois croit. La FTQ retire son appui au NPD en 1971. La centrale continue toutefois de suggérer à ses membres de voter pour les candidat·e·s NPD aux élections fédérales jusqu’en 1993.
La question linguistique
À la fin des années 60, de larges couches de la jeunesse et de la classe ouvrière constatent que le français est menacé à Montréal. Le centre intellectuel, culturel, financier, commercial et industriel du Québec compte une proportion anglophone-francophone de 40%-60%. Cette proportion est plutôt à 5%-95% hors de Montréal. Le transfert linguistique vers l’anglais, en particulier chez les personnes issues de l’immigration, joue un rôle central dans la stratégie d’assimilation des élites anglo-canadiennes. Les travailleurs et les travailleuses francophones se font demander de « Speak white » par leurs patrons anglophones. L’anglais est la langue de travail ainsi que celle de l’affichage commercial. De 1967 à 1973, la revendication de l’indépendance politique du Québec sert d’élément central et unificateur pour toutes les forces progressistes du Québec. Cette revendication constitue la toile de fond de nombreux rassemblements de masse.
Vers la création d’un parti des travailleurs : les CAP
À la fin des années 60, le retour de l’Union nationale au pouvoir à Québec et la radicalisation du mouvement syndical remettent à l’ordre du jour la création d’un parti politique de masse dévoué à la défense des intérêts des travailleurs et des travailleuses.
Les nouvelles catégories de salarié·e·s provenant des secteurs public et parapublic (qui ont l’État comme employeur) contribuent à renforcer la radicalisation des pratiques syndicales. Les idées socialistes touchent les centrales syndicales et accentuent leur influence au début des années 1970.
À partir de 1967, la CSN, la FTQ et la Centrale de l’enseignement du Québec (CEQ) mettent sur pied des comités d’action politique (CAP) chargés de donner une voix politique aux salarié·e·s en dehors des partis traditionnels. Durant le printemps 1970, les centrales rassemblent les militant·e·s syndicaux et les éléments de gauche de partout au Québec lors d’une quinzaine de colloques régionaux. Ils rassemblent des milliers de personnes qui demandent un suivi du projet. Toutefois, les directions jugent la création d’une nouvelle formation politique prématurée à la lumière de l’expérience du PSQ et surtout suite à la création du Parti québécois (PQ) en 1968.
Le FRAP et Octobre 70
En 1970, l’action collective des CAP entraîne la formation d’un parti politique municipal, le Front d’action politique des salariés à Montréal (FRAP), basé sur les groupes populaires et le mouvement syndical. Confronté à l’indifférence des directions des grandes centrales, le FRAP s’appuie sur les syndicats locaux et le Conseil régional Montréal CSN. Aux élections municipales du 25 octobre 1970, le FRAP présente 32 candidat·e·s dont 17 proviennent du mouvement syndical.
Trois semaines avant les élections, le Front de libération du Québec (FLQ) enlève le diplomate britannique James R. Cross puis le ministre du Travail et de la main-d’oeuvre du Québec, Pierre Laporte. À la demande du premier ministre du Québec, Robert Bourassa, et du maire de Montréal, Jean Drapeau, le gouvernement fédéral de Pierre Elliott Trudeau invoque la loi des mesures de guerre le 16 octobre. Le prétexte d’une « insurrection appréhendée » est utilisé pour mater le mouvement nationaliste, syndical et social. Près de 500 personnes sont arrêtées sans mandat, dont deux candidats du FRAP, et plus de 2000 sont perquisitionnées.
Le FRAP est accusé d’être un paravent du FLQ après le meurtre de Laporte. Les élections ont lieu sous les mesures de guerre. Le FRAP recueille 16% des voix, un score bien en deçà des prévisions. La formation se déchire et se dissout en 1974. Le FRAP constitue l’achèvement au niveau politique du mouvement de radicalisation de couches importantes de la société québécoise durant les années 1960.
Les événements d’octobre 70 radicalisent le mouvement syndical. D’intenses luttent se mènent durant les années 70 (grève de La Presse en 1971, Front commun du secteur public de 1972 et 1976, conflit à la United Aircraft en 1974). Le gouvernement et les patrons doivent reculer et le mouvement syndical fait des gains importants. Le discours des centrales devient ouvertement anticapitaliste, notamment dans les manifestes de la FTQ, de la CSN et de la CEQ lancés au début des années 70.
Sous le gouvernement libéral de Bourassa, le mouvement syndical s’engage dans une voie de rupture avec l’État et avec les partis politiques traditionnellement au pouvoir. Le cheminement du mouvement syndical vers le parti des travailleurs et travailleuses est toutefois interrompu par l’option que représente le PQ. L’approche de la non-partisanerie – plus ou moins explicite – en faveur du PQ prend le dessus sur celle du travaillisme.
L’appui partisan et non partisan au PQ
En même temps que le discours de classe se radicalise, le mouvement syndical radicalise son approche de la question nationale. Les stratégies pour joindre la lutte pour le socialisme et celle pour l’indépendance s’affrontent. Les discussions sur la formation d’un parti politique autonome de la classe des travailleurs et travailleuses s’atténuent à mesure que le PQ est perçu par de larges couches de la population comme étant ce parti.
En 1968, le Mouvement souveraineté-association de René Lévesque – scission du Parti libéral – fusionne avec le RN conservateur pour créer le PQ. Plusieurs membres du RIN sabordé ainsi que des syndicalistes de l’ancien PSQ viennent également grossir les rangs du PQ. La nouvelle formation est beaucoup plus radicale à sa base qu’à sa direction, dominée par des technocrates de la bourgeoisie québécoise. La crise d’Octobre 70 ainsi que l’intégration dans le PQ de rescapés de l’Union nationale déplacent le rapport de force à droite. Le PQ se cristallise comme parti nationaliste bourgeois. Cela ne l’empêche pas de présenter un programme de centre gauche qui comprend une extension importante du rôle de l’État en économie et une bonification des programmes sociaux.
Le PQ représente une source de changement pour la direction de la FTQ et une large part de ses membres. En 1971, le congrès de la FTQ fait un virage à 180 degrés et prend position pour l’autodétermination du Québec, incluant le droit à la séparation. Afin de ne pas nuire au PQ, une proposition de convocation des forces progressistes au Québec est battue au congrès de 1973. La FTQ, sous l’impulsion de son président Louis Laberge, appelle ses membres à voter pour le PQ lors des élections de 1976 afin de se débarrasser des libéraux. La FTQ ferme ainsi le couvercle sur le projet de créer un parti des travailleurs et travailleuses.
Du côté de la CSN, des divisions internes provoquent une scission des éléments encore proches des partis libéraux en 1972. Ces derniers fondent la Centrale des syndicats démocratiques. Sous l’impulsion du président de la CSN, Marcel Pepin, le congrès propose de fonder des comités d’action populaires dans les quartiers et les comtés avec les militant·e·s de toutes les organisations syndicales et populaires. Il n’est toutefois pas question de fonder un nouveau parti ou d’en appuyer un formellement. Le projet de comité d’action n’aboutit pas. Tout comme à la FTQ, le PQ draine la volonté de changement chez les militant·e·s de la CSN. Aux élections de 1976, le mot d’ordre consiste à voter pour « le parti qui est le plus près de nos intérêts », un appui implicite au PQ.
Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) prend toutefois la question des comités populaires au sérieux. Il tente avec le Comité régional intersyndical de Montréal (CRIM) de mettre sur pied un parti municipal des travailleurs et travailleuses comme prolongement de l’action du FRAP. Après la tentative avortée du Regroupement Action-Montréal, le CRIM décide plutôt de liguer les militant·e·s du PQ et du NPD plutôt que ceux des groupes populaires. Les efforts syndicaux aboutissent au lancement du Rassemblement des citoyens de Montréal en 1974 – un parti plus modéré que le FRAP qui ne s’identifie pas aux salarié·e·s – et au Rassemblement populaire à Québec.
Le RMS
Face à cette situation, les militant·e·s du Groupe socialiste des travailleurs – organisation trotskiste fondée en 1974 – lancent le Regroupement des militants syndicaux (RMS) la même année. Pendant cinq ans, le RMS sert de forum de débats et de formation pour les militant·e·s syndicaux de la province. Il défend la nécessité de construire un parti des travailleurs et des travailleuses sur une indépendance de classe et une indépendance nationale. Lors des élections provinciales de 1976, le RMS constitue une coalition électorale avec le NPD-Québec, la « Coalition NPD-RMS », qui présente 21 candidatures. Cette dernière ne bénéficie pas de l’appui des centrales qui ont déjà donné leur appui au PQ, explicite depuis 1975 dans le cas de la FTQ, implicite pour la CSN et la CEQ.
La première élection du PQ (1976)
Le PQ est élu par surprise en 1976. Il s’agit d’une victoire du vote populaire pour un tiers parti, non pas d’un simple processus d’alternance du pouvoir entre conservateurs et libéraux. L’immense base syndicale considère le PQ comme son parti. Elle lui fait confiance en l’absence d’un authentique parti de la classe ouvrière.
L’une des principales conséquences de l’oppression nationale est la distorsion du rapport de forces social au sein de la nation québécoise. D’une part, la bourgeoisie francophone est relativement faible. En 1976, les grandes entreprises à propriété francophone représentent 16% de toutes les entreprises. La majeure partie de l’économie est entre les mains du capital anglo-canadien et américain. D’autre part, les pouvoirs de l’État québécois sont tronqués et subordonnés à ceux de l’État fédéral avec qui les bourgeoisies anglo-canadiennes et étrangères ont des rapports privilégiés. L’élection du PQ viendra aider à la consolidation du « Québec Inc ». En 1977, le PQ adopte la très attendue Charte de la langue française. Le français devient la langue officielle au Québec, dans les structures de l’État comme sur les milieux de travail.
Durant la période qui précède la victoire du PQ, les centrales syndicales réorientent leur action politique vers le lieu de travail plutôt que vers l’État directement. Sous le gouvernement péquiste, la non-partisanerie syndicale renforce ses mécanismes de contact et de concertation avec les appareils d’État. En 1976, les centrales participent au premier sommet économique et social organisé par le PQ. Cette intégration des syndicats aux structures de l’État est dénoncée par le RMS et par plusieurs instances syndicales intermédiaires de la CSN et de la CEQ.
En 1977, le PQ adopte la Loi 2 sur le financement des partis politiques. Elle interdit le financement par les organisations syndicales d’un parti qu’elles décideraient d’impulser. Dénoncée par le RMS, cette loi vient poser un clou de plus sur le cercueil du parti des travailleurs et travailleuses.
Le référendum de 1980
Le PQ tarde à organiser un premier référendum. Il n’est pas exclu qu’un référendum sur l’indépendance du Québec eût été victorieux en 1977 compte tenu du niveau de conscience politique chez de larges couches de la population. Toutefois, un tel scénario aurait fait glisser le contrôle du mouvement nationaliste des mains du PQ vers celles du mouvement syndical et social.
Le gouvernement fédéral est très conscient de la menace « séparatiste ». La commission d’enquête MacKenzie l’identifie comme l’une des deux menaces à la « sécurité nationale » à côté du « communisme international ». Dès 1968, les services secrets fédéraux, aidés par la Sûreté du Québec et les services policiers municipaux, surveillent particulièrement les activités du PQ, du FRAP, de la CSN et de l’Agence de presse libre du Québec.
Le gouvernement Lévesque tient finalement un référendum en 1980 où il ajoute une étape avant l’accession à la souveraineté. La question référendaire vise à d’abord aller chercher un mandat de négocier une entente avec l’État fédéral en vue d’un deuxième référendum où le résultat des négociations serait ratifié. Le camp du OUI est défait à 40%. Il représente 50% du vote francophone où sont clairement représentés une majorité de jeunes, de scolarisé·e·s et de syndiqué·e·s.
Malgré la déception, le PQ est réélu en 1981 avec l’appui partisan de la FTQ et l’appui implicite de la CSN et de la CEQ. Ces dernières appellent à éviter l’élection du PLQ. Suite à l’échec référendaire et au rapatriement de la constitution sans l’accord du Québec en 1982, René Lévesque impose la négociation d’un fédéralisme renouvelé avec Ottawa. La déception face à l’échec de la stratégie constitutionnelle péquiste pousse les centrales à signer une déclaration qui propose plutôt l’élaboration et l’adoption d’une constitution du peuple québécois.
L’avènement du néolibéralisme
Le début des années 1980 est marqué par les effets de la récession mondiale et l’implantation des premières mesures néolibérales au Québec. Après un pic du taux de syndicalisation à 42% entre 1971 et 1974, il tombe à 35% au début des années 80. Plus du 2/3 des syndiqué·e·s appartiennent au secteur tertiaire, dont une large part provient des services publics. L’ampleur du phénomène des salarié·e·s publics face à un État employeur tend à politiser les conflits de travail.
En 1982-83, le PQ de René Lévesque et Jacques Parizeau s’attaque au secteur le plus militant de la classe ouvrière, le secteur public et parapublic, composé majoritairement de femmes. Il adopte des lois spéciales qui décrètent un recul des conditions de travail et d’autres lois très répressives qui menacent le droit de grève. Les directions syndicales, qui appellent à une grève générale le 9 janvier 1983, reculent sous les menaces de représailles draconiennes et du risque d’une élection précipitée où seul le parti libéral sortirait gagnant.
Autant au niveau constitutionnel que politique, le PQ est discrédité. Il perd son hégémonie sur l’activité syndicale et populaire. Son nombre de membres passe de 300 000 en 1981 à moins de 80 000 quatre ans plus tard. Les questions sur les formes d’action politique du mouvement syndical resurgissent. Les directions syndicales refusent toutefois de donner leur appui à la construction du Mouvement socialiste – lancé par des syndicalistes et des universitaires notoires en 1981 – même si le parti assure aux directions syndicales qu’il n’interviendra pas dans « leur » mouvement.
La banqueroute de l’appui au PQ
L’unique stratégie d’action politique développée par les centrales syndicales au provincial, la partisanerie explicite ou implicite avec le PQ, est soumise à de fortes tensions. La récession couplée à la défaite du mouvement national puis à celle du mouvement syndical crée un reflux de l’ensemble des mouvements sociaux. Les plus fortes organisations de gauche, en particulier les groupes maoïstes, disparaissent du jour au lendemain. De nombreux militants et militantes réorientent leur intervention dans des activités non partisanes : mouvement des femmes, mouvement écologiste, action communautaire, etc.
Les directions syndicales s’accommodent de plus en plus au capitalisme, par exemple avec la création du Fonds de solidarité de la FTQ en 1983. Elles se concertent aussi davantage avec l’État, notamment pour geler les salaires en 1980 lors du Forum pour l’emploi. En 1985, les libéraux portés au pouvoir inaugurent un régime de négociation factice dans le secteur public et parapublic avec l’adoption des lois répressives 111 et 160. Ces lois réduisent les matières pouvant faire l’objet de négociations et pouvant être sujettes à l’exercice de moyens de pression. Elles bouleversent le rapport de force du mouvement syndical ainsi que celui des rapports de classes au Québec.
Le congrès de la FTQ refuse d’appuyer le PQ en 1985, malgré la recommandation de la direction. Toutefois, la FTQ appuie de nouveau le PQ aux élections de 1989, qui reportent les libéraux à l’Assemblée nationale.
Malgré la démonstration de l’insuffisance de l’appui partisan et non partisan au PQ, le mouvement syndical en général, et les acteurs de la gauche en particulier, rompent avec l’approche de classe de type travailliste qui a animé les efforts pour la construction d’un parti des travailleurs et des travailleuses les décennies précédentes. Le projet de société socialiste qui en découlait est également mis en veilleuse. Les différents mouvements sociaux (féministe, souverainiste, communautaire) sont alors considérés comme les nouveaux acteurs du changement social.
L’implication dans le mouvement nationaliste
Au début des années 1990, le taux de syndicalisation remonte à 40%. Une nouvelle crise économique vient ébranler l’État capitaliste québécois. Dans ce contexte, plusieurs facteurs participent à faire oublier l’approche de classe jusque-là défendue par le mouvement syndical et populaire. D’une part, la chute du bloc soviétique et la progression des discours et pratiques néolibérales sonnent le glas d’une alternative réelle au capitalisme – aussi imparfaite a-t-elle été – et de son acteur principal, la classe ouvrière. D’autre part, le nationalisme du PQ concilie les différents intérêts de classe afin de créer les « conditions gagnantes » d’un Québec souverain où tout le monde serait satisfait.
À la fin des années 80, la population d’origine britannique a toujours de plus hauts revenus et de meilleurs emplois que les personnes d’origine française, qui composent pourtant 80% de la population du Québec. Les grandes entreprises à propriété francophone représentent 40% de toutes les entreprises en 1990.
La crise d’Oka (1990)
Durant l’été 1990, la Crise d’Oka éclate à Kanesatake, une communauté mohawk en banlieue de Montréal. Les Mohawks résistent aux projets d’expansion de domiciles et d’un terrain de golf sur une pinède située sur un ancien cimetière. Inspirés par l’American Indian Movement, les Warriors des trois nations mohawks se positionnent en confrontation directe avec la Sûreté du Québec et l’armée canadienne pendant plus de 2 mois. Un policier est tué durant des échanges de tirs.
Le mouvement ouvrier et le mouvement indépendantiste sont dépourvus face à cette crise. Rares sont les progressistes qui soutiennent le groupe de Solidarité avec les autochtones. Ce dernier est notamment animé par François Saillant et bénéficie de l’appui du syndicaliste Michel Chartrand, des militantes syndicales et féministes Madeleine Parent et Léa Roback, de l’écrivain Pierre Vallières et du chanteur Richard Desjardins. Le projet de développement immobilier du maire d’Oka ne se réalise pas. Les négociations entre les Mohawks et le gouvernement fédéral échouent également à faire reconnaître cette partie du territoire à Kanesatake.
L’impasse
La défaite référendaire de 80 mène le PQ à des négociations constitutionnelles avec le fédéral où il n’a pas de rapport de force. Le PQ laisse notamment tomber l’idée de souveraineté populaire en éliminant de son projet le processus d’élaboration d’une constitution avec une participation populaire. Les négociations aboutissent à l’Accord du lac Meech. Cet accord – qui ne répond ni aux volontés du PQ, ni aux volontés du Canada anglais, ni à celles des communautés autochtones – est rejeté en 1990, le Manitoba et Terre-Neuve ne ratifiant pas l’accord. Près de 500 000 personnes fêtent ce rejet dans les rues de Montréal. Robert Bourrassa, alors premier ministre du Québec (PLQ) déclare que « quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse, le Québec est, aujourd’hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d’assumer son destin et son développement. » Le PLQ adopte le rapport Allaire, qui demande entre autres la tenue d’un référendum portant soit sur une proposition de réforme Québec/Canada, soit sur l’accession du Québec à la souveraineté. En 1992, un autre accord défavorable au Québec, dit de Charlottetown, est encore rejeté, cette fois-ci par référendum pancanadien.
Cette impasse marque un tournant majeur pour le mouvement nationaliste. L’oppression nationale qui perdure et la question nationale toujours en suspens poussent les centrales syndicales à se prononcer définitivement et ouvertement en faveur de l’indépendance du Québec. Elles critiquent la capacité du PQ de pouvoir gérer seul la question nationale et s’organisent pour exprimer leur vision d’un Québec indépendant. La CSN investit toutes ses ressources dans la campagne référendaire contre l’Accord de Charlottetown en 1992.
Lors des élections fédérales de 1993, la FTQ délaisse pour la première fois son appui au NPD. Ce dernier a expulsé sa section québécoise trois ans plus tôt pour son appui à l’indépendance du Québec. La FTQ appelle désormais ses membres à voter pour le Bloc québécois (BQ), fondé en 1991. Ce parti s’impose aux élections de 1993. La CSN appelle un appui implicite au BQ. Plusieurs têtes d’affiche de la CSN passent en politique aux côtés du BQ.
Le référendum de 1995
Le PQ reprend le pouvoir de justesse en 1994. Au début de l’année suivante, les centrales syndicales et une douzaine d’organisations mettent sur pied la coalition Partenaires pour la souveraineté qui tente de donner un contenu progressiste au projet d’indépendance. Elles posent la souveraineté comme un rempart aux politiques de droite qui sévissent ailleurs au Canada.
Le PQ de Jacques Parizeau organise un 2e référendum en octobre 1995. Son projet néolibéral vise à rassurer l’impérialisme étatsunien. Il propose une association avec le Canada, une monnaie commune, la double citoyenneté, le soutien à l’ALENA ainsi qu’aux alliances militaires de l’OTAN et du NORAD.
Dans le camp du NON, on retrouve les chefs de grandes entreprises, les chambres de commerce, le conseil du patronat et les banques. Le camp du OUI regroupe le mouvement syndical, le mouvement féministe, les groupes populaires et la majorité des intellectuel·le·s et des artistes. Le discours progressiste du camp du OUI n’est toutefois pas accompagné de mobilisations populaires ni d’engagements concrets.
Le référendum, qui connaît le taux de participation le plus élevé jamais enregistré au Québec (94%), se conclut par la défaite du OUI avec 49,42 % des voix. Les résultats reflètent une polarisation linguistique. Les non-francophones votent systématiquement contre la souveraineté, tandis que le OUI remporte la majorité chez les francophones dans 108 circonscriptions sur 125. Une division de classe s’observe aussi dans le vote francophone. Les zones les plus pauvres du Québec présentent les plus forts taux d’appuis au OUI, généralement supérieurs à 60% et parfois à 70%. Inversement, les quartiers les plus cossus présentent les taux les plus bas.
L’accélération des politiques néolibérales
Après la défaite référendaire, l’arrivée de Lucien Bouchard accentue le tournant néolibéral du gouvernement péquiste. En 1996, le gouvernement du PQ organise deux sommets économiques pour « assainir » les finances publiques qui sont dans un « état désastreux ». Un consensus est établi avec les directions syndicales et étudiantes sur l’atteinte du déficit zéro en quatre ans et l’adaptation aux contraintes de la globalisation.
Le PQ entame un démantèlement de l’État social qui vise en particulier le système de santé, d’éducation ainsi qu’Hydro-Québec. La base syndicale des différentes centrales se met à critiquer le programme auquel leur direction a souscrit.
Lors des élections fédérales de 1997 et de 2000, la FTQ refuse de donner officiellement son appui au BQ. Elle l’appuie toutefois dans les faits. Pour plusieurs affiliés du secteur public, Bloc québécois rime encore avec les coupures de Lucien Bouchard.
En 1998, la CSQ et la CSN quittent la coalition Partenaires pour la souveraineté afin de protester contre les mesures néolibérales du PQ. Quant à elle, la FTQ s’abstient de donner son appui au PQ lors des élections de 1998 et de 2003. La démission de Lucien Bouchard et son remplacement par Bernard Landry en 2001 conduit à une politique de plus en plus néolibérale.
La recomposition de la gauche
Durant les années 2000, les traités de libre-échange favorisent les délocalisations et modifient le marché du travail. Le mouvement syndical s’implique dans la création de larges coalitions, notamment La Marche mondiale des femmes (2000), le Sommet des peuples des Amériques à Québec (2001) et le Forum social mondial de Porto Alegre (2001). Les forces de gauche profitent de la défaite électorale du PQ pour réarticuler la lutte pour l’indépendance nationale et l’indépendance de classe.
Au terme de quelques années de négociations, la gauche québécoise se recompose et donne naissance à l’Union des forces progressistes (UFP) en 2003. Il s’agit d’une fusion entre le Parti de la démocratie socialiste (ancien NPD-Québec), le Rassemblement pour une alternative politique et le Parti communiste du Québec. La candidature unitaire de Paul Cliche lors des élections partielles de Mercier en 2001 recueille notamment l’appui du CCMM-CSN et celui du Syndicat des cols bleus de Montréal. En réaction à la création de ce nouveau parti politique indépendantiste, une centaine de militant·e·s nationalistes fondent le club politique Syndicalistes et progressistes pour un Québec libre (SPQ-Libre) en 2004. L’objectif est de développer un courant de gauche à l’intérieur du PQ.
La ruine du SPQ-Libre
Plusieurs figures de proue du syndicalisme se joignent au SPQ-Libre, comme Marc Laviolette (ex-CSN) et Monique Richard (ex-CSQ). Malgré l’élection de certaines personnes à des postes clés au sein du PQ, la stratégie du SPQ-Libre le condamne à la marginalité. Il est répudié du PQ en 2010 par Pauline Marois en raison de ses fréquentes sorties publiques contre les orientations du parti. Ses militant·e·s demeurent toutefois au PQ. En 2014, la compromission de classe du club éclate au grand jour avec l’arrivée du candidat péquiste Pierre-Karl Péladeau, un magnat de la presse qui détient le record du nombre de lock-out au Québec. Le président du SPQ-Libre, Laviolette, applaudit l’arrivée du nationaliste Péladeau qui se hissera au poste de chef du PQ l’année suivante.
En 2003, les libéraux reviennent au pouvoir après neuf ans d’absence. Les coupures et les privatisations dans le secteur public et parapublic continuent. L’ampleur et la combativité des mobilisations entourant le Front commun 2003-2005 sont inégalées depuis des décennies. Les négociations se soldent toutefois par un décret du gouvernement qui fixe les conditions de travail, impose une réorganisation des services de santé et modifie les accréditations syndicales, ce qui fragmente le mouvement. Des mobilisations de masse forcent le gouvernement de Jean Charest à reculer lorsqu’il tente de hausser les frais des services de garde des centres de la petite enfance ainsi que ceux des étudiant·e·s post-secondaires.
Un grand colloque international de réflexion sur le renouveau syndical se tient en 2004 à Montréal. La réflexion sur l’action politique du mouvement syndical y est marginale et les discours prônent le statu quo.
Au palier fédéral, la FTQ ne donne son appui à aucun parti lors des élections de 2004. Le PLC remporte les élections avec Paul Martin à sa tête. Les politiques néolibérales accélèrent : coupures massives dans les transferts aux provinces en santé et en éducation, alignement sur les États-Unis dans le cadre de l’ALENA. Le scandale des commandites éclate. Le PLC a investi illégalement 332 M$ des fonds publics pour promouvoir l’unité canadienne suite au référendum de 1995. Le camp du NON a aussi dépassé son budget durant la période référendaire, puisant un budget excédentaire dans les poches du fédéral et de certains particuliers. L’appui à l’indépendance dépasse alors les 50%.
La création de Québec solidaire (2006)
En 2006, l’UFP fusionne avec Option citoyenne – un regroupement issu du milieu communautaire – pour former un nouveau parti large de gauche: Québec solidaire (QS). Le CCMM-CSN s’implique dans la création du nouveau parti de gauche. QS se base sur les valeurs que sont l’écologie, la gauche, la démocratie, le féminisme, l’altermondialisme, le pluralisme, la souveraineté et la solidarité.
Aux élections provinciales de 2007, certains syndicats locaux (Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP-FTQ)) et régionaux (Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (CRMM)) appuient des candidatures solidaires. La FTQ, par la voix de son président Henri Massé, donne toutefois son « appui indéfectible » au PQ d’André Boisclair. Quant à elle, la CSN recommande à ses membres de ne pas voter pour l’Action démocratique du Québec (ADQ).
Vote de mécontentement et « vote stratégique »
Par manque d’alternative politique de classe, le mécontentement populaire s’exprime progressivement à travers le vote pour des alternatives de droite populistes. L’arrivée de l’ADQ au milieu des années 90 offre une nouvelle voie politique pour exprimer le ressentiment populaire contre les pratiques déficientes des institutions politiques, économiques et sociales. De moins en moins clair sur la question de l’indépendance du Québec, ce parti populiste de droite mise sur un nationalisme conservateur de plus en plus identitaire. Propulsée par un scandale monté de toute pièce visant les communautés juives et musulmanes – celui des accommodements raisonnables – l’ADQ devient pour la première fois l’opposition officielle à l’Assemblée nationale lors des élections générales de 2007. Les élections de l’année suivante lui font perdre ce statut. L’ADQ renoue ensuite avec son score habituel sous les 20%.
En 2012, les mouvements de masse contre la hausse des frais de scolarité contraignent le gouvernement Charest à déclencher des élections anticipées à la fin de l’été. Le PQ de Pauline Marois est perçu comme la seule alternative valable pour sortir de la crise politique engendrée par l’intransigeance du PLQ. Or, la Coalition Avenir Québec (CAQ, refonte de l’ADQ) voit son score presque doubler et talonne le PLQ dans l’opposition officielle (27% vs 31%). Le populisme de droite de la CAQ lui permet de canaliser une bonne partie de la grogne de la classe travailleuse contre la dégradation de ses conditions de vie.
QS ne recueille que 6% des voix et deux député·e·s, malgré le fait qu’il soit le seul parti – avec Option nationale – à promouvoir la gratuité scolaire, revendication du mouvement étudiant.
Aux élections provinciales de 2008, 2012 et 2014, la FTQ retire son appui traditionnel au PQ et n’en donne à aucun parti. La centrale demande à ses troupes de juger chaque candidature selon ses engagements par rapport aux demandes de la FTQ. Si cette approche semble appuyer en principe les candidatures protravailleuses, il n’en est rien. Dans les faits, la FTQ continue d’appuyer les candidatures du PQ, seules alternatives crédibles aux libéraux ou aux candidatures de la CAQ. La FTQ en vient à épouser la même stratégie d’action politique que la CSN, c’est-à-dire la non-partisanerie qu’on renomme « vote utile » ou « vote stratégique ». Quant à lui, le CRMM donne son appui à trois candidatures de QS en 2012.
Lors de ces élections, la CSN invite ses membres à voter pour la candidature qui a le plus de chances de battre les libéraux ou les caquistes. Cette approche revient à appuyer implicitement le PQ de Marois. De son côté, le CCMM-CSN invite implicitement ses membres à voter pour QS dans les circonscriptions où il n’y a pas de risques de favoriser une victoire de la CAQ ou du PLQ.
Durant son court mandat, le PQ en profite pour sabrer dans les budgets des services sociaux. Espérant faire élire un gouvernement majoritaire, Marois fait tenir des élections anticipées en 2014. L’année précédente, le PQ prend un virage nationaliste identitaire avec sa proposition de Charte des « valeurs québécoises ». Ce projet xénophobe ciblant les personnes supposées musulmanes et issues de l’immigration récente participe à leur défaite. Les libéraux de Philippe Couillard sont élu·e·s avec la majorité des sièges. Durant les années suivantes, le gouvernement libéral applique une série de compressions budgétaires jamais vue depuis des décennies.
L’essor progressif de QS
Depuis sa création en 2006, QS canalise une partie croissante, mais faible, du vote anti-establishment. De 4% des voix en 2007-2008, la formation passe à 8% en 2014 et fait élire 3 député·e·s. Le soutien à QS croit notamment sur le discrédit du PQ, dont le projet nationaliste de plus en plus identitaire et les politiques néolibérales drastiques sont rejetés massivement. Le vote pour QS se concentre dans la région de Montréal, parmi les jeunes et les couches sociales les plus scolarisées. Ce vote représente celui des couches à la recherche d’alternatives politiques parmi la classe travailleuse et la classe petite-bourgeoise.
Le développement de QS, comme celui des autres formations larges de gauche au niveau international, constitue une expérimentation politique confuse et instable. QS concentre l’énergie de militant·e·s provenant de tous les mouvements sociaux, dont une partie de l’avant-garde du mouvement syndical. L’appui de syndicats locaux aux candidatures QS, bien que marginal, s’affirme de plus en plus.
QS concentre et structure un flux de personnes nouvellement conscientisées à la nécessité d’une alternative politique. En 2017, le chroniqueur et ancien porte–parole de la grève étudiante de 2012, Gabriel Nadeau-Dubois, se fait élire comme co-porte-parole et député de QS. Son arrivée fait bondir le membership du parti de près de 20%. Il monte à environ 17 000 personnes (par rapport à 80 000 au PQ, 30 000 au PLQ et 12 000 à la CAQ).
Du côté du mouvement syndical, la nouvelle vague de penseurs et penseuses du renouveau syndical ignore la question des stratégies de construction d’une alternative politique indépendante des travailleurs et des travailleuses. Pourtant, QS devient un véhicule politique de plus en plus crédible pour une couche de militant·e·s syndicaux. Néanmoins, une majorité de syndicalistes s’attachent toujours au PQ, malgré la double défaite de la candidate de gauche Martine Ouellet à la direction du parti. Elle perd une première fois contre Pierre-Karl Péladeau en 2015, et une deuxième fois en 2016 contre l’opportuniste Jean-François Lisée. Plutôt que de profiter de l’occasion pour discuter ouvertement d’une alternative politique pour les travailleurs et les travailleuses, les directions syndicales ont depuis pour seules perspectives stratégiques des vœux pieux.
Un vote fédéral très volatile
Les conservateurs de Stephen Harper remportent les élections fédérales de 2006, 2008 et 2011. D’une part, ils en profitent pour effectuer une révolution conservatrice du mode de fonctionnement de l’État fédéral. D’autre part, le gouvernement fédéral fait la promotion d’un nationalisme conservateur au Québec. Il le reconnaît notamment comme une « nation distincte », ce qui participe à la délégitimisation du BQ.
Depuis le début des années 90, le ressentiment populaire s’exprime par l’appui « stratégique » au BQ. Le supposé porteur des intérêts du Québec à Ottawa est pratiquement rayé de la carte en 2011 avec le vote massif pour le NPD de Jack Layton. La « vague orange », nouvelle expression populaire de la stratégie du « moins pire », fait passer le BQ de 49 à 4 député·e·s au Québec, tandis que le NPD passe de 1 à 59.
Bien que le NPD soit le parti travailliste anglo-canadien historiquement lié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la « vague orange » ne constitue pas un retour au vote pour un parti traditionnel de la classe travailleuse. Malgré les efforts de la FTQ durant les décennies 60, 70 et 80, le NPD n’a jamais réussi à construire une base militante massive au Québec ou à faire élire une députation représentant une tendance de la classe travailleuse québécoise. Après la mort de Layton, Thomas Mulcair – député libéral de 1994 à 2007 – prend la tête du NPD en 2012. Il opère un virage à droite dans le parti. Avec l’appui d’une forte majorité des membres, il fait notamment remplacer les références au socialisme dans la constitution du parti par un rappel « des traditions sociales-démocrates et socialistes démocratiques » du NPD.
Lors des élections de 2015, le nombre de député·e·s NPD tombe à 16 au Québec. La rhétorique plus à gauche du nouveau chef du PLC, Justin Trudeau, fils de l’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau, constitue un des facteurs de cette déconfiture. Le BQ remonte à 10 sièges et tend de plus en plus vers un nationalisme conservateur.
Durant le règne Harper, la FTQ appuie le BQ. Suite au succès sans précédent du NPD au Québec en 2011, la FTQ appuie ce parti lors des élections de 2015. Parallèlement, la FTQ tente aussi de battre les candidatures conservatrices dans une dizaine de circonscriptions au Québec en appuyant le BQ, le NPD ou le PLC.
La CSN n’appuie aucun parti lors des élections fédérales de 2006, 2008, 2011 et 2015. La centrale invite ses membres à voter pour la candidature qui a le plus de chance de battre celles du Parti conservateur, qu’elle soit issue du BQ, du NPD ou du PLC.
Le cul-de-sac du « vote stratégique »
Un constat d’échec flagrant s’impose. D’une part, la partisanerie et la non-partisanerie péquistes n’ont pas empêché le projet néolibéral de déferler sur le Québec. D’autre part, la stratégie du « vote stratégique » des 10 dernières années a été incapable ne serait-ce que de ralentir le démantèlement de l’État social hérité des années 60.
La stratégie du « moins pire » condamne ses tenants et ses tenantes à une stratégie de lobbying auprès des patrons et de leurs partis politiques. L’échec de cette stratégie pousse la classe travailleuse à tirer plusieurs conclusions. D’une part, une partie de la classe se décourage, tombe dans le cynisme ou opte pour les populistes de droite. D’autre part, une autre partie réalise la nécessité de construire un véhicule politique de gauche alternatif. Finalement, une minorité réalise la nécessité de construire un nouveau parti des travailleurs et des travailleuses.