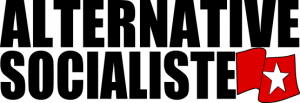Les Premières Nations de l’Amérique
Les premières populations à s’établir dans les Amériques sont des tribus nomades qui doivent constamment se déplacer pour se nourrir. Certaines populations de l’Amérique du Sud se seraient établies il y a 35 000 à 40 000 ans. Lors du débarquement des Espagnols en 1492, on estime le nombre d’autochtones dans les Amériques à 80 millions de personnes. Les découvertes archéologiques réalisées en Estrie permettent d’établir avec certitude que les Premières Nations occupent le territoire du Québec depuis au moins 12 000 ans.
Le Régime français (1534-1760)
À partir de 1534, des explorateurs français commencent la prise de possession de l’Amérique du Nord pensant trouver un passage vers la Chine. Au cours du siècle suivant, le roi de France octroie le monopole du commerce à des compagnies afin d’étendre sa puissance et organiser la colonisation. Les commerçant·e·s se servent de leurs privilèges pour exploiter les ressources naturelles du territoire aux dépens des peuples qui y vivent déjà. La Nouvelle-France est une colonie-comptoir. L’activité économique sert d’abord et avant tout à envoyer des ressources brutes à la métropole pour qu’elles soient transformées.
Les colonisateur·trice·s s’allient avec certaines nations autochtones pour le commerce de la fourrure et pour la protection de la colonie contre la nation ennemie, celle des Iroquois, alliée aux Britanniques. Les Français·e·s vont exploiter les conflits inter-nations à leur avantage afin d’établir leur domination politique, économique et culturelle sur elles.
Ces nations ont des rapports sociaux de production et d’échanges très différents des Européen·ne·s. Les Haudenosaunee, peuples aux longues maisons appelés Iroquois, pratiquent l’agriculture de manière démocratique. De leur côté, les Innus et les Cris ont une organisation plus hiérarchique liée à la chasse, la pêche et la cueillette. La division sexuelle du travail valorise le rôle et les tâches de chaque sexe. Le développement et la survie des Premières Nations sont dès lors entravés par le colonialisme. Les autochtones sont dépossédés de leurs territoires, d’abord au profit des métropoles européennes, puis dans celui des nouveaux États des Amériques.
Les guerres et les conflits entre les conquérant·e·s colonialistes, notamment français·es, anglais·es, espagnol·e·s et portugais·es, engendrent des déplacements forcés, de l’esclavage, des épidémies et des génocides chez les Premières Nations. De 80 millions à la fin du XVe siècle, leur nombre chute à 5 millions au milieu du XVIIe siècle, puis remonte à 50 millions aujourd’hui.
Au début du XVIIIe siècle, le 3/4 de la population de la Nouvelle-France fait la culture de la terre. Ces colons français – dont la plupart sont des prisonniers, des repris de justice ou des orphelines – vivent dans un état de semi-esclavage sous le pouvoir presque absolu d’un seigneur. Les seigneurs et les communautés religieuses ont aussi le droit d’avoir des esclaves autochtones ou d’origine africaine.
Le clergé catholique est très puissant en Nouvelle-France. Véritable petit État dans l’État, il est constamment en conflit avec les administrateurs (gouverneur, intendant, fonctionnaires) pour le pouvoir et la domination de la population. Ses élites travaillent à instaurer un régime théocratique.
La Conquête britannique
À son apogée, la Nouvelle-France étend son emprise commerciale et politique du golfe du Saint-Laurent au golfe du Mexique. Ce contrôle, en particulier sur les Grands Lacs, est un obstacle à l’expansion des colonies britanniques. À partir de 1754, la Grande-Bretagne, aidée par ses colonies anglo-américaines, mène la guerre de Conquête. Elle se solde par la reddition de la Nouvelle-France en 1760. Le territoire est sous occupation militaire jusqu’au dénouement de la guerre de Sept Ans en 1763.
Le nouveau pouvoir britannique impose sa domination économique, politique et culturelle et religieuse sur le peuple de la nouvelle Province de Québec. La conquête provoque la désintégration de la bourgeoisie commerçante francophone. Les petit·e·s marchand·e·s, les seigneurs et les habitant·e·s sont ruiné·e·s par la guerre. Profitant de la situation, le clergé catholique se donne le rôle de porte-parole officiel des Canadien·ne·s français·e·s auprès des conquérants. L’Empire britannique permet l’essor de l’aristocratie cléricale dont les ressources économiques sont basées sur la propriété foncière. Cette élite réactionnaire canadienne-française est inapte au développement du capitalisme qu’elle rejette.
Concessions au clergé
Les Britanniques autorisent le libre exercice de la religion dans une optique de collaboration avec l’élite religieuse. Avec l’Acte de Québec en 1774, l’Empire impose une première constitution. Elle fait des « concessions » qui maintiennent les Canadien·ne·s français·es dans les structures féodales. L’utilisation du droit civil français est autorisée, la collecte de la dîme par l’Église est réinstaurée et les catholiques peuvent désormais faire partie de l’administration de l’État sans renier leur religion.
Le pouvoir ne crée toutefois pas d’Assemblée élue telle que le réclament les marchand·e·s anglais·es de Montréal. La majeure partie de ces dernier·ère·s favorisent les Américain·ne·s et tentent de gagner les habitant·e·s à la cause de l’indépendance américaine. Toutefois, aucun ralliement populaire ne s’organise derrière les rebelles américain·ne·s. De l’autre côté, l’Empire, à travers le clergé, impose l’enrôlement des Canadiens français dans la milice pour se battre contre les Américains. Des émeutes éclatent contre les seigneurs qui pressent cet enrôlement. Les Américains envahissent la Province de Québec jusqu’à la ville de Québec en 1776, puis sont vaincus et expédiés chez eux.
L’arrivée des loyalistes
Les Américains déclarent leur indépendance en 1776, ce que l’Angleterre ne reconnaît qu’en 1783. Les sujets restés loyaux à l’Empire sont expulsé·e·s des États-Unis et arrivent en masse dans la Province de Québec. Le pouvoir britannique leur accorde un district séparé avec la tenure, l’assemblée et les lois anglaises à même le territoire de la Province de Québec.
La nouvelle constitution de l’Amérique du Nord britannique de 1791 divise le territoire de la Province de Québec en deux : le Bas-Canada – qui englobe le coeur de l’ancienne colonie de la Nouvelle-France – et le Haut-Canada (aujourd’hui l’Ontario). Les travaux de la nouvelle Assemblée du Bas-Canada se déroulent en anglais où les Anglo-canadien·ne·s sont surreprésenté·e·s. Les Canadien·ne·s français·es se retrouvent dans une position d’infériorité politique même s’ils/elles forment la majorité de la population. Malgré les efforts concertés de l’Église et des pouvoirs britanniques, un mouvement d’opposition indépendantiste influencé par la jeune république américaine et française se développe de 1793 à 1798. Les idées démocratiques radicales pénètrent les professions libérales tandis que les paysans et les paysannes sont de plus en plus mécontent·e·s envers les seigneurs.
L’essor de l’élite petite-bourgeoise canadienne-française
Durant les premières décennies du XIXe siècle, la collaboration du clergé et des seigneurs avec l’Empire leur font perdre la confiance des masses. Une nouvelle élite locale francophone ni commerçante ni possédante se développe le long du fleuve Saint-Laurent. En moins de dix ans, elle se retrouve à la tête de la coalition populaire du Parti canadien, qui deviendra le Parti patriote en 1826. Ce parti, dont Louis-Joseph Papineau est la figure prédominante, réclame principalement le « gouvernement responsable », c’est-à-dire le rapatriement du pouvoir de dépenser à l’assemblée élue.
Cette petite-bourgeoisie canadienne-française, principalement composée de professions libérales, vise à faire la révolution bourgeoise au Bas-Canada. Les luttes de l’Assemblée de 1800 à 1837 sont des tentatives de prendre le pouvoir de manière légale. Face à l’intransigeance et la répression de l’Empire, le projet patriote originellement modéré se radicalise. La tendance républicaine, indépendantiste et anti-impérialiste devient majoritaire. Le parti établit des liens avec certaines fractions révolutionnaires d’Irlandais et de colons britanniques du Haut-Canada.
Trop faibles pour contester l’empire elles-mêmes, les élites canadiennes-françaises mobilisent les classes populaires sur un programme qui propose notamment la fin des privilèges et des discriminations, l’abolition du système seigneurial, la séparation de l’Église et l’État et la fin du pouvoir colonial. Le Bas-Canada est alors peuplé d’une vaste paysannerie qui s’exode de plus en plus vers les villes où apparaît un embryon de prolétariat. La naissance de la classe ouvrière québécoise et canadienne s’opère à l’occasion de la construction des canaux de Lachine et de Beauharnois. Le prolétariat naissant est constitué presque exclusivement d’immigré·e·s irlandais·es. Une deuxième phase de prolétarisation s’opère avec la construction d’industries le long du canal Lachine dans l’ouest et dans l’est de la ville de Montréal. L’est de Montréal est composé de quartiers canadiens-français.
Les Rébellions patriotes (1837-1838)
Après avoir usé tous les leviers légaux, les patriotes tentent de prendre le pouvoir par les armes. Un mouvement de masse déferle sur le Bas-Canada en 1837 et 1838 contre l’Empire britannique et les collaborateurs du clergé. Papineau et les modérés fuient à l’étranger et affaiblissent le mouvement. D’autres patriotes réfugié·e·s aux États-Unis sont toutefois très actifs et envahissent le sud du Bas-Canada en 1838. Les soulèvements armés des patriotes du Bas-Canada – simultané avec ceux du Haut-Canada – sont violemment réprimés et défaits. Au terme du conflit, le gouverneur Colborne fait exécuter 12 patriotes qui ne figuraient pas parmi les chefs de la Rébellion.
Après l’échec des Rébellions patriotes de 1837-38, la répression militaire britannique désarme et désorganise les éléments révolutionnaires, démocrates et libéraux canadiens-français pendant plusieurs années. La classe ouvrière embryonnaire n’est quant à elle pas assez consistante et organisée pour représenter une force sociale importante. L’Empire accélère l’arrivée de colons anglais, écossais et irlandais afin de submerger et assimiler la nation canadienne-française.
Les autorités britanniques confient à l’Église catholique canadienne-française les rennes culturels et sociaux du Bas-Canada. L’Église constitue la seule institution majeure dirigée par les Canadien·ne·s français·es. Pendant les décennies suivantes, le clergé atteint le paroxysme de son pouvoir avec le soutien inébranlable des autorités anglaises puis canadiennes. La mainmise de l’Église inhibe, dans une certaine mesure, l’accumulation du capital par les Canadien·ne·s français·es et les détourne d’une carrière dans les affaires au profit d’une vocation religieuse. Une élite francophone commerciale et industrielle subalterne émerge toutefois autour de la construction du chemin de fer et de l’industrialisation.
Le Canada-Uni (1840)
Sur recommandation de Lord Durham – mobilisé pour enquêter sur le French-Canadian problem – l’Empire fusionne le Bas-Canada et le Haut-Canada avec l’Acte d’Union en 1840. Le gouvernement unique qui en résulte condamne la population francophone du Québec à un statut de minorité politique. De plus, les documents de la législature du Canada-Uni sont uniquement en anglais.
Les anciens chefs modérés des Rébellions patriotes – dont Louis-Joseph Papineau, Louis-Hippolyte La Fontaine et George-Étienne Cartier – collaborent désormais avec le nouveau pouvoir. Ils sont élus au parlement du Canada-Uni. Cartier et La Fontaine deviendront premiers ministres du Canada-Est.
Bien que les Canadiens et Canadiennes françaises constituent environ 75 % de la population du Bas-Canada, leur pouvoir politique et économique est entre les mains des Britanniques et des parvenu·e·s. La Rébellion démocratique est un échec et les terres sont des possessions anglaises. Plus d’un demi-million de Canadiens et de Canadiennes françaises émigrent aux États-Unis entre 1837 et 1910. Les Canadiens et Canadiennes françaises représentent 50% de la population du Canada-Uni en 1840. Cette proportion baisse à 30% en 1914.
En 1849, le parlement vote pour l’indemnisation des pertes subies dans le Bas-Canada lors des saccages de l’armée britannique 10 ans auparavant. De telles indemnisations ont été octroyées pour les fermier·ère·s du Haut-Canada deux ans plus tôt. Plus d’un millier d’Anglo-canadien·ne·s descendent dans les rues de Montréal, pillent et incendient le parlement ainsi que les maisons des Réformistes. Le parlement est déménagé à Toronto. Le pouvoir britannique concède le gouvernement « responsable » (et colonial) en 1853 sous la pression des réformistes anglais·es. Les droits seigneuriaux sont abolis.
L’Union permet au Haut-Canada de rattraper puis de dépasser le niveau de peuplement et de richesse du Bas-Canada. La bourgeoisie coloniale canadienne lutte désormais contre l’impérialisme anglais et le capitalisme des États-Unis. Elle décide de se doter d’un marché national en imposant une fusion des colonies britanniques. Sans consultation populaire ni référendum, la bourgeoisie canadienne impose une « constitution », l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, en 1867.
La Confédération canadienne (1867)
La majorité en faveur de la Confédération ne s’est jouée que par une seule voix. Cette constitution – qui n’inclut aucune revendication des révolutionnaires de 1837-1838 – se construit contre les aspirations démocratiques et nationales du Québec et sans consultation des Premières Nations. Près de 50 000 personnes manifestent contre la Confédération à Montréal, ville qui ne compte alors que 250 000 habitants.
La fondation de l’État canadien en 1867 constitue une entité semi-indépendante, fortement liée à l’Empire. Le caractère monarchique anglais confirme l’hégémonie britannique et canadienne-anglaise. Dans la tradition du« divide and rule » de l’Empire, le Dominion canadien concède quelques droits aux francophones afin de fragmenter sa population en favorisant une partie de l’élite locale. Les promoteurs canadiens-français de la constitution de 1867, tel George-Étienne Cartier, tablent sur ces concessions qui prouveraient, selon eux, que la création du Canada permet de protéger le pouvoir des élites francophones. Les Canadiens et Canadiennes françaises sont désormais en minorité permanente dans le nouvel État canadien. La « Confédération » canadienne est en fait un état d’exception permanent dans lequel le gouvernement fédéral possède des pouvoirs exorbitants.
La Loi sur les Indiens (1876)
La Loi sur les Indiens, créée en 1876, donne au gouvernement fédéral l’autorité exclusive de légiférer sur les « Indiens et les terres réservées pour les Indiens ». Ce régime de citoyenneté de seconde zone, d’apartheid, vise l’assimilation des autochtones et les considère légalement comme des enfants mineurs. Il permet de maximiser l’accumulation privée du capital à partir de l’exploitation des ressources naturelles des territoires autochtones ancestraux.
En 1892 est officialisé le système de pensionnats autochtones. Il s’agit d’un réseau d’institutions scolaires destiné à scolariser, évangéliser et assimiler les enfants autochtones en les déracinant de leur famille et de leur communauté. Il leur est interdit de parler leur langue ou d’exprimer leur culture propre. Plusieurs enfants y subissent des violences physiques et des abus sexuels. Les conséquences psychologiques chez ces enfants sont multiples : perte de repères identitaires, absence d’affection parentale, mal de vivre, etc. Environ 150 000 enfants sont forcés d’aller dans ces pensionnats de 1820 à 1969. Le dernier pensionnat ferme ses portes en 1996, en Saskatchewan.
Le nationalisme de l’élite canadienne-française
L’idée maîtresse du nationalisme des élites canadiennes-françaises est celle d’obliger le Canada à reconnaître les Canadien·ne·s français·es comme un « peuple fondateur » égal. Cet espoir est mis à mal lors de la crise entourant la pendaison de Louis Riel en 1885. Les énormes protestations au Québec aboutissent à l’élection du premier gouvernement nationaliste de la province du Québec en 1887. Le fossé se creuse à la fin du XIXe siècle et au début du XXe avec l’interdiction des écoles francophones dans plusieurs provinces.
Avec la Politique nationale adoptée en 1879, l’économie politique d’accumulation capitaliste canadienne aboutit au développement d’une industrie manufacturière orientée vers le marché intérieur. Les ressources naturelles extraites des terres saisies aux autochtones sont exportées via le chemin de fer du Canadien Pacifique. La machinerie et les biens perfectionnés sont importés des puissances capitalistes avancées. La main-d’oeuvre qualifiée vient de Grande-Bretagne. Les agriculteur·trice·s viennent d’Europe centrale et de l’Est tandis que la main-d’oeuvre bon marché est composée de Canadien·ne·s français·es.
En théorie, les capitalistes canadien·ne·s-français·es peuvent aussi bénéficier de l’exploitation capitaliste. Des bourgeoisies régionales se développent au Québec. Certaines réussissent à s’imposer face aux monopoles de Toronto et Montréal dominés par l’élite anglo-canadienne. Toutefois, la quasi-absence de soutien financier et politique les relègue à un rôle subalterne. La domination massive du capital anglo-canadien au Québec crée une situation où la structure des classes sociales recoupe presque entièrement la composition ethnique et linguistique. La répartition 80% francophone – 20% anglophone au sein de la population s’inverse au sommet de la pyramide sociale et au sein du grand capital. L’oppression nationale des Canadiens et Canadiennes françaises permet l’embourgeoisement de la communauté anglophone et la prolétarisation des francophones.
La naissance du mouvement syndical
La violence de l’exploitation industrielle fait émerger le mouvement syndical durant la deuxième moitié du XIXe siècle. Les secteurs les plus opprimés du prolétariat canadien-français s’organisent. Ce développement exprime le caractère combiné de l’oppression nationale et de l’oppression économique. La répression des patrons et des gouvernements contre le mouvement syndical est brutale. Les soldats tuent souvent des grévistes.
Le mouvement syndical se renforce au début des années 1870. Les luttes du Mouvement des 9 heures dans les grands centres urbains canadiens aboutissent à la première victoire du mouvement syndical: la Loi des unions ouvrières de 1872 qui décriminalise les syndicats. Toutefois, la loi n’oblige pas les employeurs à reconnaître les unions ouvrières et à négocier des contrats de travail. La reprise économique de 1879-1883 crée un contexte favorable à la résurgence du mouvement ouvrier organisé à travers tout le Canada. Les Chevaliers du Travail, organisation fondée aux États-Unis en 1869, s’implantent au Canada en 1881. Elle joue un rôle primordial dans le mouvement ouvrier canadien.
La fin du XIXe siècle est marquée par les débuts de l’action politique ouvrière et l’apparition de plusieurs groupes socialistes au Québec. En 1888, Alphonse-Télesphore Lépine, un candidat ouvrier indépendant organisé à travers les Chevaliers du Travail de Montréal, est élu au Parlement d’Ottawa. D’autres candidats, soutenus officiellement par des syndicats internationaux, sont élus au Parlement de Québec en 1889 et à la ville de Montréal. Ces députés sont peu à peu intégrés dans les partis de la bourgeoisie.
Dès 1892, le Congrès des métiers et du travail du Canada (CMTC) débat d’une proposition visant à créer un parti ouvrier lié aux organisations syndicales. En 1899, plusieurs Clubs ouvriers et syndicalistes créent le Parti indépendant ouvrier, première mouture du Parti ouvrier (PO). Le CMTC délègue d’office des représentants à sa direction. Un candidat ouvrier, Alphonse Verville, est élu à la Chambre des communes en 1906.
Les socialistes autour d’Albert Saint-Martin figurent parmi les fondateurs du PO. En parallèle, ils mettent sur pied la section québécoise du Parti socialiste du Canada (PSC) en 1904. Aidés par un club anarchiste juif, les membres du PSC organisent pour la première fois la manifestation de la Journée internationale des travailleurs le 1er mai 1906 à Montréal. L’année suivante, la direction du PO les dissuade de recommencer, craignant la répression. Les socialistes organisent tout de même la manifestation – durement réprimée – et sont expulsés du PO. Les tensions entre les directions syndicales et les éléments plus socialistes perdurent durant les décennies suivantes. En 1933, les sections montréalaises du PO intègrent la Co-operative Commonwealth Federation (CCF).
L’opposition au militarisme canadien
Le Dominion canadien sert de supplétif pour les guerres de l’Empire britannique. Les Canadien·ne·s français·es s’opposent à ces aventures militaristes par anti-impérialisme. À l’occasion de la guerre des Boers, des confrontations éclatent entre étudiant·e·s anglophones de l’université McGill et ceux, francophones, de l’Université Laval à Montréal. En 1918, des émeutes de masse spontanées éclatent à Québec contre la conscription, rejetée par 90% des Canadien·ne·s français·es. Elles sont suivies d’arrestations de masse et de perquisitions. La loi martiale est imposée, l’armée fédérale intervient et tue quatre personnes dans les rues de la Basse-ville.
Le nationalisme conservateur
Au tournant des années 1920, un courant nationaliste ultraconservateur dominé par le clergé conteste la domination du fédéral sur la politique québécoise. Il débouche sur l’élection de l’Union nationale de Maurice Duplessis en 1936. Duplessis consolide le pouvoir répressif du clergé et instaure un état quasi policier. Son nationalisme basé sur l’« identité » québécoise sépare les luttes nationales des luttes sociales. Duplessis offre au rabais l’exploitation des ressources du Québec aux capitalistes des États-Unis.
Durant cette période, l’État fédéral concentre ses ressources pour développer l’économie de l’Ontario aux dépens de celle du Québec. L’Ontario devient le centre de l’industrie lourde et du secteur financier. Ce processus aboutit à une plus grande intégration du capitalisme canadien à celui des États-Unis, dont l’influence supplante celle de l’Empire. Avant et après la Deuxième Guerre mondiale, le capitalisme au Québec se caractérise par l’exploitation économique américaine et la domination politique anglo-canadienne. Le premier règne du nationaliste ultraconservateur Maurice Duplessis, de 1936 à 1939, inaugure la « Grande Noirceur ». Cette époque se caractérise par un libéralisme économique débridé et engendre une dépendance économique vis-à-vis des États-Unis.
La « Grande noirceur »
Reporté au pouvoir en 1944, le régime duplessiste, proche de ceux de Mussolini et de Franco, est foncièrement antisyndical et anticommuniste. Durant les années 1940, le procès truqué et l’emprisonnement du seul candidat communiste élu à la Chambre des Communes, Fred Rose, inaugure la Guerre froide. Des grèves ouvrières sont violemment réprimées par la police qui tue plusieurs grévistes (Sorel, 1937, Asbestos, 1949, Louiseville/Dupuis Frères, 1952, Murdochville, 1957).
Après 1945, l’empire américain prend toute la place laissée par la dislocation de l’Empire britannique. La prolétarisation et l’urbanisation entraînent des changements dans la composition des classes populaires. La classe ouvrière se développe dans de nouveaux secteurs, en particulier dans celui des services.
La « modernisation » de l’État
Après la mort de Duplessis, de nouvelles fractions bourgeoises québécoises émergent grâce au développement de l’État. Cette nouvelle bourgeoisie utilise les marchés publics pour favoriser les entreprises québécoises (ex. Bombardier, SNC, Lavalin, Desjardins). Ces nouvelles élites francophones portent au pouvoir le Parti libéral du Québec (PLQ) en 1960 sur la base d’un nationalisme axé sur la modernisation de l’État. Le gouvernement libéral institue une assurance-hospitalisation, amorce une réforme de l’éducation (ex. création des cégeps et des Universités du Québec), nationalise les entreprises d’hydro-électricité et intervient activement dans l’économie. À titre comparatif, l’Ontario a nationalisé l’hydroélectricité en 1905.
Cette nouvelle forme de nationalisme court-circuite une fois de plus l’accumulation capitaliste pancanadienne désirée par la bourgeoisie anglo-canadienne. L’État canadien entreprend des réformes en relançant les politiques de bilinguisme, de multiculturalisme et d’intégration des francophones dans l’État fédéral.
La vague nationaliste traverse également la classe ouvrière québécoise qui subit l’oppression nationale bien davantage que ses élites. En 1961, le revenu des Québécois·es est au bas de l’échelle, devant celui des autochtones, mais à égalité avec celui d’autres groupes ethniques comme les Italien·ne·s et les Portugais·es. Les personnes d’origines britannique ou juive trônent loin en haut de l’échelle des revenus. Après 1960, les luttes syndicales dans le secteur public qui naît et grandit rapidement permettent d’améliorer les salaires et les conditions de vie des Québécois·es.
L’oppression nationale que les travailleurs et travailleuses du Québec subissent – discrimination linguistique, taux de chômage plus élevé, salaire inférieur pour le même travail, difficulté d’accès à l’éducation, etc. – favorise le développement d’une conscience de classe. Plus que jamais, le mouvement ouvrier québécois réalise qu’il doit mener la lutte à l’oppression nationale à partir de ses propres intérêts, de ses propres objectifs et de sa propre base.