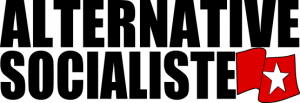Vendredi 8 septembre, un terrible tremblement de terre de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter a frappé la ville de Marrakech. Si la ville a pu plus ou moins s’en sortir, ce n’est pas le cas de nombreux villages de l’Atlas, totalement anéantis par la catastrophe qui a causé près de 3000 morts et le double de blessés. Les dégâts matériels sont estimés à 10 milliards d’euros, soit 8% du PIB du pays.
Il est assez facile d’imputer au hasard ces morts, les dégâts matériels et toutes leurs conséquences. La « Nature » nous rappellerait à quel point nous sommes petits et fragiles, et rien n’aurait pu empêcher ça. Comme l’avait rappelé Carmia Schoeman, titulaire d’une maîtrise en géologie des glissements de terrain et membre du WASP (section d’ASI en Afrique du Sud), à l’époque des séismes qui ont frappé la Turquie, la Syrie et le Kurdistan en février dernier : « Dans l’étude des géorisques, nous avons un dicton qui dit que les tremblements de terre ne tuent pas vraiment les gens, ce sont les bâtiments qui le font. »
Dans les zones touchées, les normes qui auraient dû assurer une résistance plus importante des bâtiments n’étaient pas respectées. La région a pourtant connu précédemment d’autres tremblements de terre importants, en 1960 et 2004 notamment, dus à la situation du Maroc, à cheval sur les plaques tectoniques africaine et eurasiatique. Pire que ça, de nombreux villages de l’Atlas, les plus durement touchés car situés dans l’épicentre de la catastrophe et disposant d’une architecture rustique, étaient largement inaccessibles pour les secours, faute de route bien aménagée.
Une catastrophe aggravée par les inégalités
La chose est d’autant plus criminelle quand on sait que les régions les plus touchées sont également les plus pauvres. Le PIB par habitant de la région de Marrakech-Safi est de deux fois inférieur à la moyenne nationale. La population est essentiellement composée de paysans pauvres vivant d’une économie agricole de subsistance. La plupart ne disposent pas d’assurance. Si le pays dispose d’un Fonds de Lutte contre les effets des Catastrophes Naturelles (FLCN), le régime d’indemnités en cours depuis 2020 n’est pas capable de débourser plus de 100 millions par an selon la banque mondiale. Sans compter que l’indemnisation demande des démarches administratives impossibles à réaliser dans ces régions reculés où l’Etat est peu présent.
Ces problèmes d’assurance peuvent rappeler, toutes proportions gardées, les dégâts causés par les inondations de juillet 2021 en Belgique et le manque de volonté des assurances d’indemniser les sinistrés. Cette comparaison n’est pas finie : si le séisme n’est pas la conséquence du réchauffement climatique, les inondations qui ont dévasté au même moment la Libye rappellent que les catastrophes naturelles risquent d’augmenter dans les années à venir, accroissant la nécessité de construire des infrastructures solides face aux périls qui s’annoncent.
Mais les conditions actuelles du Maroc ne permettent pas une telle chose. Si le Maroc est la cinquième économie du continent africain et deuxième plus grand investisseur du continent, c’est aussi le pays le plus inégalitaire d’Afrique du Nord. Les trois milliardaires les plus riches du pays réunissaient à eux seuls 4,5 milliards de dollars en 2018 selon Oxfam, et l’accroissement de leur fortune en un an est égal à la consommation des 375 000 Marocains et Marocaines les plus pauvres sur la même période.
Tout cela est dû à une politique économique globale tout entière offerte aux caprices du marché, notamment sous l’impact des plans d’ajustement structurel des années 70-80. À l’époque, face à la crise de la dette, les pays capitalistes développés avaient confié au Fonds monétaire international (FMI) et à la Banque mondiale la mission d’imposer une discipline financière stricte aux pays surendettés et notamment la privatisation d’une grande partie de l’économie, des transports entre autres.
En 2011, le pays avait connu, comme de nombreux autres en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, une puissante vague de contestation contre le régime, le « mouvement du 20 février », face à un chômage de masse affectant particulièrement la jeunesse et une situation de désespoir socio-économique global, fruit des politiques évoqués plus haut. Le mouvement, bien que maîtrisé, continuait à alimenter un certain esprit, qui a pu se manifester à nouveau dans la région du Rif en 2016. Ces mouvements de masse étaient le signe de la volonté de larges pans de la population de lutter contre le régime dictatorial du roi Mohamed VI, soutenant avant tout les élites marocaines et impérialistes qui pillent de concert le pays au détriment de la population. Cependant, la puissance répressive du régime et le manque d’organisation politique capable de lui offrir un débouché avaient eu pour conséquence un échec du mouvement. L’esprit de contestation reste toutefois puissant au Maroc, et ce nouvel élément dramatique vient ajouter aux raisons de la colère, rendant plus nécessaire que jamais la constitution d’une organisation large des travailleurs et travailleuses, capable d’organiser la population autour d’un programme de rupture, afin d’investir dans les besoins sociaux vitaux de la population et de la prémunir contre de nouveaux désastres de ce genre.