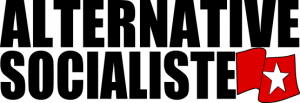« Nous ne devons pas nous vanter trop de nos victoires humaines sur la Nature.
Pour chacune de ces victoires, la Nature se venge sur nous. »
– Friedrich Engels, Dialectique de la nature.
Beaucoup se seront sentis soulagés de la réussite du développement d’une première génération de vaccins et de leur déploiement progressif dans un certain nombre de pays. Quel témoignage des capacités de la science moderne ! Malheureusement, depuis lors, les contaminations augmentent rapidement, avec un nombre record de décès et l’annonce de nouveaux confinements. Il semble que le virus prenne sa revanche, et nous rappelle que ce n’est pas encore fini.
Le Covid 19 est venu s’ajouter aux catastrophes écologiques et à l’aggravation des privations sociales. La pandémie a mis en évidence le manque de crédibilité politique du système et a déclenché une dépression économique qui était déjà imminente. Elle a plongé le capitalisme dans un tourbillon de crises d’une ampleur inédite, avec des conséquences dramatiques sur tous les aspects de la vie et n’épargnant aucune partie de la planète.
La «main directrice» de l’État
Cette crise a aussi complètement mis en pièces le conte de fées du capitalisme en tant que système «autorégulateur». La «main invisible du marché» a totalement perdu le contrôle des forces qu’elle a libérées. Elle s’est vue forcée de céder la place à la “main directrice de l’État” dans une tentative désespérée de retrouver un semblant de contrôle sur la situation.
L’utilisation de la «main directrice de l’État» est loin d’être neuve ou exceptionnelle sous le capitalisme. Cela a été essentiel dès sa création, lors de l’exploration et du pillage des colonies, que Marx a décrit comme la période d’«accumulation primitive» du capital. Le développement de la plus ancienne bourse d’Amsterdam au XVIIe siècle n’a été possible qu’après que la Compagnie privée des Indes orientales ait obtenu le monopole du commerce extérieur et soit devenue le bras armé de la politique coloniale néerlandaise. La «Belle Epoque», la période de mondialisation capitaliste qui a précédé la Première Guerre mondiale, a pris son envol après la normalisation du rail et du télégraphe à l’initiative de l’Etat. En fait, l’histoire du capitalisme est jonchée d’exemples d’événements politiques, de financement public et d’initiatives publiques qui ont posé les bases du profit privé.
Le développement des vaccins sera bien sûr mis à profit pour prétendre – à tort – que cela résulte de l’initiative privée, de la concurrence entre acteurs privés et du marché libre, par opposition à l’intervention publique qui étoufferait prétendument l’initiative. En réalité, l’afflux de fonds publics représentait une condition préalable cruciale pour que les entreprises pharmaceutiques privées puissent développer des vaccins en si peu de temps. Le ministère américain de la santé a, à lui seul, engagé 10,6 milliards de dollars pour les développeurs de vaccins. Moderna a reçu plus de 2,5 milliards de dollars en commandes prépayées et en partenariats public-privé du gouvernement américain. Pfizer a reçu un montant similaire provenant de différentes ressources publiques et AstraZeneca a reçu 1,7 milliard de dollars de fonds publics. Toutes ces entreprises s’appuyaient fortement sur la recherche fondamentale développée dans des universités publiques comme Harvard, Mayence, Oxford, etc. On estime qu’au total, 3 nouveaux médicaments sur 4 sont développés grâce à la recherche fondamentale financée par l’État, plutôt que d’être le résultat du prétendu dynamisme du secteur privé.
Contrairement à Moderna et Pfizer, AstraZeneca a promis de vendre son vaccin sans faire de profit tant que durera la pandémie. Johnson & Johnson et GSK ont pris des engagements similaires, mais comme l’a prévenu Médecins sans frontières, AstraZeneca décidera elle-même quand elle estimera la pandémie terminée. D’importantes hausses de prix sont à prévoir par la suite. En outre, comme l’a souligné l’Observatoire européen des entreprises, la Commission européenne refuse de communiquer les prix convenus avec les entreprises pharmaceutiques. Grâce à une bévue du secrétaire d’État au budget belge, ces prix sont désormais dans toute la presse. Ils varient entre 1,80 € pour le vaccin AstraZeneca et 14,70 € pour le vaccin Moderna.
La pandémie a souligné le peu de rapport qui existent entre la mondialisation capitaliste et la «coopération et la solidarité internationales». Aujourd’hui, ce constat s’étale à nouveau au grand jour avec le développement de ce que l’on a déjà appelé le «nationalisme vaccinal». Pays et régions se bousculent et jouent des coudes pour être les premiers servis dans l’espoir de relancer pleinement la machine à profits. Avant leurs principaux concurrents de préférence.
Déjà 9,6 milliards de doses de vaccins ont été achetées ou réservées, la majeure partie d’entre elles par des pays à revenu élevé. Le Canada en a acheté 5 fois plus qu’il n’en a besoin, l’UE deux fois plus qu’il n’en faut, etc. Les pays à revenu moyen supérieur ont acheté beaucoup moins, mais ce sont les pays à faible revenu qui devront compter sur COVAX, un projet de coopération internationale impliquant l’Organisation mondiale de la santé et visant à vacciner 3% de la population, puis 20% à un stade ultérieur, ce qui est encore loin des 70% requis pour éradiquer le virus.
Selon les modèles actuels, il n’y aura assez de vaccins pour couvrir la population mondiale qu’en 2023 ou 2024. Un sondage d’opinion réalisé en Belgique a révélé que 80% des personnes interrogées étaient favorables à la suppression des brevets, une proportion probablement similaire à celle d’autres pays. L’Inde et l’Afrique du Sud ont proposé de renoncer aux brevets jusqu’à la fin de la pandémie. Cela est techniquement possible du fait de l’accord ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) de l’Organisation mondiale du commerce adopté en 2003. Mais cela n’a jamais été appliqué en raison de la pression des grands lobbies pharmaceutiques. Cela est à nouveau rejeté aujourd’hui par le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l’Australie et l’Union européenne. Les principaux responsables politiques doivent pourtant bien savoir qu’au cours des dix dernières années, les grandes entreprises pharmaceutiques ont versé plus de dividendes aux actionnaires qu’elles n’ont investi dans la recherche et le développement de vaccins.
Le développement de la première génération de vaccins sera accueilli par beaucoup avec soulagement, mais il y a de nombreux obstacles à surmonter, tels que la réfrigération mobile et l’accès à une électricité fiable. Des questions restent également entières concernant la durée de l’immunité fournie, les effets secondaires possibles et la possibilité de mutation du virus. Un certain scepticisme existe au sujet des vaccins en raison des échecs répétés des classes dirigeantes dans la lutte contre le virus, du secret et de la méfiance envers les hommes et femmes politiques dévoués aux intérêts des entreprises. L’Organisation mondiale de la santé considère «l’hésitation à se faire vacciner» comme l’une des dix principales menaces sanitaires mondiales.
Le coronavirus a aggravé une dépression économique déjà en cours
Ce qui restera dans l’histoire comme la crise économique du coronavirus a plongé l’économie mondiale, en quelques semaines, dans une dépression similaire à celle qui a mis des années à se développer lors de la Grande Dépression des années 1930.
Suite à la mise en place de mesures de confinement dans le monde entier depuis mars 2020, au cours du 2e trimestre 2020, le PIB réel de la zone OCDE a chuté de 9,8% selon les estimations, ce qui est nettement plus que la chute de 2,3% enregistrée au premier trimestre 2009, au plus fort de la crise financière. Le PIB a baissé de 20,4% au Royaume-Uni, de 13,8% en France, de 12,4% en Italie et en Allemagne. Dans l’ensemble de la zone euro et dans l’Union européenne, il a baissé respectivement de 12,1% et 11,7%, après des baisses de 3,6% et 3,2% au trimestre précédent. Aux États-Unis, il a baissé de 9,5% et au Japon de 7,8%.
Après un tel quasi-arrêt, il est logique qu’une fois que les économies ont commencé à rouvrir, il y ait eu un rebond significatif au troisième trimestre avec une croissance du PIB de 7% aux États-Unis, 8% en Allemagne, 16% au Royaume-Uni et 18% en France. Cela a ravivé l’espoir que la récession serait en forme de «V» (c’est-à-dire suivie d’une reprise rapide) et que la prédiction de l’économiste en chef du FMI, Gina Gopinath, selon laquelle la période de reprise après la crise serait «longue, inégale et incertaine», se serait avérée fausse.
Le rebond s’est avéré de courte durée puisque le virus a refait surface. Mais même avant les deuxièmes vagues, le FMI avait déjà prédit une chute du PIB mondial de 4,4% en 2020, un record. Il avait alors estimé que les économies avancées se seraient contractée de 4,7% d’ici fin 2021 par rapport à leurs estimations de début 2020, et de 8,1% pour les économies émergentes. Les coronavirus et les confinements, s’ils ont eu un impact extrême, n’ont pas causé mais plutôt déclenché une aggravation dramatique de la dépression économique qui se développait déjà. Aucun des problèmes préexistants n’a été résolu depuis, tous se sont aggravés.
La croissance de la productivité, principale mesure de la performance d’un système économique, est en déclin depuis de nombreuses décennies. Mesurée par la croissance du PIB mondial par personne employée, elle est passée de 3,2% en 1970 à 1,2% au début des années 1980, puis a remonté à 2,5% au début des années 2000 avec l’intensification de l’exploitation et l’ouverture de nouvelles régions à l’exploitation capitaliste, avant de redescendre régulièrement pour atteindre 1,5% en 2019.
Dans les pays capitalistes avancés, à l’exception des États-Unis, la croissance du PIB par personne employée est passée de 4% en 1970 à 2% au début des années 1980, puis a stagné pendant 15 ans avant de redescendre régulièrement à 0,8%. Les États-Unis ont suivi une courbe inverse : d’un creux de 1,3% en 1970 à un pic de 2% en 2000, ils ont depuis rejoint la même courbe descendante. Au niveau mondial, l’augmentation de l’efficacité de la production entre 2007 et 2014 n’a été que d’environ un quart de celle enregistrée entre 1999 et 2006 ! Cette situation comprime les profits, sape les investissements dans la production réelle, menace la croissance économique, la création d’emplois et le niveau de vie. En outre, toutes les prévisions indiquent une nouvelle érosion à long terme.
Le rapport sur la richesse mondiale en 2020 du Crédit Suisse a confirmé que les inégalités, déjà à un niveau historique, ont rapidement augmenté. On estime désormais que le 1% des ménages les plus riches possède 43% de l’ensemble de la richesse personnelle mondiale, dont 25% sont détenus par les 175 000 ménages ultra-riches – le 0,1% ! Les 50% les plus pauvres possèdent 1% de la richesse mondiale, les 90 % les plus pauvres 11%. Le FMI et la Banque mondiale estiment qu’entre 90 et 150 millions de personnes dans le monde vont tomber dans l’extrême pauvreté, faisant passer de 8,4 à 9,1% la part de la population mondiale vivant avec moins de 1,90 $ par jour.
La colossale montagne de dette s’agrandit
Depuis plus d’une décennie, l’économie mondiale est également en proie au piège de la dette. Il y a plus de dix ans, la Chine a pu lancer un gigantesque plan de relance qui a contribué à amortir les effets de la Grande Récession à l’échelle mondiale. C’est en partie grâce à cela que la Chine a accumulé une dette telle qu’elle n’est plus en mesure de répéter une intervention de cette ampleur. Selon l’Institute of International Finance (IIF), la dette mondiale totale – publique, entreprise et ménages confondus – a augmenté de 15.000 milliards de dollars en 2020. Entre 2016 et 2020, elle a augmenté de 52 000 milliards de dollars, contre 6 000 milliards de dollars entre 2012 et 2016. Au début de 2020, la dette mondiale atteignait 320% du PIB mondial et se situe maintenant à 365%.
En réponse à la Grande Récession de 2008/09, les banques centrales, créées à l’origine pour contrer les liquidités excessives et éviter une inflation incontrôlable, ont injecté de vastes sommes d’argent dans l’économie. En conséquence, leurs bilans ont explosé, la FED (États-Unis) passant d’une moyenne historique de 4 à 6% du PIB américain à 22%. Les tentatives de réduction substantielle de cette moyenne ont échoué en raison de la faiblesse de la croissance post-récession. En janvier 2020, elle s’élevait encore à 4,2 billions de dollars, soit 19% du PIB américain, mais la dépression « coronavirus » est ensuite arrivée. Déjà avant la pandémie, les économistes avaient mis en garde contre l’endettement excessif des entreprises. Fin 2019, près de 20% des entreprises américaines étaient considérées comme des « entreprises zombies », maintenues en vie par des prêts dont elles ne peuvent pas assurer le remboursement. Leur effondrement provoquerait une réaction en chaîne imparable ainsi qu’un krach financier.
La FED n’a donc pas eu d’autre choix que d’intervenir à nouveau et, en juin, son solde atteignait 7,2 billions de dollars, soit 33% du PIB américain. En novembre, elle avait déjà atteint 7,2 billions de dollars, soit 33% du PIB américain. Les banques centrales du monde entier avaient injecté pas moins de 8 700 milliards de dollars dans l’économie et continuent à en faire plus. Cela explique pourquoi les marchés boursiers, après des chutes record fin février et début mars, ont rebondi pour atteindre de nouveaux niveaux records. Mais la menace d’un effondrement financier n’a pas du tout disparu. On estime que lorsque les mesures spéciales liées au Covid seront retirées, un nombre record de ces sociétés zombies ainsi qu’un nombre encore plus important de sociétés qui étaient viables jusqu’avant la pandémie, feront faillite. Les économistes cherchent désespérément une issue.
Certains défendent l’illusion qu’il est possible de se sortir de l’endettement sans même avoir besoin de dégager un excédent budgétaire. «Tant que les taux d’intérêt restent inférieurs à la croissance économique nominale», comme si cela était concevable lorsque les grandes économies chercheront à attirer des flux de capitaux supplémentaires ou – à un stade ultérieur – à lutter contre l’inflation. D’autres défendent des variantes de la «théorie monétaire moderne», à savoir que les gouvernements créent de la monnaie sans limite à partir de rien, soutenus par les banques centrales qui gonflent leurs bilans à des taux d’intérêt de 0%, soit pour une période indéterminée, soit pour une très longue période (environ 100 ans). Il s’agirait d’une méga version moderne de la « planche à billets » qui, tôt ou tard, déclencherait une forte inflation et balancerait sur liste noire des devises soupçonnées de ne pas refléter la valeur réelle des biens et des services.
Le commerce mondial
Une des caractéristiques du capitalisme énormément renforcée pendant la période de mondialisation capitaliste est la division internationale du travail et, donc, le commerce international. En pourcentage du PIB mondial, la valeur du commerce mondial des biens et des services a augmenté régulièrement, passant de 19% en 1984 à un pic de 31% en 2008. Mais s’il est impossible de revenir simplement sur le passé, les systèmes en déliquescence ont tendance à bloquer, voire à inverser les évolutions objectives. Pendant un certain nombre d’années avant la crise actuelle, le commerce mondial est devenu un fardeau pour la production mondiale et, en tant que part du PIB mondial, il a stagné sous son pic de 2008. En 2020, le commerce mondial devrait encore se contracter de 10,4%, une tendance qui ne sera pas totalement inversée par un inévitable rebondissement partiel en 2021.
D’autres statistiques vont dans le même sens. Les créances bancaires transfrontalières mondiales n’ont cessé d’augmenter jusqu’en 2008, pour atteindre 60% du PIB mondial, mais elles ont ensuite fortement chuté et représentaient 40% du PIB mondial en mars 2019. La libre circulation des capitaux a également diminué. En 2017, le total des flux de capitaux mondiaux en pourcentage du PIB mondial a été réduit à un tiers de son niveau record de 2007. On estime que sa principale composante, l’investissement direct étranger, a diminué jusqu’à 40% en 2020 et devrait encore se contracter de 5 à 10% en 2021.
Le degré de financiarisation, mesuré par la capitalisation boursière mondiale, a augmenté régulièrement, passant de 27 milliards de dollars en 1975 à 816 milliards de dollars en 2007, mais il a stagné depuis. En 2019, il était tombé à 632 milliards de dollars. Les recettes mondiales des privatisations sont passées d’environ 40 milliards de dollars par an en 1988 à environ 170 milliards de dollars en 2000, principalement en raison des privatisations en Europe de l’Est. Cela a ensuite oscillé entre 40 et 120 milliards de dollars par an jusqu’en 2008, puis cela est remonté à 200 milliards de dollars en raison de la revente de banques rachetées par les gouvernements pendant la crise financière ainsi que de vastes programmes de privatisations en Chine, et dans une moindre mesure en Russie et en Inde. Ailleurs, les privatisations se sont cependant enlisées.
À l’ère du désordre
Tout cela montre que l’ère du néolibéralisme s’est essoufflée depuis plus d’une décennie. La dépression « coronavirus » lui a porté un nouveau coup, peut-être fatal. Cela ne signifie pas que certaines politiques, à tort ou à raison, identifiées au néolibéralisme, ne continueront pas. L’austérité va se poursuivre, tout comme les tentatives de privatisation et, sans aucun doute, la poursuite de la déréglementation du marché de l’emploi. Mais cela se fera à l’échelle nationale ou régionale, les gouvernements s’écartant plus fréquemment des «règles» internationales, intervenant directement pour défendre les intérêts de leur propre classe capitaliste nationale ou faisant même des concessions limitées face à la résistance de masse, une fois que la répression aura échoué.
Alors que le néolibéralisme se heurte à un mur, nous entrons dans une nouvelle ère d’instabilité. Dans une de ses études, la Deutsche Bank qualifie cela «d’ère du désordre», ce qui indique une polarisation accrue, à gauche et à droite, ainsi que des tensions inter-impérialistes croissantes. Bien que parfois indirectement, ces tensions seront liées à la nouvelle guerre froide entre les impérialismes américain et chinois, qui est désormais le facteur prépondérant dans la politique et l’économie mondiales.
Alors que la présidence Biden bénéficiera peut-être d’une certaine lune de miel aux Etats-Unis après la désastreuse époque de Trump, ses faux appels à l’unité se heurteront bientôt aux profondes contradictions qui ravagent la société américaine et qui continueront à alimenter la polarisation. Sur le plan international, on peut s’attendre à ce que la nouvelle administration américaine parle un langage plus réfléchi, moins provocateur et plus prévenant, et qu’elle relance probablement certains des engagements internationaux les plus symboliques comme l’accord de Paris sur le climat ou l’engagement des États-Unis dans l’OMS. Mais si l’image de marque pourrait changer, le contenu restera globalement le même et continuera à se développer.
Il y aura des caractéristiques contradictoires, surtout si nous entrons dans une période de transition où l’ancien meurt alors que le neuf n’est pas encore né. Toutefois, la tendance dominante de cette nouvelle ère sera l’augmentation des tensions, avec des guerres tarifaires, monétaires et commerciales, qui se transforment parfois en guerres par procuration et peut-être même en guerre froide qui devient parfois chaude, bien qu’à une échelle limitée, comme nous l’avons vu lors des affrontements à la frontière entre l’Inde et la Chine l’année dernière.
Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la révolution commence généralement au sommet, lorsque les désaccords publics expriment l’incapacité de l’élite dirigeante à proposer une voie d’avenir de manière crédible. Toute cette situation va pousser les classes dirigeantes à introduire plus de répression, renforcer les forces populistes d’extrême droite ainsi que le chauvinisme national. Mais elle alimentera également le sentiment croissant parmi les jeunes, les travailleurs et les opprimés que «nous n’en pouvons plus».
Les mouvements se développent rapidement
On se serait attendu à ce qu’une dépression aussi soudaine et profonde puisse paralyser les travailleurs et les jeunes. Après tout, selon l’Organisation internationale du travail (OIT), plus d’un demi-milliard d’emplois équivalents temps plein ont été perdus au cours du seul deuxième trimestre 2020. Cette dévastation est concentrée parmi les travailleurs les plus vulnérables, les travailleurs à bas salaires, les travailleurs migrants et les travailleurs du secteur informel. Les femmes, qui représentent 39% de la main-d’œuvre mondiale, subissent 54% des pertes d’emploi.
Les statistiques officielles du chômage sous-estiment l’ampleur réelle de la catastrophe. Dans l’ensemble de l’OCDE et des économies émergentes, quelque 30 millions de «travailleurs découragés» (qui ne recherchent plus activement un emploi) n’apparaissent pas dans les statistiques officielles. En Chine, la plupart des chômeurs sont des migrants internes qui ne figurent pas non plus dans les statistiques officielles. Selon des rapports indépendants crédibles, 50 millions de ces travailleurs migrants sont toujours sans emploi malgré le soi-disant rebond économique de la Chine.
Mais au lieu d’une paralysie, nous avons vu des mouvements se développer, même sous des restrictions de confinement, sur toute une série de questions telles que l’oppression raciale, sexuelle ou nationale, les questions environnementales, la corruption, les élections truquées, la législation répressive et bien sûr la privation sociale, l’austérité et l’état lamentable des soins de santé, de l’enseignement et d’autres services essentiels. Ces mouvements ont partiellement ressuscité la vague de révolte qui a secoué le monde en 2019. Bien qu’il y ait des faiblesses évidentes en termes d’organisation, de programme et de direction, ces mouvements étaient généralement massifs et bénéficiaient d’un large soutien public. Ils se sont également caractérisés par un degré frappant de courage, de détermination et de ténacité, un sens impressionnant de l’internationalisme et de l’unité par delà la couleur de peau, le genre et la nationalité, et étaient présents sur tous les continents. Le mouvement de Hong Kong a finalement été vaincu, d’autres mouvements ont connu un certain épuisement, mais certains mouvements ont également obtenu des victoires impressionnantes qui stimuleront d’autres développements.
En général, ces mouvements ont mis en évidence la base sociale très mince des élites dirigeantes qui tend à se réduire encore plus à mesure que la crise se développe. L’un des effets secondaires de la crise a été un bond gigantesque dans la concentration du capital. Une part importante des pertes d’emplois est concentrée dans les petites entreprises. L’OIT estime qu’environ 436 millions de petites entreprises dans le monde sont menacées. Cela alimente déjà la radicalisation des classes moyennes, dont un partie subira des conditions similaires à celles des couches les plus pauvres de la classe ouvrière. Bien sûr, en son sein, certains, comme c’est le cas d’une couche plus aliénée de travailleurs, traduiront leur colère en une sorte de soutien au populisme de droite, mais d’autres rejoindront les rangs de la résistance de la classe ouvrière. En tant que base sociale de l’élite dirigeante, les classes moyennes deviendront un facteur beaucoup moins fiable.
De l’orthodoxie fiscale à l’activisme fiscal
Quelle a été la réaction générale des élites dirigeantes à cette crise jusqu’à présent ? Les banques centrales sont intervenues avec des injections monétaires représentant environ 10 % du PIB mondial. Mais il ne s’agissait que d’une intervention économique «d’urgence» immédiate. Il en faut davantage pour sauver le système d’un effondrement total et éviter la révolte sociale. L’establishment a compris qu’il s’agissait de la mesure la plus proche d’une situation de guerre. «D’abord vous vous inquiétez de la guerre, ensuite vous trouvez comment la payer«, a déclaré Carmen Reinhart, ancienne partisane de la ligne dure fiscale, aujourd’hui économiste en chef de la Banque mondiale. Sur le déficit budgétaire record de 3,13 billions de dollars américains, le président de la Fed, M. Powell, a déclaré que «ce n’est pas le moment de donner la priorité à ces préoccupations». La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré : «Il est clair que le soutien budgétaire et le soutien monétaire doivent rester en place aussi longtemps que nécessaire et qu’il faut éviter les effets de falaise». La majorité des économistes, journalistes, politiciens, etc. se rallient à des déclarations similaires.
Le dogme de l’orthodoxie fiscale a été jeté par la fenêtre et remplacé par l’activisme fiscal. En décembre, des mesures de relance budgétaire d’un montant de 13 500 milliards de dollars, soit 15% du PIB mondial, avaient été lancées, ce qui est 4 à 5 fois plus que pendant la Grande Récession de 2008/09.
Dans les pays capitalistes avancés, cela représente 1 365 dollars par habitant, dans les pays en développement, 76 dollars par habitant et dans les pays les plus pauvres, 18 dollars par habitant. Fin octobre 2020, le Japon avait injecté des stimulants fiscaux représentant 21% de son PIB, les États-Unis 13,2% (avant que le dernier paquet de mesures ne soit adopté), l’Allemagne 8,9%, mais aussi le Brésil 12%, l’Inde 6,9%, l’Argentine 6% ou l’Indonésie 4,3%. D’autres injections sont en cours de discussion et devraient être approuvées.
Cette politique sera-t-elle de courte durée ? Le néolibéralisme reprendra-t-il bientôt après une brève interruption, comme ce fut le cas au lendemain de la Grande Récession ? Cette dépression ne représente pas un simple nid de poule sur la route, il s’agit du résultat d’une crise organique qui a mûri pendant une longue période. Elle est due au fait que les forces productives ont depuis longtemps dépassé le mode de production capitaliste et les rapports de propriété, qui sont passés d’un frein relatif au développement à une entrave absolue. Le développement productif a atteint depuis longtemps un stade qui exige une planification démocratique, une coopération internationale et un échange de connaissances ainsi qu’un contrôle et une propriété publics des ressources, mais cela se heurte à la soif de profit du système.
En outre, cette crise est également fortement liée à l’affaiblissement de l’impérialisme américain qui, tout en restant la puissance dominante, est de plus en plus contesté, notamment par l’impérialisme chinois.
Tout cela rend très improbable une renaissance de l’ère néolibérale. Cela exigerait soit une victoire majeure de l’impérialisme américain, soit un retour à la politique d’«engagement» avec la Chine qui a commencé avec la visite de Nixon en 1972 et a conduit à l’adhésion de la Chine à l’OMC en 2000. Tous deux semblent extrêmement improbables et exigeraient également une explosion sociale en Chine qui créerait ses propres complications. Cela exigerait également une répression importante de la classe ouvrière, réduisant les droits des travailleurs et les conditions de travail et de vie à un niveau tel que la rentabilité productive pourrait être au moins partiellement restaurée. Cela exigerait de grandes batailles de classe, qui ne sont pas exclues, tout comme ne le sont pas les défaites pour la classe ouvrière, surtout avec le manque actuel de programme et d’organisation adéquats en raison du manque d’une direction capable de faire face aux défis et tâches à venir. Mais en même temps, les élites dirigeantes savent que ce ne serait pas une tâche facile et, pour l’instant, elles manquent de confiance et de force pour le faire rapidement, c’est pourquoi à ce stade, ce n’est pas la pensée dominante dans les sphères dirigeantes.
Ainsi, alors que nous assisterons à des rebondissements, que la politique d’activisme fiscal sera mise en œuvre de différentes manières dans différents pays et régions du monde, la tendance dominante dans l’économie mondiale sera à une plus grande intervention de l’État – politiquement et financièrement – avec moins de poids donné au dogme “néolibéral” classique de réduction des déficits.
Ni le FMI ni aucune autre grande institution internationale, ni les principaux faiseurs d’opinion à ce stade ne plaident pour un abandon rapide du soutien budgétaire. Ce n’est ni réaliste, ni souhaitable. Tout comme la Grande Dépression des années 1930 ou la «crise pétrolière» de 73-75, cette dépression montre que la politique dominante des dernières décennies a atteint ses limites. Sa poursuite ne fera qu’aggraver la catastrophe. Comme d’habitude, l’État est appelé à sauver le système, puis à le sauver par la réforme, ou dans le langage du FMI «pour aider aux ajustements». Mais ceux-ci seront immenses. L’issue de tout cela sera principalement décidée par la lutte des classes.
La voie à suivre n’est pas de sauver le capitalisme, mais de le renverser
Tout cela représente un changement majeur, un changement tectonique dans les politiques économiques des capitalistes, auquel nous devons faire face afin de nous préparer aux luttes de classes à venir. À bien des égards, la situation à laquelle nous sommes confrontés est unique, mais une pierre angulaire de la méthode marxiste consiste à s’enquérir des lois du développement à l’œuvre dans l’histoire de l’humanité afin de mieux comprendre les processus qui se développent. Le parallèle le plus proche de la situation réelle est la période qui englobe la Grande Dépression des années 1930. Tout comme la dépression actuelle, la Grande Dépression des années 1930 a montré que la politique capitaliste du «laissez-faire», alors dominante, ne fonctionnait plus. L’idée d’Adam Smith, selon laquelle l’intérêt général est mieux servi lorsque chacun poursuit son propre intérêt, s’est heurtée à un mur de briques. Afin de sauver le système, Keynes a favorisé une nouvelle approche anticyclique : les gouvernements devraient dépenser pour sortir des récessions et se retirer lorsque la reprise s’installe.
Roosevelt l’a appliquée avec hésitation aux États-Unis, en visant à sauver le capitalisme. Cela a échoué, non pas parce qu’il n’en a pas fait assez, mais parce qu’aucune des causes subjacentes de la Grande Dépression n’avait été traitée. C’est la menace croissante de la révolution, la seconde guerre mondiale et sa destruction, son issue et le rapport de forces qui en a découlé, qui a poussé le processus bien au-delà de ce que Keynes avait lui-même jamais envisagé. Cela a conduit à ce que les États-providence – dans les pays capitalistes avancés et à quelques exceptions près dans le monde néocolonial – évitent à nouveau la révolution. Il s’agissait d’une situation exceptionnelle, le résultat de la conjonction de plusieurs facteurs pour lesquels il n’existe absolument aucune base matérielle aujourd’hui. Ce chapitre est clos, car depuis la crise «pétrolière» de 1973-75, la stagflation et la baisse des taux de profit ont fait au keynésianisme d’après-guerre ce que la Grande Dépression des années 30 avait fait au «laissez-faire».
Le néolibéralisme lui-même n’est pas entré en scène tout prêt. Il a commencé comme une expérience monétariste au Chili après le coup d’État de Pinochet en 1973. Ailleurs, il a fallu de grandes luttes de classes sur une période de 5 à 10 ans avant que la classe dirigeante ne gagne la confiance et la force nécessaires pour l’imposer comme sa politique principale.
En substance, le monétarisme considère la masse monétaire, et non la politique fiscale, comme le principal outil de régulation économique, garanti par des banques centrales indépendantes des gouvernements élus. Il considère que l’intervention politique dans l’économie est soumise à des pressions en faveur de l’égalité des revenus et des richesses au détriment de «l’efficacité économique». Le néolibéralisme a pris forme au fur et à mesure que la déréglementation, la financiarisation, la libéralisation et la privatisation se sont accélérées. Il a été renforcé par l’expansion du processus de mondialisation après l’effondrement du stalinisme. Bien qu’il soit possible de mettre en évidence certaines caractéristiques spécifiques, le néolibéralisme ne doit pas être considéré comme un ensemble de règles fixes, mais comme les politiques telles qu’elles ont évolué au cours d’une période historique.
Le changement de politique appliqué aujourd’hui présente des similitudes avec les méthodes de type keynésien et l’intervention de l’État telles qu’elles étaient appliquées dans les années 1930. Bien que toutes les comparaisons soient imparfaites et qu’un examen plus attentif révèle de nombreuses différences, il y a néanmoins des leçons importantes à tirer. Roosevelt a combiné l’augmentation des dépenses sociales, les travaux d’infrastructure et la création d’emplois. Cela a conduit les dirigeants syndicaux ainsi que les dirigeants du Parti Communiste, qui avait alors une influence considérable, à se rallier à lui. Ces derniers avaient remarqué le changement de politiques, mais au lieu d’exposer que celles-ci visaient à sauver le système, ils ont partagé et répandu des illusions. Aucune des mesures temporaires de Roosevelt ne résolvait les problèmes subjacents de l’économie, et elles étaient combinées à une répression brutale des luttes des travailleurs. Aujourd’hui également, nous devons avertir que le changement de politique par rapport au néolibéralisme ne signifie pas qu’il n’y aura pas de tentatives pour déplacer le fardeau de la crise sur les travailleurs, mais que cela prendra la forme d’une austérité nationale au lieu d’un régime international.
Dans son programme de transition, Trotsky a souligné que le «New Deal» n’était possible que dans un pays où la bourgeoisie réussissait à accumuler des richesses incalculables. Dans de nombreux pays pauvres, on ne peut aujourd’hui rien imaginer de tel. Et pourtant, dans certains d’entre eux, on fait des entorses plus limitées au livre de cuisine néo-libéral. En Inde, le nouveau plan de relance de Modi en octobre visant à stimuler la demande des consommateurs et les dépenses publiques supplémentaires pour les projets d’infrastructure en est un exemple, de même que le plan d’aide d’urgence mensuel du gouvernement brésilien qui a permis de verser des paiements en espèces à 67 millions de familles pauvres depuis avril.
Ces exceptions limitées seront de courte durée et feront bientôt place à des difficultés insupportables si la classe ouvrière ne mène pas de féroces luttes. Mais même lorsque des concessions sont accordées, tout en soutenant avec enthousiasme toute lutte pour la réforme, nous ne pouvons pas nous permettre de partager les illusions inévitables qui en découleront. Nous ferons remarquer que le système capitaliste est usé et que tant qu’il existera, quelle que soit la politique appliquée, il profitera toujours aux riches aux dépens des pauvres. Alternative Socialiste Internationale (ASI, dont le PSL/LSP est la section belge) se joindra aux mouvements à venir et aidera à les construire et à les renforcer en démontrant la pertinence de nos méthodes marxistes et en expliquant patiemment, mais fermement, notre programme pour le renversement du capitalisme et une transformation socialiste de la société.