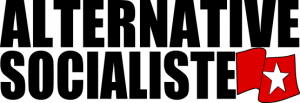Militants pour la journée de 8h en 1856
Ce texte est tiré de la brochure de Claude Larivière Le 1er mai, fête internationale des travailleurs parue aux Éditions coopératives Albert Saint-Martin en 1975. Il s’agit d’une version corrigée de ce rare ouvrage consacré à l’histoire du 1er Mai au Québec.
C’est une constante dans l’histoire des travailleurs de tous les pays où le capitalisme industriel se développe: les patrons cherchent à tirer le maximum de travail de chaque ouvrier, on le faisait travailler jusqu’au bout de ses forces. En Angleterre, des journées de 15 et de 16 heures de travail étaient fréquentes au début de la révolution industrielle. Dans les filatures et les ateliers de tissage, les ouvriers sont au travail dès le lever du petit jour jusqu’à la noirceur. Les femmes et les enfants sont soumis aux mêmes journées de travail. Ces abus criants provoquent la rapide détérioration de la santé de ces travailleurs, qui habitent de véritables taudis et mangent une nourriture peu variée. Pour les entrepreneurs, le vieillissement prématuré ou l’épuisement des ouvriers importe peu puisqu’ils sont interchangeables et qu’il n’a qu’à remplacer les hommes finis par de nouveaux bras. Ce qui l’intéresse c’est qu’on lui fournisse la force de travail dont il a besoin pour produire ces marchandises. L’ouvrier n’est qu’un facteur mécanique de production.
La résistance ouvrière à l’exploitation s’organisa très tôt. Le mouvement pour la réduction des heures de travail n’est qu’un aspect de cette résistance ouvrière qui prit diverses formes selon les pays et les époques (bris des machines, révolte des canuts, chartisme, etc.).
Au Québec, la question des heures de travail fut posée dès le début du 19e siècle par des patrons. Ceux du journal Le Canadien (de Québec) décident, en 1809, d’exiger deux heures de plus de leurs employés, lesquels travaillaient déjà dix heures par jour. Dans la construction, toujours à Québec, deux entrepreneurs monopolisent la plupart des travaux: ils promettent « à leurs ouvriers la somme supplémentaire de 10 pences s’ils acceptent de travailler deux heures de plus par jour. Par la suite ces entrepreneurs retirent les 10 pences tout en maintenant la journée de travail à 12 heures. Cette situation exista jusqu’en 1833 » et est a l”origine de la lutte pour la journée de 10 heures, lutte qui s’organisa en 1833-34 à Montréal et à Québec. Avant cette lutte, la journée de 12 heures, six jours par semaine, était la règle courante chez nous. Ces 12 heures faisaient dire à un travailleur , dans The Vindicator du 1er février 1833, qu’il ne savait pas ce que les entrepreneurs appellent une « juste et honnête journée de travail », mais que lui, après ses 12 heures de travail, et ses 7 heures de sommeil, il ne pouvait pas, le lendemain, faire en 12 heures plus que 10 bonnes heures ».
Certains employeurs traitent durement leurs employés: s’ils s’épuisent au travail, s’ils tombent malades, qu’ils se reposent à leurs frais. Quant au salaire des jours précédant leur maladie, ils devront l’attendre. Les entrepreneurs font la pluie et le beau temps: il est courant à cette époque pour un employeur de payer ses ouvriers quand ça lui plaît; règle générale, l’employeur verse le salaire dans le mois qui suit la journée de travail. Pour les travailleurs qui vivent au jour le jour, qui ne possèdent pas d’épargne, cette situation les force à accepter n’importe quel travail, même mal rémunéré.
Les charpentiers et les menuisiers lancent la lutte en 1833
Le 5 février 1833, la lutte pour la réduction de la journée de travail à 10 heures sans réduction de salaire est lancée à Montréal lors d’une assemblée d’organisation tenue à l’Hôtel Lavoy, rue St-Laurent (quelque part entre Dorchester et Ste-Catherine), par des charpentiers et des menuisiers. Les travailleurs présents y adoptent la résolution suivante:
« 1° C’est l’opinion de cette assemblée que la longueur extrême des journées de travail… est une injure à la santé, une limite à nos droits et libertés de sujets nés libres et doit être l’objet d’une résistance par tous les moyens pacifiques, légaux et constitutionnels en notre pouvoir;
2° Dix heures par jour est le maximum qu’un homme peut travailler « avec justice pour lui-même et pour son employeur »
3° C’est notre opinion que ceux de nos employeurs qui persistent à maintenir les actuelles, longues et esclavagistes, heures de travail sont des ennemis des ouvriers artisans et de la prospérité de la Colonie, en plus de risquer par une telle conduite oppressive d’être la cause du départ de ce pays des meilleurs ouvriers qui émigrent aux États-Unis pour trouver là la rémunération qu’on leur refuse ici…
5° Que le Comité exécutif de cette Société rédige une circulaire à adresser aux employeurs de cette ville les requérant de former une délégation pour rencontrer les porte-parole de notre organisation afin de nous communiquer leur réponse finale à nos revendications et, si c’est leur décision de résister à nos justes demandes, le Comité exécutif devra faire toutes les démarches nécessaires pour organiser une grève générale le 18 mars prochain contre ces employeurs qui refusent d’accepter nos justes demandes.
6° Cette assemblée adresse ses remerciements à la presse libérale de cette cité qui a défendu la cause des travailleurs artisans opprimés.
7° Que le procès-verbal de cette assemblée soit publiée dans le Vindicator, le Herald et La Minerve. William Stroutts, président; Benjamin Howard, secrétaire ».
Deux remarques s’imposent sur les membres de cette assemblée: la majorité d’entre eux sont certainement d’origine anglaise ou irlandaise et leur expérience du chartisme britannique les guide dans l’élaboration d’un programme aussi clair; ils savent exprimer avec vigueur leurs revendications. Par ailleurs la référence à l’appui reçu de la « presse libérale de cette cité » dénote chez ces travailleurs la conscience que leurs intérêts sont associés à ceux des éléments les plus progressistes de la société d’alors, dont les réformateurs et les Patriotes. Quatre ans avant les événements de 1837-38, les ouvriers du Bas-Canada s’affirmaient déjà solidaires des révolutionnaires.
La grève des charpentiers et menuisiers fut un échec en 1833. Un échec relatif puisqu’elle suscita des actions similaires dans d’autres corps de métiers et qu’elle devait conduire à la lutte victorieuse de 1834. Le 5 avril 1833, c’est au tour de la Montreal Mechanics’ Mutual Protecting Association, l’association des ouvriers artisans, à demander à ses membres de faire preuve de solidarité et de ne pas travailler pour un employeur qui ne respecte pas les exigences ouvrières quant aux heures de travail et aux salaires. En décembre 1833, les tailleurs de vêtements employés à la journée s’organisèrent à leur tour et décidèrent d’établir un « Bureau d’Emploi » afin de contrôler l’offre de travail et de forcer les patrons à accepter leurs conditions quant aux heures de travail.
Les entrepreneurs ne restèrent pas passifs devant ces efforts d’organisation de la classe ouvrière. Les officiers des diverses organisations, bien identifiés se voient vite privés de travail. Dans le cas du « Bureau d’Emploi », les patrons publièrent une annonce disant qu’aucun membre de cette organisation ne serait engagé chez eux et qu’ils ouvriraient leur propre bureau d’embauche. Souvent les employeurs recourent à la provocation: délais dans le paiement des salaires gagnés, congédiements massifs… Nombre d’artisans sans emploi pour cause d’activité syndicale doivent ouvrir leur propre boutique pour tenter de survivre.
Le Montreal Trades Union et la campagne de 1834
Le 13 février 1834, à une assemblée des charpentiers et menuisiers (francophones et anglophones) tenue à l’Hôtel Lavoy, on adopte à l’unanimité la résolution suivante: « Que le second lundi de mars 1834 soit le jour à partir duquel la journée de 10 heures entre en vigueur ». D’autres résolutions visent à préciser comment l’organisation agira. P. Clarke, son secrétaire, entrera en relation avec les sociétés de menuisiers de Kingston et de Toronto. Le 21 février, les ouvriers montréalais lancent un appel à « leurs camarades artisans de Québec, New York et des autres villes des provinces (canadiennes) et des États-Unis » afin qu’ils supportent les Montréalais qui se préparent à la grève. La missive ajoute qu’ils doivent « être prudents afin de ne pas se faire engager par des employeurs de Montréal aussi longtemps que durera le désaccord actuel entre employeurs et employés » de cette ville.
Le 28 février 1834, un article signé Union is power, publiée par The Vindicator, nous apprend qu’une assemblée des délégués des divers métiers s’est tenue a l’Hôtel Lavoy afin d’organiser une assemblée publique des ouvriers artisans pour supporter les menuisiers et charpentiers dans leur lutte, car on a appris que les entrepreneurs avaient l’intention d’imposer un lock-out général afin d’ajouter une heure de travail de plus par jour! Le 4 mars, les entrepreneurs-charpentiers et menuisiers publient leur dénonciation de la coalition ouvrière: « une position contre cette coalition doit être adoptée et c’est pourquoi à compter du 1er avril, une journée de travail consistera en 11 heures de travail » (excluant le temps des repas). Les patrons ajoutent que leurs employés sont parfaitement satisfaits de telles conditions.
Quoiqu’il en soit, trois entrepreneurs, MM. Brownley, Holmes et Jones capitulèrent et signèrent un accord avec les organisations ouvrières. Pendant ce temps, les tailleurs de pierre, les maçons, les boulangers, les tailleurs et les ouvriers de la chaussure s’organisent: la Montreal Trades Union prend forme. C’est le premier regroupement d’organisations ouvrières du Canada. Le Montreal Trades Union se définit alors comme l’organe de la classe ouvrière de Montréal et des villages environnants organisés en un syndicat pour préserver leurs droits et pour l’avancement de leurs intérêts dans la société ». Le 12 mars 1834, toujours à l’Hôtel Lavoy, les maçons et les tailleurs de pierre s’entendent pour refuser de travailler plus de 10 heures par jour après le premier d’avril 1834. L’Hôtel Lavoy devient The Mechanics’ Hall, la Maison des Artisans-ouvriers.
Tout cela se fait au grand déplaisir des patrons qui ragent d’impuissance. Ils voudraient bien écraser ce mouvement. Les journaux conservateurs, les journaux de la « clique », défendent leur point de vue alors que la presse libérale et patriote supporte celui des ouvriers. En mai 1834, les tailleurs d’habits employés à la journée se mettent en grève à leur tour. Ils informent alors leurs employeurs et le public qu’on peut les engager aux conditions qu’ils ont fixées, à la Maison des Artisans-ouvriers. Cinq marchands-tailleurs acceptent leurs demandes dans les jours qui suivent. La grève se poursuivra chez les autres jusqu’en juillet. La victoire ne sera que partielle dans ce cas. Les 7 marchands-tailleurs qui résistent annoncent, le 28 juillet 1834, que la grève de leurs ouvriers sous la coalition de leur syndicat est terminée »… grâce au support reçu des membres de la « clique » qui leur permet « de résister aux conséquences injurieuses de toute soumission à cette puissante coalition ouvrière ». La conscience de classe est aussi affirmée chez les bourgeois que chez les travailleurs.
Le Montreal Trades Union, organisation représentative des 300 ouvriers montréalais du début des années ’30, n’obtint pas un plein succès dans sa campagne pour faire des 10 heures la journée de travail normale. Mais sa victoire partielle, à une époque où la classe ouvrière prend forme, est déjà un acte d’importance. Un acte qui mérite d’être souligné.
Les travailleurs irlandais des canaux en 1843
Après l’Acte d’Union le nouveau gouvernement, utilisant des fonds britanniques, entreprit la construction de canaux devant relier Montréal aux Grands Lacs. Deux de ces canaux, celui de Lachine (qu’on reconstruisait) et celui de Beauharnois sont au Québec. Près de 1 600 travailleurs sont employés sur le chantier de Lachine et 2 500 sur le chantier de Beauharnois; presque tous sont des prolétaires irlandais immigrés depuis peu. La journée de travail est de 6 heures du matin à 6 heures du soir, soit 12 heures, moins deux heures pour les repas. À six jours par semaines, ces ouvriers font 60 heures de travail. De dur travail, au pic et à la pelle. Leur salaire est de 3 shillings par jour. Ce régime est celui instauré par le Bureau des Travaux publics, ministère du gouvernement du Canada-Uni. En janvier 1843 le gouvernement confie les travaux à des entrepreneurs afin d’en limiter le coût. Les entrepreneurs cherchent plus à réaliser des profits sur le dos des travailleurs qu’à effectuer les travaux. Les 1 300 hommes engagés à Lachine à ce moment le furent sans connaître les conditions de leur embauche. Ils s’attendaient à ce que les conditions soient les mêmes qu’avant. Or, les entrepreneurs fixèrent les salaires à 2 shillings par jour payable mensuellement, en comparaison des 3 shillings payés bimensuellement en 1842 par le Bureau des Travaux publics. Ce fut seulement à l’occasion de leur première paye, le 24 janvier 1843, que les travailleurs découvrirent leur taux de salaire et apprirent aussi que la rémunération n’était utilisable que comme crédit au magasin des entrepreneurs. Les travailleurs irlandais se mirent en grève dès ce soir là et, le lendemain matin, l’affiche suivante fut trouvée à la barrière à péage du chemin de Lachine: « Toute personne ou toutes personnes qui travaille ici, au canal Lachine, à moins de 3 shillings et 6 pences par jour peuvent apporter leur cercueil et porteurs; et l’heure à laquelle ils doivent commencer est 7 heures du matin, jusqu’à 5 heures dans l’après-midi et personne ne tentera de travailler avant que ces salaires ne soient accordés et que tous les hommes s’entendent là-dessus parce que nous n’acceptons pas cette forme d’exploitation. Toute personne ou toutes personnes qui tentera d’enlever cet avis connaîtra la même mort que celle annoncée plus haut ». Le creusage des canaux est un travail épuisant. Selon des témoins, même des chevaux ne résistent pas à la tâche. Pourtant, les travailleurs acceptent de faire un compromis: « si les salaires payés en hiver sont les mêmes que ceux payés en été :3 shillings) nous sommes disposés à travailler du lever au coucher du jour, sans prendre l’heure habituelle pour le dîner » tant que l’hiver durera.
Cette première grève déboucha sur un compromis reposant sur la promesse d’une augmentation de salaire. Quand les travailleurs se rendirent compte que cette promesse ne serait pas tenue, ils se mirent de nouveau en grève le 1er juin. Cette nouvelle grève fut étouffée dans le sang par l’armée, à Saint-Timothée. Ce sera là le plus grand massacre de travailleurs de l’histoire du syndicalisme et des luttes ouvrières, au Québec et au Canada. Une vingtaine de travailleurs furent tués et une trentaine d’autres blessés, le soir du 11 juin 1843. Ce n’est pas notre tâche, dans cette publication, de raconter en détail la lutte de ces hommes courageux sur lesquels s’abattit une violente répression. Il nous faut cependant souligner que la longueur de la journée de travail fut toujours, de janvier 1843 à décembre 1844, un motif de revendication chez ces travailleurs et qu’à chacune de leurs grèves ils invoquent, entre autres, ce motif.
Les débardeurs de Québec et la journée de 8 heures
Les débardeurs de Québec sont formés en société de bienveillance depuis 1862. Leur association tire sa puissance de leur nombre, ils ont plus de 2 500, et de la fébrile activité du port de Québec en ces années. Ses membres, en très grande majorité des travailleurs irlandais, font preuve d’une solidarité assez peu fréquente à l’époque. En 1866, la Ship Laborer’s Benevolent Society décide de fixer une échelle de salaire et des conditions de travail; après une longue et dure grève, l’organisation ouvrière obtient gain de cause. L’article 26 de l’entente conclue avec les arrimeurs se lit comme suit: « la journée de travail est de huit heures. Elle commence à 7 heures. On consacre une heure pour le petit déjeuner, et une autre pour le dîner ». Voilà qui est vraiment exceptionnel, au Canada, pour l’époque! Car il faut attendre 1872 pour que s’organise à travers le Canada, et en particulier dans les centres urbains (Toronto, Kingston, Ottawa, Montréal), la campagne visant à limiter à 9 heures la journée de travail. Les journaux montréalais de mars 1872 nous informent en effet « que les ouvriers de Montréal, réunis en assemblée publique se sont formés en une association sous le nom de Ligue ouvrière de Montréal pour obtenir la réduction à 9 heures, affirment unanimement que la question du travail de 9 heures est devenue d’une nécessité urgente ». Des délégués de différentes villes du Haut-Canada assistaient à cette assemblée.
À Toronto, l’agitation du mouvement pour la journée de 9 heures fut beaucoup plus grande. L’organisation ouvrière locale, fondée en 1871, la Toronto Trades Assembly prit cette lutte en mains. Le patronat fit arrêter certains leaders ouvriers qui entendaient imposer leur objectif au patronat par le moyen de la grève en les accusant de « conspiration visant à restreindre le commerce », en violation de la Common Law. ll faut rappeler que le syndicalisme n’a aucune reconnaissance légale au Canada en 1872 et, qu’au contraire, toute coalition ouvrière constitue une violation de la loi qui garantit la « liberté de commerce ». C’est d’ailleurs pourquoi les syndicats se font appeler « société de bienveillance mutuelle » plutôt que « union » ou « syndicat ».
Devant l’agitation faite autour de la journée de 9 heures et de l’arrestation des leaders ouvriers, le premier ministre John MacDonald décide d’imiter le parlement britannique qui, en 1871, a adopté une loi soustrayant l’action syndicale des dispositions du Common Law portant sur la restriction de la liberté de commerce. Le geste de MacDonald n’a rien de révolutionnaire, c’est tout au plus une mesure qui vise à s’assurer une certaine popularité dans les milieux ouvriers dont l’importance augmente sans cesse dans les centres urbains. Les cabaleurs de son parti ne manqueront pas de rappeler ce geste à chaque scrutin. Et pourtant cette mesure ne changea guère la condition ouvrière…