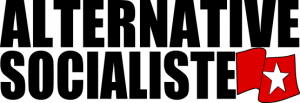Une analyse matérialiste de l’origine et de la nature de l’oppression des femmes.
Le marxisme est une philosophie et un point de vue sur le monde qui cherche à analyser la réalité concrète à partir de faits matériels. Bien qu’il n’était pas possible pour Marx et Engels, à eux seuls, de se pencher de façon adéquate sur l’ensemble des questions liées à l’oppression (tout comme ils n’ont pas pu se pencher dans leurs écrits spécifiquement sur d’autres thèmes importants), ils ont tout de même beaucoup écrit sur l’oppression des femmes, sur l’oppression raciale – liée à l’esclavage et à l’impérialisme – et sur l’oppression des minorités nationales, comme celle de la nation irlandaise dans le cadre de l’Empire britannique.
Alors que bien souvent, le marxisme est présenté de façon réductrice par certains groupes politiques ou intellectuels qui le réduisent à un déterminisme économique simpliste, cette interprétation est complètement à l’opposé du vrai marxisme. En effet, ce sont les outils du marxisme qui nous permettent aujourd’hui de développer une analyse complexe et scientifique qui prend en compte tous les aspects d’un même problème, par exemple lorsqu’on analyse la nature et l’origine des différentes formes d’oppression qui existent au sein de la société capitaliste moderne. Ce sont aussi les outils du marxisme qui nous donnent les moyens d’organiser la lutte et finalement d’en finir avec les rapports de forces sociaux qui génèrent la victimisation, la discrimination et l’oppression.
L’Origine de la Famille
En ce qui concerne l’oppression des femmes, Engels a apporté une contribution autant inestimable que révolutionnaire avec son ouvrage « L’Origine de la famille, de l’État et de la propriété privée ». La conclusion la plus importante de ce travail est que l’oppression des femmes, bien qu’elle existe depuis des milliers d’années, n’est pas quelque chose d’inévitable, d’immuable, ordonnée par Dieu ou découlant de la nature des hommes. Engels parle notamment de l’existence de sociétés primitives dans lesquelles les femmes sont tenues en haute estime, où les classes sociales n’existent pas, dans lesquelles tout membre est essentiel à la survie et à la prospérité du groupe tout entier. Il y décrit le lien qui existe entre l’institution de l’oppression systématique et séculaire des femmes et la société de classes. En effet, le développement de l’agriculture a permis de libérer une petite partie de la population du travail productif, qui s’est ensuite constituée en élite au sommet de la société. Petit à petit, la perpétuation de cette division du travail en classes sociales s’est retrouvée liée à la transmission de la propriété privée via la lignée mâle, qui ne pouvait être garantie que par l’assujettissement des femmes.
Ce développement tire son origine de la division genrée du travail, qui était souvent une caractéristique des sociétés de chasseurs-cueilleurs, bien que cette division n’était pas forcément hiérarchisée. Mais à partir du moment où la propriété privée (des outils, de la terre, etc.) a commencé à être transmise en suivant la lignée mâle, il est apparu nécessaire d’instaurer des contrôles sur la sexualité des femmes : c’est le modèle de famille patriarcale qui s’est imposé, car il convenait le mieux à cette fin. Contrairement donc à la théorie de la “patriarchie” anhistorique (qui fait abstraction du passé) selon laquelle les hommes auraient “naturellement” pris le pouvoir sur les femmes, les marxistes ont une vision plus positive de cette question. Ils placent ces discussions dans le contexte de la lutte pour une société socialiste, sans classes sociales. Celle-ci doit, par nature, constituer une lutte pour une société libérée de toute forme de division et ainsi faire disparaître la base économique de l’oppression des femmes (et donc, graduellement, les expressions culturelles de cette oppression).
Lorsque Marx et Engels se sont penchés pour la première fois sur la question de la famille nucléaire sous le capitalisme, ils l’ont perçue comme un élément crucial à la transmission de la propriété privée pour la classe dominante. À l’époque de Marx, les femmes qui travaillaient dans les usines souffraient tellement de leur travail pendant leur grossesse, après l’accouchement et pendant l’allaitement, que cela nuisait à la santé et à la productivité de l’ensemble de la force de travail. Dans ces circonstances, même la classe ouvrière s’opposait à la dissolution de la famille nucléaire puisque cette institution permettait, en l’absence de toute couverture sociale, aux femmes de bénéficier du revenu de leur mari aux moments où elles étaient trop vulnérables pour pouvoir elles-mêmes travailler. Tout ceci a donc encouragé la promotion de la famille nucléaire par la classe dirigeante afin d’assurer, du point de vue des patrons, que les femmes jouent un rôle dans la reproduction et l’éducation d’une main d’œuvre vigoureuse et en bonne santé, ingrédient essentiel pour le maintien de leurs profits.
Ce rôle de “reproduction sociale” pour le capitalisme demeure une des principales bases économiques de l’oppression des femmes aujourd’hui, puisque nous voyons que de nos jours encore, sur tous les continents, ce sont les femmes qui accomplissent la grande majorité du travail domestique non payé. Ce rôle a également été utilisé par le capitalisme en tant qu’outil de contrôle social et continue à être utilisé en tant que moyen de promotion des fonctions genrées les plus arriérées tout en assurant l’assujettissement des femmes.
En Irlande, l’État capitaliste, qui reste faible, s’est reposé, dès sa fondation, sur la puissance et l’autorité de l’Église catholique. Aujourd’hui, cette alliance réactionnaire entre Église et État n’est toujours pas brisée. L’idéologie religieuse joue un rôle parfois extrême dans tout ce qui touche aux soins de santé et à la loi, comme on le voit avec l’interdiction constitutionnelle de l’avortement ou l’affirmation – même par un responsable des Nations-Unies – qu’au regard de la loi, les femmes ne sont rien de plus que des « incubateurs ». Le modèle de la famille nucléaire “traditionnelle” est cependant grandement remis en question puisqu’on voit que la majorité de la population participe en réalité à d’innombrables types d’arrangements familiaux divers et variés. Les couches les plus clairvoyantes de la classe dirigeante tolèrent cet état de fait, tant que le rôle de “reproduction sociale” par l’institution familiale est assuré. Mais avec la politique d’austérité appliquée par l’élite dirigeante à travers toute l’Europe, favorisant un démantèlement et une privatisation croissante des services publics, le poids du rôle de reproduction sociale au sein des familles empire pour les femmes et l’ensemble de la classe ouvrière.
L’entrée massive des femmes dans la force de travail a été un immense facteur de progrès, qui a contribué à élever la confiance et les attentes des femmes. Aux États-Unis, durant la période d’après-guerre, les médias et notamment la publicité ont consciemment œuvré à promouvoir le modèle de la famille nucléaire et le rôle de la femme au foyer, financièrement dépendante de son mari et qui avait la charge de nourrir la famille. Aujourd’hui, les médias et l’immense industrie du sexe misent plutôt sur l’objectification sexiste du corps féminin. Au cours des années ’50 aux États-Unis, il s’agissait d’une contre-attaque idéologique à la suite du progrès accompli par les femmes en tant que partie prenante de la force de travail au cours de la guerre. Aujourd’hui, l’objectification des femmes est un sous-produit de la soif de profits de la majeure partie de la grande industrie. Cela n’est forcément pas sans conséquence sur la position des femmes dans la société. Dans ces deux cas, malgré leurs différences, le même résultat est obtenu : la promotion d’idées sexistes qui contribuent à l’oppression et à la violence contre les femmes.
Les théories de l’identité politique
Les théories de l’“intersectionnalité” et du “privilège” (expliquées ci-dessous) peuvent être considérées comme faisant partie de toute la panoplie d’arguments qui constituent la théorie de l’“identité politique ». Cela fait à peu près vingt ans que cette théorie vit au sein d’une partie (relativement isolée) de la gauche américaine et, via les deux concepts susmentionnés qui sont aujourd’hui particulièrement populaires, parmi la nouvelle génération de militant·e·s irlandais·es actifs·ves dans le mouvement pour le droit à l’avortement et dans de nombreux pays où grandit une résistance contre le sexisme sous ses diverses formes comme le sexisme médiatique, le harcèlement de rue, la violence sexuelle et conjugale. On la retrouve également régulièrement dans le mouvement LGBTQI.
La théorie de l’identité politique peut être définie comme une analyse qui considère la société comme étant composée de différents “groupes d’intérêts”. Parfois, ces groupes d’intérêts se croisent ou se chevauchent les uns les autres, mais il manque un cadre global qui permette d’analyser la société dans son ensemble. L’utilisation généralisée des réseaux sociaux, notamment par toutes celles et ceux qui veulent combattre l’inégalité et l’oppression, permet d’expliquer que, pour la plupart des femmes politisées ou actives contre le sexisme, ces théories ont déjà été vues et entendues sous une forme ou sous une autre.
Les théories de l’intersectionnalité et du privilège proviennent généralement de la “troisième vague du féminisme” (ou “postféminisme”) des années ’80 et ‘ 90. Ces mouvements se sont davantage concentrés sur la féminisation de l’élite dirigeante plutôt que sur les luttes des mouvements pour les droits des femmes. Il s’agissait ainsi d’un important recul provenant de l’illusion selon laquelle le système capitaliste serait capable d’apporter l’égalité et la liberté pour les femmes. À cette époque, la crise du capitalisme des années ’70 et ’80 avait révélé la faillite du réformisme de la direction syndicale et de la direction du Parti travailliste. Ces dernières se sont positionnées aux côtés du système, ce qui a mené à des défaites et des reculs. Cela coïncide avec l’émergence de la doctrine néolibérale du capitalisme, avec l’effondrement du stalinisme et avec l’affirmation des capitalistes selon laquelle la “fin de l’Histoire” – c’est-à-dire la fin de la lutte des classes – était arrivée.
Cette période de défaites a mené à un recul très important de la conscience de classe et de l’autorité du mouvement ouvrier. Le néolibéralisme était seul maître à bord, que ce soit sur le plan économique ou politique. D’importantes attaques ont été menées contre les syndicats en même temps que déferlaient privatisations, contrats à court terme, emplois sous-payés, désindustrialisation et un grand panel de mesures supprimant tout obstacle au profit. C’est à cette époque également qu’est apparu le petit cousin idéologique du néolibéralisme : le postmodernisme.
Le postmodernisme
Le postmodernisme est le rejet de tous les “grands récits”, de toute tentative de développement d’une analyse et d’un point de vue global. Selon le postmodernisme, on ne peut réellement connaitre et analyser la réalité objective dans sa totalité. Il s’agit d’une analyse de l’oppression se basant sur un idéalisme majoritairement personnel et subjectif. Bien entendu, les opinions et les expériences personnelles de tou·te·s les opprimé·e·s sont extrêmement importantes. Mais afin d’avoir un aperçu correct de la nature et des causes de l’oppression, en plus d’être à l’écoute de la voix des opprimé·e·s, il faut une analyse matérialiste des forces sociales à l’œuvre, qui sont à la source de cette oppression. Ainsi, nous avons besoin d’une vision claire, c’est-à-dire d’un programme et de méthodes justes pour lutter et parvenir à vaincre l’oppression sexiste.
Il est vrai que la plupart des courants “d’identité” rejettent consciemment le féminisme libéral ou bourgeois – c’est-à-dire un féminisme entièrement cautionné par le capitalisme, qui ne cherche à obtenir des changements que s’ils s’insèrent dans le cadre donné par ce système, qui porte surtout une attention à la féminisation de l’élite dirigeante, qui veut plus de patronnes et de politiciennes femmes tout en se maintenant dans ce système de profits, qui est pourtant la cause de l’inégalité et de l’oppression. Néanmoins, cette attention portée sur le caractère individuel, voire personnel du problème – également inhérent à la politique d’identité, bien que d’une autre manière – ne remet pas en question le statu quo. Dans le rejet des “grands récits”, il n’y a aucune critique globale de la manière dont le système perpétue le racisme, le sexisme et l’homophobie.
Nancy Fraser – une intellectuelle féministe de gauche qui dénonce la manière dont le mouvement féministe est à ses yeux devenu la “bonniche du capitalisme” – déplore cette transition “identitaire”. Nancy Fraser exagère sans doute l’ampleur de la politique socialiste et de l’idée de lutte des classes dans le mouvement féministe des années ’60 et ’70 – bien qu’il soit certain que cette vision des choses ait joué un grand rôle dans ce mouvement. Néanmoins, les critiques exprimées par celle-ci sur ce qui est advenu de ce mouvement féministe sont extrêmement éclairantes :
« Tandis que la génération de ’68 espérait, entre autres, restructurer l’économie politique de sorte à abolir la division genrée du travail, les féministes qui ont succédé ont formulé d’autres buts moins matériels. Certaines cherchaient, par exemple, à obtenir une reconnaissance de la différence sexuelle, tandis que d’autres préféraient déconstruire l’opposition catégorique entre masculin et féminin. Le résultat a été un déplacement du centre de gravité du mouvement féministe. Alors qu’il se concentrait sur le travail et sur la violence, les luttes féministes aujourd’hui parlent de plus en plus d’identité et de représentation… Le tournant dans le mouvement féministe en faveur de la “reconnaissance” va clairement de pair avec l’hégémonie du néolibéralisme, qui veut avant tout faire disparaitre tout souvenir de l’idéal socialiste. » (Les Fortunes du féminisme : du capitalisme d’État à la crise néolibérale, 2013)
Nancy Fraser oppose cette approche à son propre modèle de reconnaissance / redistribution : la remise en question des aspects économiques de l’oppression des femmes et celle de ses aspects culturels (tels que le manque de reconnaissance) doivent inextricablement être liées afin de pouvoir combattre efficacement l’oppression des femmes. Pour les marxistes, cela constitue le b.a.-ba de la lutte pour l’émancipation des femmes et il est positif qu’une féministe célèbre aille dans ce sens. Prenons un exemple. En Irlande, la lutte pour les droits reproductifs ne peut pas être complète si elle se concentre uniquement sur les aspects légaux. On ne peut oublier le fait que le système des soins de santé est non seulement entre les mains de l’establishment catholique avec sa vision arriérée des femmes et de la reproduction, mais qu’il est également gravement sous-financé, ce qui fait que son personnel est clairement dépassé par le nombre de patient·e·s, causant des souffrances inutiles à celles qui accouchent dans les hôpitaux publics.
La lutte pour les droits à la reproduction doit donc être liée à la lutte pour un service public de soins de santé progressiste, laïc, moderne et totalement gratuit. Vu la faiblesse du capitalisme irlandais (celui-ci étant très fortement axé sur le néo-libéralisme à l’anglo-saxonne), la politique d’austérité actuelle, ainsi qu’une tendance continue vers un modèle privatisé des soins de santé et l’inexistence totale d’un véritable service public de ces soins pour sa population, il est aujourd’hui plus que jamais nécessaire de lutter pour une alternative à ce système. Cela veut dire remettre en question la propriété privée des moyens de production et des capitaux afin de placer ces ressources au service de la population sous contrôle démocratique des travailleurs. Cela permettra de développer un service de santé public démocratique et accessible à tous.
Une approche de classe
Un enjeu important pour les théories de l’identité politique est de pouvoir définir et caractériser l’oppression et, dans le cas de l’intersectionnalité, d’analyser la manière dont les différents types d’oppressions interagissent entre eux. Il est vrai que nous pouvons tirer beaucoup de précieuses informations de cette réflexion afin d’étayer et d’enrichir notre analyse socialiste. À ce sujet, on caricature souvent les marxistes et les socialistes en les représentant comme obsédé·e·s par la question des classes sociales. Il est clair que pour les socialistes, la division de la société en classes sociales est cruciale et est la clé de toute analyse de la société.
Il existe en effet une classe dirigeante, qu’on appelle souvent aujourd’hui celle des « 1 % ». C’est un tout petit groupe de gens qui détient la majorité des richesses et des moyens de production, grâce auxquels ils et elles réalisent leurs profits. Et puis, il y a l’autre grande classe dans la société, celle des travailleurs·euses (ou classe prolétaire). La définition large de cette classe est qu’elle regroupe l’ensemble des “esclaves salarié·e·s”, c’est-à-dire toutes les personnes contraintes à vendre leur force de travail pour pouvoir vivre. Leurs familles, qui dépendent de leur salaire, les pensionné·e·s et les chômeurs·euses font également partie de cette classe sociale.
Enfin, il y a les couches moyennes (la “petite-bourgeoisie”, mais aussi la paysannerie, les artisan·ne·s, les petit·e·s et moyen·ne·s commerçant·e·s, les indépendant·e·s, etc.) qui balancent entre ces deux grandes classes et qui participent au conflit entre les classes en se rangeant tantôt d’un côté, tantôt de l’autre. Notons que, de manière générale, non seulement la classe des travailleurs·euses est aujourd’hui la plus grande classe de la société à l’échelle mondiale, mais elle s’accroît constamment au fur et à mesure que les paysan·ne·s chinois·es et indien·ne·s quittent leurs campagnes pour aller chercher du travail en ville, que les femmes du monde entier rejoignent les forces de production et que les petit·e·s commerçant·e·s et artisan·ne·s cèdent la place à la grande distribution et à l’industrie.
La classe des travailleurs·euses est la force la plus puissante dans la société, pour peu qu’elle soit unie et consciente. Nous avons vu cela à de nombreuses reprises dans l’histoire. En effet, en cas de grève, les profits ne sont plus réalisés et la société tout entière peut se retrouver paralysée si les travailleurs·euses le décident, car c’est eux et elles qui occupent les positions les plus importantes dans l’économie et dans la société. Par exemple, en Égypte, après des semaines d’occupation de la place Tahrir, c’est la grève générale qui a porté le coup fatal à Moubarak. Malheureusement, l’absence d’une force socialiste et le faible niveau de la conscience de classe ont limité la portée du mouvement révolutionnaire égyptien et la contre-révolution a pris le dessus. Toutefois, le processus révolutionnaire est toujours en cours de développement et il est clair que de nouvelles luttes vont se développer. Cependant, l’Égypte illustre bien le fait que nous devons constamment organiser et bâtir la conscience et la force de notre classe sociale.
La classe des travailleurs·euses n’est pas homogène. Elle est composée d’une myriade d’individus dont l’expérience, l’attitude et le degré d’exploitation diffèrent largement. Il est crucial de bien comprendre la nécessité d’avoir un programme ainsi que des organisations syndicales et politiques qui unifient l’ensemble de la classe des travailleurs·euses au-delà de ces divisions. En Irlande, c’est le manque d’unité qui a permis à la politique d’austérité de passer. Cette politique a directement aggravé les conditions de vie des femmes, qui forment la majorité des travailleurs·euses précaires et des utilisateurs·trices des services publics. La direction bureaucratique des syndicats n’est pas parvenue à s’opposer à la division entre travailleurs·euses du secteur public et du privé. Celle-ci est attisée par les politicien·ne·s et les médias et leur volonté de s’engager dans un modèle de “conciliation sociale”. Mais cette dernière ne permet pas de reconnaître les intérêts fondamentalement opposés entre la classe dirigeante et la classe des travailleurs·euses.
Le fait que la division en classes sociales soit pour nous la question centrale ne veut pas dire que nous refusons de reconnaître qu’il existe d’autres formes particulières d’oppression. Mais seule une classe des travailleurs·euses consciente, organisée et unie a la puissance de combattre le système d’oppression qu’est le capitalisme. La classe dominante doit maintenir coûte que coûte cette oppression parce que cela permet de diviser les travailleurs·euses, d’empêcher leur unité dans la lutte et ainsi d’en tirer des profits. Cette lutte est la forme la plus efficace de résistance contre la classe dominante qui possède non seulement le pouvoir économique, mais aussi le pouvoir politique et idéologique. Elle a également à son service non seulement un appareil d’État, qui détient le monopole légal de la violence (police, armée, etc.), mais aussi des médias qui diffusent constamment son idéologie.
Si on prend l’exemple d’une travailleuse confrontée à une domination abusive de son conjoint, il est probable que, de son point de vue, son oppression en tant que femme est le premier et le plus grand obstacle à son émancipation ainsi que la plus grande source de malaise dans sa vie à ce moment-là. Le fait qu’elle soit une femme de la classe des travailleurs·euses est néanmoins tout aussi important. Par exemple, s’il s’agit d’une travailleuse disposant de faibles revenus, cela limite ses options et ses choix. Il lui sera plus difficile de quitter ce conjoint pour aller mener sa propre vie. D’un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que travailler à l’extérieur de la maison permet de fréquenter d’autres personnes qui se trouvent dans la même position. Son travail en dehors du domicile familial peut alors accroître son sentiment de confiance en soi. En tant que travailleuse, elle dispose d’une force potentielle qui lui permet de faire grève avec ses collègues et d’apprendre à construire une unité de classe et une solidarité, qui peut rejaillir sur sa confiance en elle et sur sa capacité à trouver les outils nécessaires pour sortir de cette relation abusive.
Puissance, privilège et oppression
Les socialistes reconnaissent le fait que c’est l’ensemble des femmes qui sont opprimées, y compris les femmes de classes sociales supérieures (on peut dire la même chose des personnes dites “de couleur” ou des LGBTQI). Bien sûr, la classe des travailleurs·euses et les couches les plus pauvres de ces groupes opprimés souffrent, en général, de manière plus intense de cette oppression bien que de nombreuses femmes de la bourgeoisie sont également tuées ou violées par leurs partenaires ou ex-partenaires. On a beaucoup parlé par exemple du cas de Reeva Steenkamp, une riche femme sud-africaine, assassinée par son petit ami Pistorius. Beaucoup de gens connaissent aussi l’histoire d’Oprah Winfrey, qui est aujourd’hui une des femmes les plus riches du monde, mais qui, en tant que jeune femme noire, a souffert horriblement d’un viol, d’une grossesse précoce et d’une misère affligeante pendant toute sa jeunesse. Toute oppression doit être combattue. Mais il faut cependant bien se rendre compte que O. Winfrey, avec son salaire de 75 millions de dollars en 2013, a forcément un intérêt dans le maintien du statu quo social et a donc très peu de chances d’être convaincue de la nécessité d’une lutte radicale pour en finir avec toutes les oppressions.
Il ne fait aucun doute que certaines couches des classes moyennes qui sont actives dans les mouvements féministes ou dans les mouvements LGBTQI peuvent être convaincues de rejoindre la lutte radicale contre le capitalisme. Mais une caractéristique primordiale de la classe sociale à laquelle l’individu appartient est le fait qu’elle contribue fortement à définir sa vision du monde. Par exemple, au Royaume-Uni, les suffragettes bourgeoises du début du XXe siècle ont fini par s’opposer au mouvement des travailleurs·euses pour ensuite applaudir les puissances impérialistes lors de la Première Guerre mondiale. Ainsi, lorsque ce type de mouvements se retrouve confronté à une question tactique ou sociale décisive, leur positionnement reflète généralement cette fracture de classe. Dans le cas des suffragettes, leurs membres issues de la bourgeoisie ont été entraînées par la propagande guerrière diffusée par leur propre classe.
À contrario, Sylvia Pankhurst a rompu avec le mouvement des suffragettes, dirigé par sa mère et ses sœurs, précisément sur base de cette question. Elle a alors choisi de se ranger du côté de la classe des travailleurs·euses et contre l’élite impérialiste de son pays. L’appartenance à une classe est donc plus qu’une simple question d’identité et de discrimination sociale face à tel ou tel groupe (c’est plus que le “classisme” dont on parle souvent parmi les groupes “identitaires”). Il s’agit d’une réalité objective et d’une fracture sous-jacentes à tous les autres aspects de la société de manière fondamentale.
Il faut également considérer le fait que les couches qui sont opprimées de la façon la plus absolue sont tellement écrasées par une myriade de choses abominables dans tous les aspects de leur vie qu’il n’est pas si évident qu’elles puissent diriger un mouvement social en vue du changement de société. On pense par exemple aux enfants victimes d’abus sexuels ou aux victimes de trafics sexuels qui sont littéralement réduites à l’esclavage dans le cadre de réseaux mafieux. Bien entendu, ces personnes représentent la section la plus opprimée au sein de la classe des travailleurs·eises, qui est elle-même large et hétérogène.
La grève des mineurs au Royaume-Uni
Les exemples des puissantes luttes des travailleurs·euses dans le passé sont souvent considérés comme des points de référence pour les couches opprimées de la société de manière générale. Lors de la grève des mineurs au Royaume-Uni, une partie extrêmement puissante et bien organisée de la classe des travailleurs·euses a été prise pour cible par Thatcher et son gouvernement capitaliste néolibéral, ce qui a déclenché une lutte de résistance héroïque. Les mineurs ont représenté une source d’inspiration majeure par leur contre-attaque contre tout ce que Thatcher représentait, c’est-à-dire la course aux profits à tout prix des capitalistes et la destruction de toute solidarité des travailleurs·euses ou de toute organisation capable d’y faire obstacle.
De nombreuses femmes de la classe des travailleurs·euses – les épouses, les mères, les sœurs et les filles des mineurs en grève – ont joué un rôle très important dans la guerre de classe épique qui s’en est suivie. Au même moment, Thatcher signait des lois homophobes qui ont poussé la communauté LGBT à se ranger derrière les mineurs, tout comme d’ailleurs les communautés noires et asiatiques. Les travailleurs en grève sont devenus la référence absolue pour tous les groupes opprimés qui ont alors uni leurs différentes luttes derrière cette bannière, plutôt que de poursuivre celles-ci de manière isolée – ce qui aurait facilité leur répression par la classe dirigeante.
Lors de cette lutte, on a également vu un changement important de l’attitude de nombre de mineurs par rapport aux femmes, tout comme par rapport aux homosexuel·le·s, aux Noir·e·s et aux Asiatiques qui les soutenaient. Ainsi, ils voyaient sous un jour différent celles qui étaient devenues des organisatrices et des militantes de la lutte des classes, les respectant davantage, tout en comprenant mieux les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans leur foyer. De nombreux mineurs ont donc commencé à s’occuper des tâches domestiques et de la garde des enfants tandis que les femmes organisaient des meetings et des actions de solidarité tout au long de la lutte. Ce conflit de classes a également provoqué toute une série de divorces et de séparations, vu que de nombreuses femmes, ayant gagné en confiance, attendaient désormais plus de la vie qu’une relation malheureuse.
Le pouvoir
L’analyse de Michel Foucault du « pouvoir » se retrouve derrière une grande partie de la théorie de l’identité politique. Foucault était un intellectuel de gauche démoralisé par la défaite de Mai 68 en France et qui a ouvert la voie à la pensée postmoderne. Selon Foucault, le pouvoir se retrouve à tous les niveaux de la société. Mais il refuse de reconnaître que le plus grand pouvoir dans la société est celui de la classe dirigeante, issu de sa propriété privée des moyens de production : un pouvoir exprimé par l’État, par le contrôle des idées propagées dans la société, etc.
Nous ne sommes pas d’accord non plus avec l’idéalisation de la classe des travailleurs·euses prônée par certaines organisations de gauche radicale. Ainsi, selon l’Organisation socialiste internationale aux États-Unis (ISO) ou selon la Tendance socialiste internationale (IST, dont la section la plus connue est le SWP britannique), il n’y a pas de différence de pouvoir au sein de la classe des travailleurs·euses elle-même. Ces organisations ont en particulier tendance à affirmer de façon franche et crue que les hommes de la classe des travailleurs·euses ne bénéficient pas de l’oppression des femmes, mais que seule la classe dirigeante en bénéficie. Citons par exemple Paul D’Amato (de l’IST) :
« Atomisé·e·s et séparé·e·s, incité·e·s à une concurrence violente les un·e·s contre les autres, les travailleurs·euses sont impuissant·e·s. Ainsi, lorsqu’un homme de la classe des travailleurs·euses abuse de sa femme, il n’agit pas parce qu’il possède un pouvoir sur elle ; au contraire, c’est le reflet de son impuissance, de sa faiblesse. Lorsqu’un·e travailleur·euse blanc·he agit de manière raciste envers un travailleur·euse noir·e, ce qui s’exprime n’est pas le pouvoir du ou de la travailleur·euse blanc·he sur le ou la noir·e, mais le pouvoir du système qui les broie tou·te·s les deux. »
Il s’agit pour nous d’une véritable sous-estimation de la situation. Est-il vraiment possible d’affirmer que lorsqu’un groupe d’hommes ‘en virée’ décide d’acheter le corps d’une femme pour en ‘disposer’ sexuellement, ils agissent par impuissance ? En réalité, ce faisant, ces hommes objectifient un être humain et soumettent sa sexualité et ses aspirations à la leur. Et en général et en moyenne, les hommes de la classe des travailleurs·euses tirent eux aussi un certain bénéfice de l’oppression des femmes. Cela signifie pour eux non seulement plus de temps libre chaque semaine, mais aussi moins d’énergie dépensée en tâches ménagères, étant donné que ce sont, en moyenne, toujours les femmes qui accomplissent la plus grande part de ces tâches et qui sont responsables de la bonne tenue du ménage, des soins aux autres membres de la famille et de la gestion des finances.
L’approche théorique de l’IST par rapport à l’oppression des femmes est erronée; elle découle de l’analyse de Tony Cliff, un des principaux fondateurs du SWP britannique, présentée dans son ouvrage « La lutte des classes et la libération des femmes ». Selon cette analyse, il est incorrect de « trop se concentrer sur les problèmes pour lesquels les hommes et les femmes ont des avis souvent divergents – comme les problèmes du viol, des femmes battues, d’un salaire pour les femmes au foyer, etc. – tout en ignorant ou en n’accordant pas assez d’attention aux luttes importantes pour lesquelles les femmes pourraient plus facilement obtenir le soutien des hommes : les grèves, les luttes pour les allocations, l’égalité salariale, la syndicalisation, l’avortement ».
Mais pour construire l’unité, nous ne devons pas sous-estimer les divisions qui existent bel et bien au sein de la classe des travailleurs·euses. Au contraire, le fait de reconnaître que ces divisions existent, de les analyser et d’y apporter une réponse a plus de chances de nous aider à construire une unité de classe. Ainsi, Trotsky expliquait qu’il était inévitable que resurgissent des idées antisémites en Union soviétique du fait de l’oppression mise en place par le régime bureaucratique, inefficace et générateur de misère qu’était le stalinisme, et il écrivait ceci : « Bien entendu, nous pourrions simplement fermer les yeux sur ce fait ou nous limiter à quelques vagues généralités comme quoi toutes les races sont égales et que nous sommes tous frères. Mais la politique de l’autruche ne nous fera pas progresser d’un iota. » (Thermidor et l’antisémitisme, 1937)
Il est en fait essentiel de dire que les hommes de la classe des travailleurs·euses n’ont aucun intérêt à maintenir en place un système qui opprime les femmes. Les mêmes forces qui poussent les femmes vers des emplois mal payés et qui diffusent une idéologie sexiste exerçant un effet délétère sur l’attitude et le comportement des hommes envers les femmes sont aussi celles qui créent le chômage, la misère, l’émigration forcée et le travail au noir qui font de plus en plus partie de la vie quotidienne des hommes et des femmes de la classe des travailleurs·euses (surtout en ce qui concerne les jeunes) dans le cadre du capitalisme néolibéral et d’austérité. La classe dirigeante tire profit de toute division au sein de la classe des travailleurs·euses, qu’il s’agisse d’une division de genre ou de race, car ces divisions lui permettent d’affaiblir la force de résistance de cette classe. En outre, la classe dirigeante profite directement du fait de pouvoir disposer d’une main-d’œuvre féminine ou immigrée à bon marché. De ce fait, il nous faut une analyse correcte et précise de ce qu’est l’oppression. Si l’on sous-estime ou si l’on évite de s’attaquer aux attitudes sexistes ou racistes qui vivent au sein de la classe des travailleurs·euses, on ne pourra dès lors pas rallier les groupes opprimés à la lutte unie qui est pourtant la clé de leur libération.
Paradoxalement, alors que l’IST adopte une attitude de déni des différences entre hommes et femmes au sein de la classe des travailleurs·euses, il prend une position totalement inverse en ce qui concerne la question nationale et l’opposition à l’impérialisme. Dans le cadre de ces questions, cette organisation jette par-dessus bord toute analyse marxiste pour affirmer que l’unité entre travailleurs·euses est impossible, voire indésirable. En ce qui concerne l’Irlande du Nord par exemple, l’IST a longtemps accordé son soutien à l’IRA (Armée républicaine irlandaise, une milice nord-irlandaise indépendantiste et pro-catholique recourant régulièrement au terrorisme), jusqu’à appeler à voter pour le Sinn Féin (un parti politique nationaliste irlandais lié à l’IRA) malgré le fait que cette stratégie ne pouvait que susciter le dégoût de la part des travailleurs·euses protestant·e·s, traditionnellement anti-indépendance et pro-britanniques et souvent pris pour cibles par les attaques terroristes de l’IRA. Le soutien à l’IRA et au Sinn Féin constitue donc une entrave qui empêche toute possibilité d’unifier l’ensemble de la classe des travailleurs·euses par-delà les divisions sectaires en une lutte commune contre le capitalisme, l’impérialisme et l’oppression. De même, en ce qui concerne Israël et la Palestine, l’approche de l’IST consiste à dénigrer les travailleurs·eises juifs·ves, ce qui est la conclusion logique de leur analyse sans approche de classes sociales .
L’intersectionnalité
L’« intersectionnalité » est souvent expliquée comme étant la théorie de la façon dont les différentes oppressions s’entrecroisent. Beaucoup de partisan·ne·s de cette théorie partagent un point de vue progressiste. Cela découle parfois d’un rejet du féminisme transphobique (c’est-à-dire un féminisme intolérant voire hostile par rapport à la communauté transgenre) ; ou bien d’un rejet du féminisme bourgeois ou libéral, qui au final ne sert que les intérêts des femmes des couches les plus privilégiées et n’entrevoit un changement que dans le cadre du système capitaliste. Cependant, l’intersectionnalité, par sa nature, ne peut nous fournir une stratégie pour la victoire et peut même s’avérer problématique dans la pratique.
Le terme « intersectionnalité » a été défini par Kimberlé Crenshaw, une célèbre intellectuelle féministe noire américaine, professeure d’université aux États-Unis. Ce concept a des racines libérales puisqu’il a été conçu en premier lieu dans le but d’améliorer les services offerts aux femmes noires américaines, victimes de violences conjugales. Une telle grille d’analyse est évidemment utile et importante, mais il est intéressant de constater que l’idée d’intersectionnalité a été, dès le début, non pas développée dans le but d’en finir avec l’oppression, mais en tant qu’outil destiné à adoucir les effets les plus sournois de cette oppression. Même si elle fait souvent référence au texte du « Combahee River Collective Statement » (un manifeste féministe noir datant de 1977) comme constituant la racine ‘radicale’ de l’intersectionnalité, ce mot n’est pourtant pas utilisé dans ce texte. La définition qui en est donnée par Crenshaw elle-même est plutôt éloquente:
« Je conçois l’intersectionnalité comme un concept provisoire qui ferait le lien entre la politique contemporaine et la théorie postmoderniste. En examinant les intersections de la race et du genre, je veux remettre en question l’idée préconçue selon laquelle il s’agirait de deux catégories bien distinctes ; par l’étude des intersections entre ces critères, j’espère pouvoir suggérer une méthodologie qui puisse au final détruire cette tendance à considérer la race et le genre comme des catégories exclusives et séparables. L’intersectionnalité est donc, de mon point de vue, un concept transitoire qui fait le lien entre les conceptions actuelles (avec leurs conséquences politiques) et la politique du monde réel (avec son point de vue postmoderniste)… La fonction de base de l’intersectionnalité consiste à cadrer la question suivante : comment se fait-il que l’oppression que les femmes de couleur vivent (celles-ci faisant simultanément partie d’au moins deux groupes sujets à une large subordination sociétale) soit traditionnellement perçue comme étant monocausale – attribuée soit à une discrimination de genre, soit de race ? » (“Beyond Racism & Misogyny: Black feminism & 2 Live Crew”, par Kimberlé Williams Crenshaw, dans “Feminist Social Thought: A Reader” (Routlege, 1997))
Ainsi, Crenshaw place ouvertement l’intersectionnalité dans le cadre du postmodernisme. Elle explique que sa préoccupation principale est avant tout de pouvoir catégoriser et caractériser l’oppression, pas tant d’élaborer une stratégie pour mettre un terme à cette oppression. Son postulat selon lequel la ‘race’ et le genre ne sont pas des catégories essentiellement distinctes est erroné. Il s’agit d’une remarque non nécessaire, qui ne servira, au final, qu’à mettre de côté l’analyse correcte sur comment le racisme et le sexisme s’intersectionnent dans une oppression plus profonde présente dans la société et cet élément-là reste sans réponse. Cette erreur s’étend à d’autres aspects de son analyse. Par exemple, elle prétend que l’expérience subie par une femme de couleur dans le cadre d’une relation conflictuelle est qualitativement différente de celle subie par une femme blanche dans la même situation. Il est vrai qu’il y a plus de chances pour une femme de couleur, surtout si elle est issue d’un milieu prolétaire, de se voir accusée d’être elle-même responsable du mauvais traitement que lui fait subir son partenaire ou de se voir maltraitée par la police ou par le système judiciaire. Il est vrai aussi qu’il est important de se pencher sur cette réalité pour mieux la connaitre et l’analyser. Cependant, peut-on vraiment dire qu’il y ait une différence qualitative avec ce qu’une femme blanche – surtout si elle est elle aussi issue d’un milieu prolétaire – peut subir comme mauvais traitements de la part de son partenaire? En réalité, si nous parlons d’une méthode destinée à combattre la violence des hommes envers les femmes, mieux vaut construire l’unité de toutes les femmes de la classe des travailleurs·euses, et en particulier de toutes celles soumises à cette violence, par l’organisation de campagnes afin d’obtenir des services d’aide, des centres d’accueil et des logements publics où pourront vivre les femmes fuyant un partenaire violent. Il nous faut construire une lutte unifiée contre la culture sexiste et machiste engendrée par le capitalisme, qui est la source première de la violence envers toutes les femmes, toutes classes sociales confondues.
Bien entendu, dans ce cadre, les femmes de couleur doivent pouvoir exprimer leurs problèmes et revendications spécifiques en fonction de leur expérience particulière : dans certains cas, des campagnes séparées autour de ces thèmes spécifiques pourraient être nécessaires et efficaces. Cependant, un gros problème de l’approche intersectionnelle est qu’elle se focalise davantage sur les expériences individuelles et sur la catégorisation des différentes oppressions engendrées par le capitalisme (et qui touchent toutes les couches de la société jusqu’aux plus marginalisées). De ce fait, elle risque de sous-estimer ou de renier les possibilités de construire un réseau de solidarité entre ces différents groupes opprimés.
Plus important encore, cette approche ne propose pas de piste pour en finir avec l’oppression. En d’autres termes, elle rentre dans le cadre de la conception postmoderniste selon laquelle la lutte des classes est terminée. Elle se contente de catégoriser et de caractériser ces différents types d’oppression et ne cherche pas à conscientiser ces groupes opprimés spécifiques, en leur proposant des campagnes et des revendications qui leur soient propres. Pourtant, cela renforcerait plus que jamais le mouvement de la classe des travailleurs·euses dirigé contre le capitalisme – un mouvement capable d’abolir un système tourné uniquement vers le profit ainsi que le règne des 1 % dont l’intérêt est de maintenir la division et d’empêcher le développement de toute résistance face à leur domination, en plus de tirer un profit direct de ces différents types d’oppression.
En tant que féministe et intellectuelle noire, partisane et théoricienne de l’intersectionnalité, Bell Hooks a fermement critiqué le féminisme purement bourgeois ou pro-capitaliste – le féminisme de la PDG de Facebook, Sheryl Sandberg, qui nous suggère de « nous adapter » ou le féminisme de Beyoncé et son culte voué à la richesse et à l’individualisme qu’elle exprime dans sa musique. Dès le départ, Bell Hooks emploie un ton bien plus radical que, par exemple, les écrits de Crenshaw. Cependant, elle ne propose aucune stratégie pour atteindre son but, qui est d’en finir avec le capitalisme et le patriarcat – tout en laissant entendre qu’il s’agit là de deux luttes séparées, ce qui constitue également un problème.
En effet, le capitalisme ne peut pas être vaincu sans la participation des femmes sur la ligne de front, surtout lorsque l’on parle des femmes issues de la classe des travailleurs·euses, représentant la moitié de la main d’œuvre dans de nombreux pays et qui sont surreprésentées dans les secteurs les plus mal payés et où l’exploitation est la plus intense. Ainsi, aux États-Unis, la population afro-américaine continue à subir cette exploitation des plus sévères. Beaucoup d’efforts doivent être faits afin de construire un mouvement des travailleurs·euses de toutes les origines multiracial capable de remettre en question les divisions et le racisme engendrés par la classe dirigeante qui puisse combattre le capitalisme américain et porter atteinte, voire mettre un terme, au règne des 1 %. Le mouvement « 15 Now ! », pour un salaire minimum à 15 $/heure, qui a obtenu plusieurs victoires dans diverses villes dont Seattle, possède ce caractère multiculturel: les travailleurs·euses de couleur sous-payé·e·s jouent en effet un rôle d’avant-garde dans le cadre de cette lutte.
À Ferguson, Missouri, une insurrection locale de la population noire pauvre a éclaté en août 2014. Cette population est prise pour cible par la police raciste à dominante blanche. Ces événements ont démontré le potentiel qui existe pour l’émergence d’un nouveau mouvement des droits civiques aux États-Unis. Un tel mouvement pourrait non seulement inspirer les travailleurs·euses (de toutes ethnies confondues) qui sont déçu·e·s du soi-disant « rêve américain » prôné par le capitalisme américain, mais aussi tou·te·s ceux et celles qui s’identifient aux « 99 % » auxquel·le·s s’est adressé le mouvement Occupy. Il pourrait combattre les idées racistes qui existent parmi la classe des travailleurs·euses et servir de tremplin vers l’édification d’un mouvement anticapitaliste large. Ainsi, un tel mouvement, sur base de la lutte pour les droits civiques, pourrait à la fois s’en alimenter et renforcer la lutte. Une telle unité permettrait de dépasser le pouvoir démesuré de l’État capitaliste américain (à Ferguson, la police locale est intervenue en tenue de combat militaire et a combiné les attaques aux lacrymogènes à des descentes en tanks et hélicoptères), qui inflige violence et répression dans le but de maintenir le statu quo.
De la sphère politique à la sphère individuelle ?
La seconde vague du féminisme de la fin des années ’60 à ’70, surtout telle qu’elle s’est manifestée aux États-Unis, pourrait se résumer par le principe que « les problèmes personnels sont des problèmes politiques ». Les problèmes tels que la violence, le viol, le manque de contrôle sur ses propres capacités de reproduction, l’isolation et les traumatismes mentaux qui touchent entre autres les personnes condamnées à rester à la maison pour y effectuer un travail non rémunéré ont alors été analysés comme des problèmes sociaux qui ne pouvaient être résolus que par un mouvement social et une transformation sociale – ce à quoi le nouveau mouvement s’attelait. Ces problèmes n’étaient donc plus considérés comme des questions personnelles, dont la résolution revenait aux femmes au niveau individuel. En effet, tous ces obstacles prennent naissance dans le cadre d’un système politique et social donné et nécessitent par conséquent une transformation sociale et politique pour être supprimés.
En revanche, la plus grande partie du féminisme des années ’90 a complètement retourné cette maxime pourtant très progressiste. La devise de ces féministes devenait : « Les problèmes politiques sont des problèmes personnels ». On voit cela clairement dans les ouvrages de Bell Hooks, dans lesquels elle exprime sa propre rage face à l’expérience du racisme et du sexisme, une rage qui ne cherche cependant pas à développer une analyse matérialiste sur la nature de l’oppression dans la société et qui, en outre, n’est pas orientée de manière à contribuer à la construction d’un mouvement de lutte contre cette oppression. Dans Rage meurtrière : En finir avec le racisme (1995), Hooks se fait la digne représentante de cette approche « du politique vers le personnel » :
« Il est paradoxal de constater que de nombreux·euses Blanc·he·s qui s’étaient battu·e·s aux côtés des Noir·e·s l’ont fait en réaction aux images de victimisation des noir·e·s. De nombreux·euses Blanc·he·s affirmaient être préoccupé·e·s par la souffrance de la population noire du Sud à l’époque de la ségrégation et vouloir s’engager dans cette cause. Mais si l’image des Noir·e·s en tant que victimes était une idée admise dans la conscience de chaque Blanc·he, l’image des Noir·e·s en tant qu’êtres égaux, en tant qu’individus capables d’autodétermination, ne suscitait aucune sympathie. En complicité avec l’État-nation, la seule réponse des Américain·e·s blanc·he·s aux luttes des noir·e·s a été d’accepter passivement le démantèlement des organisations militantes noires et le massacre des dirigeant·e·s noir·e·s. »
Dans la pratique, Hooks rejette donc l’ensemble des efforts et sacrifices consentis par divers groupes militants, notamment par le mouvement en majorité blanc des « Voyageurs de la liberté » (Freedom Riders), constitué au début des années ’60 et qui a défié les lois Jim Crow et contribué à l’émergence du jeune mouvement des droits civiques. Les conducteurs·trices de la liberté, dont la plupart étaient des étudiant·e·s blanc·he·s issu·e·s des classes moyennes, n’ont évidemment jamais eux et elles-mêmes connu l’oppression subie par la population noire pauvre du sud des États-Unis. Cela ne les a pourtant pas empêché·e·s de s’engager dans des actions dangereuses qui les amenaient à une confrontation directe avec, notamment, les attaques du Ku Klux Klan. Leur seul objectif était de contribuer à la lutte contre l’injustice et la ségrégation. Hooks adopte une position extrêmement cynique, si catégorique dans son rejet des activistes blanc·he·s, qu’elle ferme les yeux sur la complexité de la réalité et se refuse à envisager tout changement potentiel dans la conscience de ceux et celles-ci. Oui, il est fort possible que certain·e·s des conducteurs·trices de la liberté, en tant que dignes produits de leur environnement, fussent poussé·e·s par des préjugés comme, par exemple, l’idée que leur éducation était de meilleure qualité et qu’ils et elles avaient une plus grande capacité à organiser et à diriger un mouvement. Mais il faut aussi tenir compte du fait que la conscience de ces jeunes gens ait ensuite pu évoluer radicalement du fait de leur participation à ce mouvement – un mouvement au cours duquel ils et elles ont vu des militant·e·s noir·e·s et pauvres, sans aucune éducation formelle, prendre la tête de manière courageuse, authentique et efficace pour combattre l’élite, le système et les bandes violentes du KKK.
Il est tout aussi ridicule d’affirmer que chaque être humain à peau blanche vivant aux États-Unis n’ait pu éprouver la moindre sympathie vis-à-vis des mouvements tels que le Black Power ou les Black Panthers. Certain·e·s Blanc·he·s ont rejoint et collaboré avec les Black Panthers. Tout comme les autres organisations du Black Power, ce mouvement a constitué une source d’inspiration pour l’ensemble des jeunes, des femmes et des travailleurs·euses les plus radicalisé·e·s du pays dans le cadre de la lutte contre l’oppression à laquelle ils et elles étaient eux et elles-mêmes soumis·es, et ce, au cours d’une période par ailleurs hautement révolutionnaire à l’échelle mondiale. Il ne fait aucun doute que la naissance de ces mouvements ait ébranlé les derniers stéréotypes, préjugés ou attitudes négatives envers la population noire qui pouvaient encore subsister dans la conscience même de ces couches les plus radicales. Hooks nie également l’existence du moindre sentiment d’empathie et de solidarité de classe que certaines couches de travailleurs·euses blanc·he·s auraient pu ressentir envers les plus opprimé·e·s de leurs frères et sœurs de classe – une oppression et une exploitation qu’eux et elles-mêmes pouvaient pourtant comprendre au vu de leur propre expérience en tant que travailleurs·euses.
Nier la victimisation aide le néolibéralisme
Qui plus est, la manière dont Hooks parle des victimes pose elle aussi problème. Être victime n’est pas un trait de caractère. Il est tout simplement le propre d’une personne qui est la victime de quelqu’un·e ou de quelque chose. Les travailleurs·euses du secteur public peuvent être victimes de l’austérité – ce qui ne les empêche pas de pouvoir également devenir des agent·e·s de la lutte contre cette austérité s’ils et elles s’organisent. Les femmes victimes de relations abusives sont victimes de la violence et/ou de la domination de leur partenaire, mais peuvent aussi être syndiquées, faire partie d’une campagne anti-austérité et/ou d’un mouvement contre la violence conjugale. De façon similaire, la population noire des États-Unis est victime du racisme inhérent à l’État capitaliste de tout pays, et en particulier du racisme étatique étasunien, qui est en effet la marque de naissance du capitalisme américain.
La féministe suédoise Kajsa Ekis Ekman a écrit que « l’ordre néolibéral déteste les victimes » et que « s’il n’y avait pas de victimes, il n’y aurait pas d’oppresseurs ». Le fait d’être victime de l’oppression est une réalité qui existe indépendamment de notre volonté. Le fait de nier la réalité de la victimisation, que cela soit fait par un·e agent·e de police raciste de Ferguson au Missouri ou par le ou la capitalisme raciste des Etats-Unis, permet uniquement aux oppresseurs·euses (et, de manière plus fondamentale, au système) de s’en tirer à bon compte.
La théorie du privilège
La théorie du privilège est une autre branche des politiques d’identité, qui gagne de plus en plus de popularité parmi les nouveaux cercles féministes, émanant elle aussi de la troisième vague du féminisme (ou post-féminisme). Cette théorie a été développée par Peggy McIntosh dans un ouvrage datant de 1988, intitulé Synthèse du privilège blanc : Déballer la sacoche invisible. McIntosh y explique son idée selon laquelle les couches privilégiées comme, par exemple, les hommes blancs de la classe dirigeante porteraient en permanence sur eux une sacoche invisible remplie de toute une série d’avantages non mérités auxquels ils peuvent recourir à tout moment de leur vie pour éliminer les divers obstacles qui pourraient se dresser devant eux. Mais elle considère elle aussi, en tant que femme blanche, porter une série d’avantages non mérités par rapport à la population non blanche.
La plupart de ceux et celles qui s’intéressent à la théorie des privilèges le font dans le but de pouvoir mieux identifier et combattre l’oppression et l’inégalité sous toutes ses formes, ce qui constitue évidemment en soi un pas important. Cependant, le principal problème de cette approche « des privilèges » est qu’elle se concentre sur des solutions individuelles pour mener ce combat. La théorie du privilège implique, en effet, l’idée qu’on pourra combattre l’oppression tout simplement en rendant les gens conscients des « avantages indus » qu’ils portent, afin de les convaincre à titre individuel de ne pas user de ceux-ci.
« Alors qu’un changement systémique peut prendre des décennies, certaines questions me paraissent urgentes, et j’imagine qu’elles le seront aussi pour d’autres personnes si nous prenons davantage conscience au jour le jour des avantages que représente le fait d’avoir la peau blanche. Que ferons-nous avec une telle connaissance? Comme nous le constatons en observant les hommes, il s’agit de la question de savoir si nous allons choisir d’utiliser ou non cet avantage non mérité, si nous allons utiliser une partie de ce pouvoir acquis arbitrairement afin de reconstruire les systèmes de pouvoir sur une large base » (McIntosh, Summary of White Privilege : Unpacking the Invisible Knapsack).
En réalité, la théorie du privilège sous-estime énormément l’ampleur et l’étendue des différentes formes d’oppression, en particulier en ce qui concerne l’oppression de classe. Elle néglige l’analyse des forces sociales sous-jacentes qui mènent à cette oppression et sous-estime totalement le racisme étatique, les profits tirés de l’oppression des femmes (sur base du travail non payé ou sous-payé dans le cadre du capitalisme), etc. Le fait de dire à chaque individu qu’il ou elle est privilégié·e par rapport à d’autres couches de la société ne constitue pas une stratégie en vue d’un changement. Il s’agit d’une approche subjective, individualiste, libérale, remplie d’illusions envers le système. On ferme les yeux sur la nature monstrueusement oppressive du capitalisme pour adopter une attitude moralisatrice qui vise à afficher sa conscience de l’oppression dans le but de pouvoir « pointer du doigt » l’ignorance des autres.
Cela revient à vouloir tenter de créer des îlots libres de toute oppression dans l’unique cadre de petits cercles sociaux constitués de personnes « éclairées ». À cet égard, cette approche a donc des points communs avec le concept de squats ou autres mouvements visant à se détacher des normes de la société capitaliste vivant dans des collectivités « communistes » à petite échelle. Mais ce scénario ne permet pas de débarrasser l’ensemble de la société de l’oppression et des inégalités. Ces maux ne pourront être vaincus que par une intervention dynamique pour non seulement opérer un changement d’attitude, mais aussi combattre les racines de classe de l’oppression.
À un niveau plus fondamental, la théorie du privilège sous-estime l’ampleur de la propagation des idées sexistes et racistes sous le capitalisme, et de leur impact très profond sur les attitudes des individus. Il faudra bien plus que le « refus » d’utiliser ses privilèges individuels pour véritablement transformer les comportements et les relations entre les êtres humains. Par exemple, la théorie du « privilège » n’explique pas pourquoi un grand nombre d’hommes sont violents envers les femmes. Le phénomène social de la violence masculine envers les femmes – dont toute une couche d’hommes dans la société est l’agent – dépasse le cadre d’une simple vision dans laquelle les hommes feraient usage de « privilèges immérités ». La prévalence de la violence masculine envers les femmes, tout comme les abus sexuels perpétrés sur les femmes et les enfants, doit être comprise et analysée dans le contexte d’une idéologie prônant la famille nucléaire patriarcale depuis des milliers d’années, de la soumission permanente des femmes dans la société et de la promotion des idées sexistes sous le capitalisme – un système qui, contrairement aux systèmes économiques et sociaux précédents, jouit d’une capacité sans cesse croissante de propagation de son idéologie.
Aucune nouvelle théorie ne pourrait justifier d’éviter la lutte active contre l’oppression sous toutes ses formes ou bien contre le système capitaliste lui-même afin d’éliminer les racines matérielles de l’oppression et de l’inégalité. Nous devons construire une société socialiste, dont les fondements seront la satisfaction des besoins humains de la majorité plutôt que les profits d’une toute petite minorité ; un système dont les principes primordiaux seront la solidarité et la coopération. Une telle transformation ne pourra être obtenue et consolidée que par la lutte et l’action de masse collectives afin d’entamer l’édification d’une base sociale qui permettra d’éliminer les comportements racistes et sexistes et d’engendrer des relations humaines personnelles et sexuelles fondées sur l’égalité, le consentement, le choix et le respect.
Une tradition marxiste
La tradition marxiste possède une histoire aussi riche qu’instructive en ce qui concerne la lutte contre l’oppression. Déjà en 1902, Lénine, dans un de ses ouvrages fondateurs, Que faire?, insistait sur l’importance pour les socialistes de s’appuyer sur le pouvoir dont dispose la classe ouvrière pour transformer la société et de mener au sein du mouvement des travailleurs·euses une agitation contre toutes les formes d’oppression – y compris celles qui touchent les classes moyennes et dominantes (il mentionnait, par exemple, la répression étatique contre le clergé et les étudiants).
Pour Lénine, non seulement il était correct pour le mouvement des travailleurs·euses de se tenir aux côtés de tou·te·s les opprimé·e·s, mais il était également essentiel de former les travailleurs·euses pour qu’ils et elles acquièrent une compréhension de l’ensemble des mécanismes du système capitaliste, de sorte qu’ils et elles ne soient pas seulement concerné·e·s par leur propre lutte quotidienne, mais disposent d’une analyse critique et approfondie de l’ensemble du système et d’une compréhension de l’importance de l’unité des travailleurs·euses et de la lutte au-delà de toute division, afin de mettre un terme à l’oppression. « La conscience de la classe des travailleurs·euses ne peut être une conscience politique véritable si les travailleurs·euses ne sont pas habitués à réagir contre tous abus, toute manifestation arbitraire d’oppression, de violence, quelles que soient les classes qui en sont victimes … La conscience des masses laborieuses ne peut être une conscience de classe véritable si les ouvriers·ères n’apprennent pas à profiter des faits et événements politiques concrets et actuels pour observer chacune des autres classes sociales dans toutes les manifestations de leur vie intellectuelle, morale et politique … »
Le célèbre socialiste américain James P. Cannon (1890-1974) – membre du syndicat des Travailleurs·euses Industriels du Monde (IWW), du Parti socialiste, puis du Parti communiste américain, et qui est devenu, plus tard, un proche collaborateur de Trotsky – trouvait que le Parti socialiste américain avait adopté une approche trop globale vis-à-vis des travailleurs·euses noir·e·s au début du XXe siècle. Pour Eugene Debs, dirigeant du Parti socialiste américain, il suffisait d’appeler les Afro-Américain·e·s à l’ « unité prolétarienne » au sens large. Il n’y avait aucune campagne, revendication ou approche spécifique relative aux questions directement liées à l’oppression spécifique dont étaient victimes les populations noires. En réalité, de nombreux·euses travailleurs·euses blanc·he·s regroupé·e·s au sein du Parti socialiste se méfiaient de la nature « réformiste » des campagnes et revendications spécifiques à la communauté afro-américaine visant à l’égalité. De plus, de nombreuses idées racistes avaient cours à l’intérieur même du Parti socialiste.
Dans son article « La révolution russe et la lutte des Noir·e·s aux États-Unis », Cannon a expliqué la façon dont s’est opéré un revirement du tout au tout parmi la gauche à la suite de la révolution d’octobre 1917 en Russie. Les socialistes américain·e·s se sont inspiré·e·s de la théorie et de l’action de Lénine. Ce dernier défendait résolument le droit à l’autodétermination des nationalités opprimées en tant qu’outil visant à transcender les sentiments nationalistes et à activer l’unité de classe et la lutte socialiste au-delà des divisions nationales. Tirant les leçons de cette approche, le PC américain (malgré sa stalinisation), soucieux d’appeler la population noire à s’organiser dans le Parti communiste nouvellement fondé, a développé des revendications et du matériel spécifiques visant à la libération des Noir·e·s et l’a incorporé dans son programme et dans ses activités. Grâce à cela, le PC a pu recruter des milliers d’Afro-Américain·e·s au cours des années ‘1920 à ’30, ce qui a permis au Parti de devenir une force importante et un point de référence pour la communauté noire pendant toute une période.
Le pouvoir du mouvement des travailleurs·euses
Le mouvement de la classe des travailleurs·euses en lutte a le potentiel de devenir la plus grande force de changement et, pour peu qu’il adopte un programme correct et construise l’unité, un tel mouvement peu devenir un point d’attraction pour l’ensemble des groupes opprimés qui peuvent, à leur tour, rejoindre le mouvement et y mettre en avant leurs revendications spécifiques. Durant Mai 68 en France, nous avons vu se réaliser une telle synergie. D’une part, il y a eu la lutte des étudiant·e·s sur les campus des universités françaises, frustré·e·s par un establishment conservateur défendant une approche réactionnaire concernant les questions de genre. D’autre part, la classe des travailleurs·euses s’est engagée dans une grève générale massive au fort potentiel révolutionnaire. La synergie de ces mouvements a créé une force sociale extrêmement puissante qui aurait pu (si la gauche avait été à la hauteur) briser le capitalisme français et jeter la base pour une transformation socialiste de la société en France et ailleurs. Nous avons également vu à l’œuvre une telle synergie lors de la grève des mineurs au Royaume-Uni en 1984-85 avec des femmes prolétaires, des groupes LGBT, des communautés noires et asiatiques qui se sont mis·es en mouvement.
Les socialistes et les marxistes doivent mener une lutte contre toutes les formes d’oppression et développer des revendications et un programme complet afin de maximiser le potentiel pour forger une telle synergie. En ce qui concerne l’oppression des femmes, les socialistes doivent, par exemple, participer aux luttes pour les droits reproductifs et sexuels, contre le sexisme dans les médias et contre la violence sexuelle, tout en luttant pour l’égalité au travail et contre l’impact de l’austérité sur les femmes. Une telle approche sera cruciale pour assurer que la majorité du nouveau mouvement féministe émergeant – aux contours encore mal définis – puisse être gagné à une position socialiste et combattre de manière efficace les racines de classe de l’oppression des femmes.
La radicalisation par rapport aux questions sociales
En Irlande, on a récemment vu s’opérer de profonds changements à propos de questions sociales, telles que le droit à l’avortement ou la légalisation du mariage homosexuel, en particulier en Irlande du Sud. Les jeunes du Nord comme du Sud sont de plus en plus radicalisé·e·s sur ces questions-là. La recherche d’une société plus progressiste, démocratique et laïque peut de plus en plus devenir une porte d’entrée pour les jeunes, en particulier les femmes et les LGBTQI, vers les idées de la gauche anticapitaliste et socialiste. Au niveau mondial, l’arrivée d’une nouvelle génération de féministes est une évolution progressiste positive. Parmi ces couches, nombreux·euses sont ceux et celles qui se frayent un chemin à travers les théories de l’identité, de l’intersectionnalité et des privilèges. Tout cela est le signe d’une quête sincère, admirable et radicale de réponses pour parvenir à un changement sociétal.
Il est très important pour les socialistes d’entrer dans ce débat de manière sensible, de trouver une cause commune dans l’action et dans la lutte avec tou·te·s ceux et celles qui désirent lutter contre l’oppression. Il est également important de mener la lutte contre le système capitaliste – un système qui se caractérise par une inégalité croissante et qui porte en lui le racisme, le sexisme et l’homophobie depuis sa naissance. Un programme socialiste, qui organise la lutte des travailleurs·euses que les richesses et les ressources en Irlande, en Europe et dans le monde soient dans les mains de la collectivité, sous contrôle démocratique de la population, est l’approche nécessaire si nous voulons créer les conditions qui nous permettront de mettre un terme à la pauvreté et à l’oppression.
Laura Fitzgerald, Socialist Party (section irlandaise du Comité pour une Internationale Ouvrière)