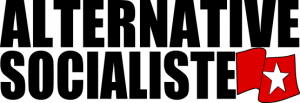Objectif des perspectives Le but de ce document est de préparer les membres, les sympathisants et les sympathisantes d’Alternative Socialiste à intervenir efficacement dans leurs actions politiques à Montréal, et à Verdun où nous avons une forte présence depuis quelques années. Que ce soit pour des actions telles le syndicalisme, les manifestations ou piquets de […]
Les 50 ans du CIO/ISA: notre lutte pour une Internationale marxiste révolutionnaire et combative
Il y a 5o ans, le Comité pour une Internationale ouvrière était formé, qui en 2019 s’est transformé en Alternative Socialiste Internationale.
Stop au génocide : Pour une véritable grève générale
Le mouvement de protestation mondial et les protestations en Israël doivent être dirigés contre la racine de la guerre génocidaire. Un million de personnes en Israël ont participé dimanche aux manifestations contre l’escalade du génocide à Gaza. Parallèlement, le gouvernement et l’armée d’extrême droite israéliens poursuivent leur campagne de famine et de bombardements pour réaliser […]
Victoire des agent-es de bord
Air Canada et le gouvernement vaincus Les agents et agentes de bord d’Air Canada ont remporté une victoire pour eux et elles-mêmes et pour l’ensemble du mouvement syndical. En plus d’obtenir des gains importants, leur détermination à défier l’ordre de retour au travail de la Commission des relations de travail a renforcé le droit de […]
Les agent-es de bord d’Air Canada défient l’ordre de travail
À 00 h 58, heure de l’Est, le samedi 16 août, les agent-es de bord, membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et employés d’Air Canada, ont entamé la plus grande bataille syndicale de l’année jusqu’à présent. À peine 12 heures plus tard, la ministre libérale fédérale Patty Hajdu intervenait en soutien aux […]
Andor et la romantisation du travail révolutionnaire
La série Andor est absolument incroyable par rapport à ce que l’on peut voir dans d’autres films de science-fiction. Le thème du travail révolutionnaire est traité avec respect, les personnages sont humains, imparfaits et complexes, y compris les personnages féminins sont à leur meilleur. L’auteur de la série, Tony Gilroy, dit s’inspirer des révolutions du […]
Contribution sur l’histoire du mouvement gai
Nous reproduisons ici le contenu d’une brochure de la Ligue ouvrière révolutionnaire publiée au Québec en 1978. Il s’agit d’un des rares documents de cette époque à approcher la lutte des personnes LGBTQ+ d’un point de vue de classe. Bien qu’Alternative socialiste ne partage pas toutes les positions présentées dans ce texte, en particulier la faible approche de construction du parti révolutionnaire ainsi que son rôle dans et autour des mouvements sociaux, nous croyons qu’il est utile au débat et à l’histoire des luttes québécoises de publier ce texte pour la première fois en format numérique.
En guise d’avertissement
En tant que marxistes, il nous est impossible de considérer, d’analyser un élément isolé de l’ensemble, car l’essentiel de la méthode marxiste, c’est l’importance de la totalité sur les parties, comment les différents éléments épars de la réalité sont reliés à l’ensemble des structures sociales et comment les différentes manifestations compliquées de l’histoire, sont explicables en dernière instance (Engels) par la structure économique sous-jacente (Marx). Aussi, pour nous, l’analyse des racines de l’oppression des homosexuels et l’histoire du développement du mouvement homosexuel contemporain (aussi brève soit-elle) ne peut se faire en vase clos.
Le marxisme, jusqu’à maintenant, n’a pas développé une approche matérialiste historique de la sexualité. Bien que Marx et Engels aient mis de l’avant une analyse matérialiste historique de la sphère publique en contestant l’apparence des formes économiques qui préside à l’échange inégal entre le patron et l’ouvrier, ils n’ont pas pu appliquer l’analyse à la sphère de la vie personnelle et à la sexualité. Ils n’ont pas été capables de s’attaquer à l’idéologie dominante sur la sexualité et ils ont eu tendance à considérer l’activité sexuelle comme une constance historique. Résultat : Ils n’ont pas élucidé comment les différentes formations sociales et le patriarcat ont modelé le développement de la sexualité. Reich, pour sa part, a signalé que l’incompréhension par les Bolcheviks de l’importance de la vie personnelle a facilité le reflux de la révolution en renforçant des structures psychiques conservatrices.
Les propos de Marx et Engels peuvent paraître abstraits mais ils renvoient plus simplement à la phrase de Marx : « La critique a effeuillé les fleurs imaginaires qui couvraient la chaîne, non pas pour que l’homme porte la chaîne prosaïque et désolante, mais pour qu’il secoue la chaîne et cueille la fleur vivante. »1
Introduction
« Sortant du ghetto sordide où ils sont confinés par l’hypocrisie de la morale bourgeoise, refusant les insultes, les brimades, et proclamant que ce ne sont pas les gais qui sont malades mais le système, le mouvement homosexuel s’est développé »2
Pour les homosexuels québécois, la décennie 70 représente la « sortie » d’un profond trou noir (encore qu’on les y attende avec des mitraillettes), la prise de conscience de l’oppression spécifique, la radicalisation à partir de cette oppression. Cette radicalisation, loin de s’être effectuée en vase clos, s’inscrit dans tout le mouvement social et politique qui lui donne ses caractéristiques propres : une composante nationaliste, un fort sentiment de rage contre les forces policières qui ne cessent de brutaliser et de harceler les gais, un sentiment qui se précise contre les réactions discriminatoires des réactionnaires comme les commissaires de la CECM3 qui ont refusé des salles aux gais. Il faut ajouter celles de Pro-Vie qui exercent des pressions sur le gouvernement péquiste pour qu’il fasse retirer la loi 88, loi qui accorde un recours légal aux homosexuels contre la discrimination. Comme on peut le constater, la discrimination n’est pas chose du passé. La droite est en train de s’organiser pour essayer de faire retourner les homosexuels québécois aux années noires des décennies précédentes.
Fiers de leur riposte contre la répression pré-olympique en 76 et de leur victoire en décembre 77 lorsque le PQ4 au pouvoir leur a accordé, sous la pression de leur mobilisation, la loi 88, les homosexuels québécois se rendent compte que des luttes directes, comme la manifestation de 2 000 personnes qui ont bloqué la rue Sainte-Catherine tout un samedi soir le 22-23 octobre, en riposte aux 109 arrestations du Truxx, ÇA PAIE.
Mais la répression policière ne s’arrête pas, même si elle diminue en fonction des réels rapports de force. Les plaintes affluent sur les bureaux de la Commission des droits de la personne qui tarde toujours à faire cesser la discrimination et à rendre justice. Quant au gouvernement péquiste, sensible aux pressions de la droite, il n’ose pas se prononcer carrément contre toute discrimination contre les homosexuels. Il laisse le harcèlement policier continuer. Lévesque se demande même si « un tel choix », en parlant de l’orientation sexuelle, est indiqué. Les trous laissés dans la loi sont béants : les enseignants ne sont pas protégés, les travailleurs de la santé sont toujours à la merci de leurs patrons. Ces derniers peuvent trouver mille et un prétextes pour renvoyer un homosexuel (parce qu’il porte une boucle d’oreille par exemple), à la limite, provoquer même des incidents accablants. Les travailleurs de la fonction publique fédérale ne le sont pas non plus.
Suite aux attaques et injustices de toutes sortes contre la communauté homosexuelle, et prenant conscience de la nécessité de se regrouper, les homosexuels ont commencé à s’organiser : de petits groupes sont nés, on a commencé à se parler, à rechercher les causes de tant de répression, les racines de cette oppression étouffante. On a d’abord vu naître et mourir le FLH (Front de libération des homosexuels) au début des années 70. La démarche s’est approfondie depuis. On parle maintenant beaucoup plus de l’organisation, de la nécessité de ne pas se laisser faire, de la construction d’un mouvement gai québécois. Les débats sont multiples, complexes : comment se structurer, autour de quelles revendications, quelle stratégie adopter?
Notre contribution s’inscrit dans ce processus de réflexion, cette recherche d’objectifs, de moyens de lutte. Nous n’avons pas la prétention d’apporter des réponses toutes faites, car nous avons nous-mêmes, en tant que marxistes-révolutionnaires, beaucoup à apprendre du mouvement gai lui-même. Nous faisons néanmoins cette contribution car elle peut amener de l’eau au moulin, alimenter des débats cruciaux qui ont présentement lieu et qui vont s’approfondir dans l’avenir dans la communauté gaie en général et surtout dans les principaux noyaux et groupes gais existants. Nous apportons aussi notre point de vue sur la libération des homosexuels, qui ne peut se réaliser sans un changement global de la société, sans une véritable révolution socialiste qui pose les jalons d’une société meilleure et exempte d’oppression.
Ce texte-ci ne veut d’aucune manière présenter une position définitive et figée de la LOR sur la libération gaie. Nous débattons présentement de cette question au sein de la LOR, et il nous sera possible dans un avenir rapproché, nous l’espérons, de faire connaître des positions beaucoup mieux articulées et comportant des aspects programmatiques sur la libération gaie.
Notre contribution comporte une assez longue partie sur l’histoire du mouvement gai au Québec, sur les causes sociopolitiques et donc de son émergence. Ça nous semble un pré-requis essentiel avant d’aller plus loin. Différentes interprétations sont possibles. Des divergences surgiront probablement. Nous invitons tous ceux et celles qui le désirent à venir discuter, à débattre, à échanger avec nous, dans un esprit propre à faire progresser notre démarche théorique à tous pour mieux éclairer notre pratique et ainsi contribuer en unité d’action à œuvrer à la libération des homosexuels.
Si ce texte semble s’adresser d’abord aux homosexuels plutôt qu’aux lesbiennes, c’est que, d’une part, notre connaissance du milieu lesbien est insuffisante (en partie à cause de leur oppression particulièrement dure dans la société capitaliste patriarcale, oppression qui se reflète de façon déformée dans l’organisation révolutionnaire et qui handicape l’affirmation des lesbiennes) ; d’autre part, parce que nous ne voulons pas nous aventurer à faire des généralisations qui pourraient être abusives quant à la radicalisation des lesbiennes au Québec et quant à leur structuration éventuelle en mouvement. On peut tout de même affirmer brièvement que le féminisme lesbien s’attaque à l’institution et à l’idéologie de l’hétérosexualité ainsi qu’aux rapports patriarcaux et autoritaires. Le lesbianisme se trouve en rupture d’avec le discours phallocratique des hommes sur la sexualité féminine : discours qui nie la sexualité clitoridienne autonome des femmes et qui exige que les femmes doivent être satisfaites par la pénétration du pénis dans le vagin ; discours qui exige que la sensualité et l’émotivité soient subordonnées à la primauté génitale mâle. Pour toutes ces raisons, la lutte des lesbiennes a des implications pour toutes les femmes, notamment en ce qui concerne l’autodétermination sexuelle. Les mères lesbiennes mettent aussi en question la croyance patriarcale sacrée que les enfants, les services donnés dans la famille et le corps des femmes, appartiennent aux hommes.
Nous pensons cependant que dans l’analyse générale présentée ici, beaucoup d’éléments (comme l’importance de l’oppression nationale dans le retard dans le développement du mouvement des gais, la répression policière, l’oppression quotidienne) pourraient aussi se retrouver dans l’analyse que pourraient faire les lesbiennes pour comprendre leur oppression.
Cependant, nous pouvons affirmer de façon générale que le mouvement gai devra combattre le chauvinisme et l’ignorance qu’il a de l’oppression spécifique des lesbiennes en son sein. Il lui faudra les appuyer, appuyer les caucus et les groupes autonomes des lesbiennes, adopter une orientation féministe-lesbienne pour faciliter l’unité d’action du mouvement gai avec celui des lesbiennes. Les homosexuels doivent aussi se rappeler que les lesbiennes ont toujours manifesté et participé activement avec les hommes lors des grandes mobilisations du mouvement gai québécois, comme lors de la riposte contre la répression pré-olympique en 76, et lors de la manifestation du 22-23 octobre 77, de même qu’à la dernière manifestation du 17 juin 1978.
Ce document sortira pour le 2ème congrès national des gai(e)s (la parenthèse n’est pas de nous) du Québec. Nous croyons que ces congrès nationaux représentent des occasions uniques de rencontre pour les militants gais dispersés à travers le Québec, pour débattre des meilleurs moyens pour structurer le mouvement à l’échelle nationale, pour lui donner des perspectives.
NOTE 1 : Nous sommes conscients que ce document n’est pas au faîte des débats au sein du mouvement gai américain, anglais et canadien. De ce point de vue, il reflète la réalité de l’oppression nationale qui touche aussi les Québécois qui sont gais. Ils sont défavorisés par le contexte culturel linguistique dominant en Amérique du Nord, surtout ceux qui ne lisent ou ne parlent pas ou guère l’anglais. Aussi, la littérature gaie américaine et anglaise (les traductions se font rares et coûtent cher), de même que les débats qui traversent depuis quelques années les mouvements gais de ces deux pays, leur sont difficilement accessibles, donc assimilables.
Cette contribution sera donc, de ce point de vue, lacunaire. Elle vise d’abord à essayer d’y voir un peu clair sur l’histoire du mouvement gai québécois. Ça nous a semblé un pré-requis absolument nécessaire avant d’aller plus loin.
NOTE 2 : Cette contribution reprend rapidement certains éléments d’analyse contenus dans le texte de Jean Nicolas La question homosexuelle, publiée dans Critique Communiste, numéro spécial double 11-12, décembre-janvier 1976-1977, et en vente à la librairie rouge, 1737 St-Denis, 849-2936.
NOTE 3 : Ce texte a été écrit par des gais de la LOR qui participent aux luttes du mouvement gai québécois, avec la collaboration toute particulière de Christophe Tanguay, qui défraie régulièrement la chronique gaie dans LUTTE OUVRIÈRE.
Sur les origines de l’oppression
Dans la plupart des formations sociales que l’histoire a connues, des personnes du même sexe ont eu et continuent d’avoir des relations homosexuelles. L’homosexualité n’est pas un phénomène propre à certaines cultures et à certaines époques, mais bien un fait universel dans le temps et dans l’espace. Toutefois, l’attitude de la société en général, et des pouvoirs en place en particulier, face à l’homosexualité, a grandement varié dans l’histoire. Dans bien des sociétés, dont évidemment la nôtre, les relations homosexuelles ont été condamnées et les personnes qui s’y livraient ont été réprimées et opprimées. Nous ne nous attarderons point sur les origines de cette oppression/répression. Plusieurs théories héritées des débats et réflexions de nombreux anthropologues continuent de se confronter encore aujourd’hui. Dans la mesure où le temps et l’énergie nous le permettent, nous tentons de répercuter ces débats dans notre organisation.
Des facteurs à l’origine historique de l’oppression des homosexuels, nous pouvons identifier brièvement les suivants :
- dans la société pré-classiste, la division sexuelle du travail liée au rôle reproducteur de la femme et son corollaire idéologique, la différenciation masculin/féminin et les rôles attribués à chaque différence;
- dans la société de classe patriarcale, l’instauration de la propriété privée et de la famille pour que le mâle dominant puisse transmettre l’héritage de père en fils et conséquemment l’établissement de la famille patriarcale, régie par une norme hétérosexuelle et monogamique, entraînant une limitation des pratiques homosexuelles.
La sexualité est devenue rapidement pas seulement subordonnée à la reproduction, mais aussi aux besoins de la classe dominante (aujourd’hui la bourgeoisie) qui, en instaurant la monogamie hétérosexuelle consacrée par la vie en famille (plus tard par un contrat social et religieux comme le mariage), devint rapidement la norme sexuelle.
Mais l’histoire a connu et connaît encore des sociétés dans lesquelles les rapports homosexuels sont partie intégrante de la vie de la population dans sa vaste majorité. Le cas de la Grèce antique est sans doute le plus connu, mais on pourrait en mentionner plusieurs autres. L’anthropologue Margaret Mead a même rapporté l’existence de sociétés exclusivement homosexuelles. Pour des raisons obscures, certains auteurs ont prétendu que la reconnaissance de l’homosexualité dans certaines sociétés découlait du statut extrêmement dégradé réservé aux femmes dans ces sociétés. Nous renvoyons les lecteurs à l’étude de Jean Nicolas, La question homosexuelle, dans laquelle il montre que «loin que l’homosexualité fleurisse dans les sociétés les plus misogynes, c’est dans ces sociétés où le statut de la femme est le plus dégradé que se développe l’oppression des homosexuels».
Tout ceci montre qu’il n’y a pas de lien biologique, naturel et obligatoire entre l’activité sexuelle et la reproduction, comme le prétendent volontiers les psychiatres, sexologues et moralistes bourgeois pour étayer leur défense de l’hétérosexualité exclusive comme allant de soi. Les normes de comportement sexuel sont des produits de la société et varient grandement d’une société à l’autre.
Bien entendu, il ne fait aucun doute que l’hétérosexualité exclusive issue de la morale judéo-chrétienne jouit présentement d’une prédominance extrême dans le monde contemporain. Il en est ainsi parce que les pays d’où cette morale est originaire (i.e. les pays européens) ont conquis par la suite une position dominante à l’échelle mondiale. Ils ont imposé au reste du monde leurs capitaux, leurs armées, leurs missionnaires et leur morale. Le tabou sur l’homosexualité de l’idéologie judéo-chrétienne a profondément laissé son empreinte sur la culture occidentale. «À partir du moment où le christianisme devient religion d’État dans le Bas-Empire romain, l’oppression de l’homosexualité fut légalisée. On a le décret de l’empereur Constantin imposé en 342 : la peine de mort pour sodomie ; et en 390, l’empereur Valentin décréta la peine de mort par le bûcher. Lorsque Justinien codifia en 538 la loi romaine, il prescrivit pour les homosexuels la torture, la mutilation et la castration avant leur exécution».5 Le tabou anti-homosexuel a été également utilisé comme instrument d’intimidation à l’égard de ceux qui contestaient le pouvoir en place (i.e. les purges staliniennes et la répression du mouvement homosexuel allemand par les nazis).
À travers les stigmatisations de l’homosexualité comme une «tare contre-nature», sa catégorisation par la psychiatrie comme une maladie, il a fallu attendre Freud (Trois essais sur la théorie de la sexualité, Freud) pour démontrer le caractère précaire de l’homosexualité et de l’hétérosexualité ; l’enfant est d’abord «pervers polymorphe», i.e. son désir n’est pas attaché à l’un ou l’autre sexe, mais sous l’impact de la pression sociale, il sera canalisé exclusivement vers l’hétérosexualité.
Ces pays ont aussi imposé les rapports de production capitalistes ainsi que les principaux mécanismes sociaux qui permettent la reproduction et le maintien de l’ordre bourgeois. Dans le cas spécifique du capitalisme (société de classe où la classe dominante est la bourgeoisie), la famille monogamique hétérosexuelle est une institution nécessaire, dont l’importance idéologique est irremplaçable et fondamentale.
La famille et l’oppression des homosexuels
L’oppression des homosexuels apparaît donc et est fondamentalement liée à l’apparition et à la consolidation de l’institution qu’est la famille nucléaire (elle-même lieu par excellence où se noue l’oppression des femmes), créant les bases qui vont donner des formes spécifiques à l’oppression des homosexuels et des lesbiennes.
La famille véhicule, dès le plus bas âge (âge des premiers conditionnements au moule social, aux rôles sociaux) les valeurs de la société capitaliste pour la génération qui vient.
Dans les sociétés bureaucratiques, elle véhicule les valeurs de ces sociétés, elles-mêmes héritées de l’idéologie bourgeoise qui ne meurt pas du jour au lendemain après l’insurrection prolétarienne victorieuse avec laquelle commence ce long processus de construction d’une société socialiste qui ne peut se parachever vraiment qu’au niveau international. Nous ne pouvons malheureusement pas nous attarder ici à faire l’analyse de la famille dans les États ouvriers bureaucratiquement dégénérés. Nous y reviendrons dans des publications ultérieures.
Le Capital a besoin de la famille nucléaire, car elle constitue un mécanisme de contrôle social, un mécanisme de socialisation, et qu’elle exerce une influence conservatrice générale sur les individus qui la composent. La structure familiale répond à plusieurs fonctions économiques et idéologiques importantes qui facilitent sa survie et celle de la société capitaliste en général. En dépit de l’étatisation continue d’une série de fonctions directement idéologiques et techniques par l’expansion du système scolaire, des garderies, la famille reste la première institution qui moule les individus qui constituent une société de classe. Le capitaliste a besoin de travailleurs obéissants, dévoués, et la famille remplit cette fonction. Le développement qui se fait dans les premières années de vie à l’intérieur de la famille est de première importance pour le façonnement de la personnalité. La socialisation des enfants, ce qu’on appelle leur «éducation» (dressage au respect de l’autorité, apprentissage des rôles sexuels stéréotypés masculins et féminins, division des sexes, dès le bas âge et qui préparent la division sexuelle du travail qu’on acceptera plus facilement comme naturelle plus tard, acceptation sans rouspéter de l’ordre social existant, inculcation de l’individualisme et des attitudes chauvines et sexistes) vient d’abord de la famille. Tout cet apprentissage initial est par la suite renforcé quotidiennement par les autres institutions (écoles, églises, institutions d’embrigadement de la jeunesse style scout, armée, etc.) sans oublier l’importance des médias (surtout la TV) comme moteur de conditionnement quotidien à l’idéologie bourgeoise et pro-familiale.
A-t-on déjà vu une série de science-fiction pour la TV par exemple, où les rapports interpersonnels à composante sexuelle ne sont pas exclusivement hommes-femmes (conditionnement des téléspectateurs oblige). À preuve que le conditionnement est efficace : on avait «fait un test» il y a quelques années avec un téléroman à Radio-Canada ; dans un téléroman nommé Filles d’Eve ou le Paradis terrestre, un homme prenait la main d’un autre homme dans un ascenseur : comme résultat, un orage d’appels outragés. Même aux émissions, peu contestataires, présentées au canal dix sur le sujet (à Parle parle, jase jase), le même phénomène s’est reproduit.
Les pressions sociales au mouvement homosexuel naissant au Québec forcent certaines stations de télévision à parler d’une certaine façon du «phénomène problématique». Mais quand il s’agit de nous présenter un homosexuel dans la vie de tous les jours, on a droit à des caricatures grossières et dégradantes style «la tapette de Rue des Pignons» dans des téléromans réactionnaires. Cette image misérable de l’homosexuel découragerait n’importe qui à se laisser aller à ses désirs homosexuels. Sans parler des écrivains de science-fiction qui font généralement preuve d’un remarquable refoulement de leur imaginaire sexuel et de celui de leurs héros en en faisant presque toujours (sauf de très rares exceptions) des hétérosexuels. De ce point de vue, ils sont nettement en arrière de leur civilisation, et sont loin de refléter la réalité sociale actuelle.
Pour les homosexuels, cette acceptation forcée des rôles sexuels à coups de matraquages idéologiques d’interdits, et cette nécessité de se conformer pour avoir une «bonne image sociale», ça signifie : si tu ne te conformes pas, tu risques de «passer pour une tapette» de bonne heure : ô suprême insulte. Surtout ce qu’il ne faut pas être. Autrement tu risques de pâtir toute ta vie par «mésadaptation sociale» (car même si on sent une certaine tolérance dans certains milieux, les homosexuels sont constamment exposés au renvoi du travail et du logis, aux insultes, aux regards de travers, aux moqueries, et aux sarcasmes, de même qu’à la réprobation sociale). Tu risques de te retrouver tout seul, face à toi-même, face au ghetto, face au suicide, face au couple (comme les hétérosexuels d’ailleurs) et à ses contradictions. Pour les jeunes homosexuels qui ne cachent pas leur homosexualité, cet environnement social hyper-répressif les conduit souvent (parce qu’ils se sentent menacés et forcés «de faire quelque chose pour se plier à la norme») vers la psychothérapie «adaptative» dans les institutions médico-psychiatriques ou voire même hors de leur famille, avec tout ce que cela comporte d’implications.
Dans ce contexte super-répressif, seul un mouvement homosexuel (qui par sa dynamique questionne implicitement la moralité bourgeoise), comme il tend à se développer au Québec, permet de rompre partiellement ce cercle vicieux de l’isolement et du mépris et de se confronter aux véritables enjeux d’une réelle libération homosexuelle.
La famille joue ainsi un rôle fondamental pour apprendre aux enfants et aux adultes à s’auto-réprimer sexuellement (Wilhelm Reich, dans la Révolution sexuelle, Chap. sur la famille autoritaire en tant qu’appareil d’éducation) et à réprimer très tôt tout désir sexuel envers son propre sexe. Il ne faudrait pas négliger cet aspect «éducation», car c’est en fin de compte ce qui explique l’acharnement de la bourgeoisie à défendre la famille patriarcale-monogamique (alors que théoriquement la force de travail qu’achète le capital pourrait être biologiquement reproduite dans des milieux de type communal).
Famille-oppression des femmes et oppression des homosexuels
On ne peut parler du lien entre le maintien du rôle de la famille dans la société capitaliste et l’oppression des homosexuels, sans parler de l’oppression spécifique que subissent les femmes dans le système capitaliste et dans la famille.
L’oppression des femmes est enracinée dans la société de classe, et sert le Capital. La société bourgeoise érige en «loi naturelle» la supposée infériorité et la passivité des femmes par rapport aux hommes. Mais toute leur éducation est orientée pour qu’elles soient inférieures et passives, pour qu’elles ne développent pas leurs muscles par exemple.
L’étude comparée des diverses sociétés montre qu’on peut renvoyer les rôles complètement.
La bourgeoisie fait exécuter la plupart des fonctions familiales aux femmes : tâches domestiques, dressage des enfants, objet sexuel du mari, servante du mari, usine à enfants, tâches contribuant à la reproduction de la force de travail nécessaire au capital. La famille est de plus une unité de consommation et de gaspillage unique qui permet au capitalisme de faire gober sa publicité de besoins artificiellement créés et présentés comme nécessaires au bonheur. La plupart des annonces télévisées s’adressent à la ménagère. Selon les besoins fluctuants de l’accumulation du capital, les femmes servent d’armées de réserve industrielle utile en période de guerre. Pendant la guerre, on a passé un règlement anti-taverne interdisant aux femmes d’entrer dans les tavernes : pour qu’elles fassent leur travail à l’usine et à la maison. Pendant le boom expansionniste d’après-guerre, le Capital s’est servi des femmes comme une main-d’œuvre disponible en tout temps pour concurrencer les travailleurs masculins. Puisqu’elles sont supposément inférieures, leur salaire est considéré qu’un apport au salaire du mari. On les assomme avec les emplois les plus plats (secrétaires, serveuses, téléphonistes), les moins stimulants intellectuellement, souvent les plus abrutissants. En plus, elles subissent les brimades et les claques sur les fesses, l’autorité méprisante des hommes chauvins et sexistes que la société capitaliste a bien dressés à leurs rôles de dominants. Le chauvinisme s’exerce aussi quand l’occasion se présente contre les homosexuels. En plus, elles font souvent double emploi, un emploi à la maison, les tâches domestiques avec seul salaire et encore souvent inférieur à celui d’un homme : oppression et surexploitation se combinent quotidiennement.
De plus, les moyens contraceptifs sont inadéquats et difficiles d’accès, les conditions d’avortement sont lamentables. Et ce ne sont pas les comités thérapeutiques bidons donnés au compte-goutte par le PQ qui vont régler le problème. Les garderies sont aussi insuffisantes. Et ce sont surtout celles de la classe ouvrière et des couches opprimées de la population qui sont particulièrement les victimes de cette situation. Et ceux qui ont compris, comme le docteur Morgentaler, le problème des femmes sans argent (et c’est la majorité des femmes, surtout celles de la classe ouvrière et des couches opprimées) qui ne peuvent pas se faire avorter dans des conditions saines, subissent les pires outrages des tribunaux bourgeois. Car le «problème« de l’avortement est politique. Certains en font, comme Pro-Vie, un strict problème de vie ou de mort d’un fœtus. Mais il s’agit de la santé et de la vie des femmes, du contrôle libre de leur corps, du droit à la libre jouissance sexuelle, du droit à choisir le moment d’avoir des enfants, du droit de définir elles-mêmes leur propre sexualité.
Les homosexuels sont à même de comprendre facilement, à partir de leur propre oppression sexuelle vécue dans le système capitaliste, l’importance de pouvoir disposer librement de leur corps sans entrave des corps publics.
En réagissant contre la médecine capitaliste ainsi que le conservatisme et l’autoritarisme des médecins qui perpétuent les mythes sur la sexualité, qui essaient de camoufler l’anatomie et les fonctions physiologiques des femmes, des femmes commencent à s’organiser en collectifs d’auto-santé, un pas très important en avant contre le discours misogyne sur le corps féminin.
Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi la classe dominante veut réduire la sexualité à la reproduction de bébés, rejette et réprime les activités sexuelles (homosexuelles) qui remettent la fonction procréatrice de la sexualité totalement en question. C’est justement d’ailleurs parce que le mouvement de libération des femmes tend lui-même à mettre en question la réduction du rôle des femmes à la procréation, qu’il a toujours été l’allié naturel du mouvement homosexuel (et vice versa, tant pour les homosexuels que pour les lesbiennes).
La revendication centrale de la partie la plus militante du mouvement des femmes au Québec (comme d’ailleurs dans la plupart des pays capitalistes avancés : Italie, France, Angleterre, Espagne) c’est l’avortement et la contraception libre et gratuit. Cette question centrale (liée aux autres revendications du mouvement des femmes) doit être bien comprise par le mouvement homosexuel. Le GHAP (Groupe homosexuel d’action politique) et l’ADGQ dans une moindre mesure ont compris la nécessité de se mobiliser pour appuyer les femmes québécoises le 2 avril 1977 dernier et le 8 mars 76. Le tract du GHAP comme celui de l’ADGQ disait : «Comme les femmes nous faisons les frais des rôles sexuels imposés par le système et les femmes sont nos premières alliées dans ce combat». La question de l’avortement pose toute la question de la jouissance sexuelle libre et celle du contrôle de nos corps. Se placer sur ce terrain, c’est s’opposer aux forces de droite (Pro-Vie, la CECM qui ont déjà commencé leur offensive contre l’avortement et contre les gais). Quant au PQ au pouvoir, même si «son» parti s’est prononcé majoritairement et démocratiquement en faveur de l’avortement à son dernier congrès, il a rejeté cette décision. C’est ce même gouvernement qui laisse la répression policière et la discrimination continuer contre les homosexuels et qui dit non à l’avortement.
Beaucoup de femmes, surtout celles qui militent dans le mouvement des femmes comprennent le rôle oppressif de la famille. Ce sont les alliées les plus précieuses du mouvement gai. D’ailleurs, on peut dire que l’histoire du mouvement de libération des femmes est l’histoire de la résistance de la bourgeoisie au démantèlement de l’institution qu’est la famille, une des institutions les plus fondamentales pour le maintien de l’oppression des femmes, des gais et la défense du système capitaliste lui-même.
La famille depuis la guerre
Mais que s’est-il passé depuis la guerre et dans quelle mesure le rôle de la famille a-t-il été miné ? Pourquoi a-t-on parlé de crise de la famille ? Pourquoi la bourgeoisie commence-t-elle à resserrer les cordes de sa morale plus récemment, en attaquant le mouvement des femmes et des gais ? Les descentes contre le centre des femmes en 76, le harcèlement du docteur Morgentaler, les coupures dans les budgets affectés aux garderies, l’offensive morale plus générale (descente dans les sex-shop, etc.), les descentes dans les saunas, sont des exemples concrets de ces attaques.
Dans les pays capitalistes avancés, la période d’expansion d’après-guerre a effectivement miné le rôle de la famille comme le lieu de reproduction économique et d’éducation sociale ; la sécurité sociale et la gratuité des études moyennes ont augmenté l’indépendance des jeunes vis-à-vis de leurs parents, et vice versa, l’application de la technologie et l’expansion des services ont amené plus de femmes hors du foyer sur le marché du travail. L’industrie des appareils électro-ménagers a, à sa manière grotesque, contribué à «socialiser» le travail domestique. La recherche de nouveaux marchés dans le vêtement a amené à la fois à un effacement des distinctions de sexe dans la façon de s’habiller et à une «sensibilisation» de l’homme à la mode (désirer pour mieux consommer) et une relative aisance matérielle de la dernière génération de jeunes leur a permis une certaine expression indépendante de leurs besoins culturels spontanés, l’expérimentation artistique, en vie communautaire, expérimentation sexuelle…
Tout cela est le résultat d’un développement anarchique, toléré provisoirement, mais non voulu par la bourgeoisie, teinté profondément par l’aliénation de la marchandise.
Même si le capitalisme peut tolérer différentes variantes de la monogamie ou différentes formes de famille, il est clair qu’en deça d’un certain seuil, les intérêts du capitalisme seraient menacé, i.e. si une portion substantielle de la population commençait à vivre hors des structures répressives officielles. Et c’est ce qui se passe avec la grande majorité des homosexuels qui vivent leur sexualité.
Si sortir réellement des structures répressives est impossible en système capitaliste, les contradictions par rapport à la sexualité y demeurent toujours très vives. Les homosexuels demeurent en grande majorité prisonniers de leur désir d’épanouissement social, refoulé qu’ils sont dans l’isolement social par manque de sécurité (comme les hétérosexuels d’ailleurs) tendant à se replier sur eux-mêmes et copier l’image du couple hétérosexuel en en reproduisant les contradictions, étouffant ainsi par nécessité sociale imposée la relativité et infinité du désir sexuel. Il n’en reste pas moins que si de plus en plus d’homosexuels « sortaient » et s’affirmaient publiquement et que cette situation se généralisait, il ne serait pas impossible de penser que la bourgeoisie tenterait d’institutionnaliser le mariage des gais. Mais ça n’irait pas sans problème et sans contradiction avec plusieurs secteurs réactionnaires et conservateurs de la population sans parler des problèmes que soulèveraient cette situation par rapport à la reproduction de l’idéologie bourgeoise. De toutes façons, la tendance n’est pas du tout dans ce sens au Québec. Ces commentaires peuvent paraître strictement spéculatifs, mais ils permettent de révéler les limites posées par le système capitaliste et ses contradictions.
Deux choses :
- ce développement anarchique et limité montre qu’on ne peut pas arriver rapidement et harmonieusement à la libération des sexes et de la sexualité sans planifier consciemment le dépérissement de la famille (prise en [charge] par la société des responsabilités de la nourriture et des vêtements, logement indépendant disponible pour les jeunes qui le désirent, même chose pour l’éducation;
- rien n’est définitivement acquis à travers ces développements anarchiques et non voulus; au contraire, confrontée à la fin de l’expansion d’après-guerre et à la montée des luttes ouvrières et sociales, la bourgeoisie a toutes les raisons qu’il lui faut pour cesser de tolérer la détérioration de ses institutions et pour reprendre la situation en main comme elle a commencé sérieusement à le faire depuis le début des années 70.
Cependant, la société capitaliste elle-même dans ses fondements, contient les éléments nécessaires à la disparition de la famille et à son remplacement, à la disparition des rôles sexuels par le contrôle des naissances, en augmentant le niveau économique d’une société, en fournissant ainsi la base matérielle nécessaire pour l’indépendance économique pour la jeunesse et ainsi de suite.
En même temps, cependant, le capitalisme maintient la famille et ainsi l’oppression des homosexuels et des femmes créant les conditions pour que se développent les mouvements homosexuels et des femmes modernes. C’est dans la lignée du combatif Stonewall américain que le mouvement homosexuel moderne a émergé et s’est développé en Amérique du Nord, en Europe de l’Ouest, du Sud-Ouest, dans une moindre mesure dans certains pays de l’Est.
Face à cela, les homosexuels, tout en bâtissant leur propre mouvement, doivent inscrire leurs luttes dans celles pour le renversement du système capitaliste et son remplacement par une société socialiste qui peut et doit entreprendre consciemment les tâches de remplacement de la famille et de l’abolition de la conception procréative de la sexualité.
Très schématiquement, on pourrait identifier les tâches du mouvement gai dans la révolution socialiste par :
- sa contribution au remplacement de la famille,
- à l’abolition de la division sexuelle du travail,
- à l’abolition de la conception procréative de la sexualité,
- au dépérissement de la dominance de la « primauté génitale » (vers la « génitalité polymorphe »),
- à la libération des composantes du désir (voir Eros et Civilisation, Marcuse, et Répression nécessaire et répression de surplus, Horowitz),
- à l’intégration de l’homosexualité dans l’ensemble du corps social (i.e. contre l’idéologie d’une minorité sexuelle opprimée, pour l’acceptation de l’homosexualité latente).
Quelques fragments
Les homosexuels se sont fait dérober leur histoire par les historiens « officiels ». Ceux qui, par hasard, en ont trouvé des fragments les ont vite remis sur leurs tablettes empoussiérées, de peur d’avoir des démêlés avec les tenants des versions officielles étatiques, artistiques de l’histoire, sans doute apeurés d’être accusés d’avoir des « préjugés favorables » envers les homosexuels, de peur aussi de voir leur chaire d’historien menacée. On a caché aux yeux du grand public les persécutions dont les gais ont été victimes tout au long de l’histoire. On a bien sûr aussi, et surtout, caché la joie et la solidarité qu’ils ressentent lorsqu’ils sont ensemble.
La reconstitution de cette histoire, sa connaissance, sa diffusion sont des tâches à accomplir. Les recherches débutent dans ce domaine. Il y a beaucoup à faire et c’est pourquoi le travail collectif, par petits groupes ou grands groupes, idéalement coordonnés entre eux, semble à privilégier. Il faut faire la collecte initiale de données. Le livre de Jonathan Kurz (par exemple The Gay American History) est une des contributions les plus importantes à l’histoire du mouvement gai américain des dernières années. Beaucoup de matériel existe en anglais : les débats au sein du mouvement gai anglais sont répercutés en Amérique du Nord de même que plusieurs débats internationaux, mais le francophone québécois lui, qui ne parle pas l’anglais, n’a pas accès à ces documents. Il faut assimiler, systématiser, traduire et faire notre propre production. Toujours le poids de l’oppression nationale. Des recherches s’imposent et dans le cas où elles existent (Master and Johnson, Rapport Kinsey, les études de Wilhelm Reich, de Sigmund Freud, le rapport Hite, Ford et Beach), il faut mettre en commun les connaissances sur l’homosexualité, débattre avant de pouvoir théoriquement être collectivement en possession des moyens aptes à se défendre, dans un premier temps, des accusations portées contre cette soi-disante « a-anormalité », ensuite de démontrer le caractère historique et universel de l’homosexualité. C’est ainsi qu’on pourra plus facilement envisager les enjeux de la construction d’un mouvement gai, sa nécessité, son efficacité à se battre pour une véritable libération des homosexuels.
Ce travail, déjà amorcé dans plusieurs noyaux ou cercles homosexuels, doit cependant être étroitement lié à une pratique et à des mobilisations qui permettront au mouvement de se développer, de prendre de l’expérience, des forces, et de se politiser pour comprendre le sens et la nécessité de son insertion dans l’ensemble des luttes sociales orientées vers le changement.
Quant au « mouvement homosexuel international », il en est à ses premiers balbutiements.
Nous apportons notre contribution à la reconstitution de l’histoire du mouvement gai québécois et du mouvement gai en général en rassemblant quelques fragments glanés ici et là, fragments que nous avons tenté, dans la mesure du possible, de relier à l’ensemble du champ social et politique les structurant. Nous les avons essentiellement tirés de lectures homosexuelles en anglais et de nos propres expériences de luttes avec le mouvement gai québécois.
Nous n’avions pas les énergies, le temps, nous ne voyions pas la nécessité de tout traduire, d’autant plus qu’il était important pour nous d’assimiler en même temps (et même là nous n’y sommes pas arrivés) le contenu des débats et les différentes expériences des autres mouvements gais existants ailleurs.
L’histoire des homosexuels (à part quelques sociétés homosexuelles et sociétés plus libérales à cet égard) en est une d’oppression, d’auto-répression (engendrée par les pressions sociales), et de répression dure, brutale et systématique.
Sous le régime féodal, on allumait les bûchers destinés à brûler les « sorcières » avec des ragots et des homosexuels enfagottés (d’où le terme de faggot en anglais signifiant de façon méprisante « tapette »). On nous assimilait aux fous, fin du 19ᵉ [siècle]. Avec l’avènement du système capitaliste, la répression s’est faite plus sournoise (répression idéologique au sein de la famille, renforcée par les institutions comme l’école, l’Église) et les hécatombes (bien que passées sous silence par les historiens bourgeois) plus grossières. On n’a qu’à songer aux 250 000 homosexuels envoyés aux fours crématoires par les nazis durant la 2ᵉ Guerre mondiale et épinglés du triangle rose.
Avec la consolidation des États capitalistes par les différentes bourgeoisies vers la fin du 19ᵉ siècle et du rodage des rouages législatifs, on a commencé à utiliser, en Prusse, en Autriche, en Allemagne, les lois contre les homosexuels (voir The Early Ages of Homosexual Rights Movement, par David Thorstad). Quand l’occasion se présentait, on en profitait pour ameuter l’opinion publique contre les « vilains actes des homosexuels » et lancer des campagnes anti-homosexuelles. Le procès retentissant du jeune Lord anglais Oscar Wilde, accusé de sodomie avec un mineur, fit les manchettes de l’époque et fut universellement connu. On en parle encore aujourd’hui.
À la fin du siècle dernier, des groupes d’homosexuels naissent. Le mouvement s’organise solidement en Allemagne autour de Magnus Hirschfeld, le principal leader du mouvement homosexuel allemand. Pendant près de 30 ans, le mouvement s’est mobilisé, revendiquant ses droits et surtout l’abrogation du paragraphe 175-a de la constitution allemande. Il avait développé des liens avec le mouvement ouvrier allemand de l’époque (plusieurs syndicats allemands avaient repris la demande d’abolition du paragraphe déjà cité). Cette longue lutte pour les droits fut perdue aux mains des fascistes nazis.
Après leur arrivée au pouvoir en 1933, les fascistes d’Hitler s’attaquèrent aussitôt aux mouvements de libération sexuelle et homosexuelle. Car pour les fascistes, la morale et l’ordre sexuel sont une loi d’or. En 1934, ils détruisirent l’Institut de recherche scientifique sexuelle de Reich (auquel le mouvement SEX-POL était associé), promenaient le buste de Hirschfeld sur un plateau pour le « déshonorer » et le forcer à s’exiler), faisant autodafé des principaux bouquins traitant d’homosexualité, de sexualité et de marxisme.
Ainsi, faute d’un parti communiste révolutionnaire capable d’organiser une riposte énergique aux fascistes et de diriger les masses vers la révolution socialiste, les fascistes ont réussi à écraser tout sur leur passage; brisant ainsi pour des décennies les reins du mouvement ouvrier allemand, massacrant les homosexuels.
La plupart des homosexuels allemands et européens ont subi, pendant cette dure période, injures et persécutions. Malheureusement, à la même époque, les homosexuels soviétiques subissaient la même répression. Les staliniens avaient même assimilé l’homosexualité à une tare du fascisme, alors que même les homosexuels qui avaient fait partie du mouvement nazi, comme la clique de Röhm, ont été eux aussi éliminés après la victoire nazie. Les homosexuels n’ont rien à gagner des fascistes, sinon la répression brutale, comme les homosexuels chiliens lors du coup d’État fasciste du 11 septembre 1973 en ont fait plus récemment la triste expérience. L’appui du Ku Klux Klan (organisation fasciste aux États-Unis) de Floride à la campagne d’Anita Bryant contre les homosexuels a plus récemment montré, une fois de plus, que les fascistes sont contre les homosexuels. Ce sont les mêmes fascistes qui sont contre le mouvement gai, le mouvement des femmes, le mouvement des Noirs aux États-Unis.
Ce tragique épisode de l’écrasement par les fascistes, sans doute le pire de l’histoire du mouvement gai, a entraîné une démobilisation massive du mouvement homosexuel en Europe et un recul sérieux dans la lutte pour la libération homosexuelle.
Par la suite, après la guerre, quelques groupes archi-isolés (comme Arcadie en France, groupe hyper-soucieux de respectabilité bourgeoise) ont servi de « soupape » à beaucoup d’homosexuels pendant plus d’une décennie.
Après 1968, date charnière dans l’histoire du capitalisme moderne, le mouvement homosexuel commencera à se recomposer de façon inégale.
En effet, après la période d’expansion sans précédent du capitalisme à l’échelle internationale (le boom d’après-guerre, 1950-1955), la « foire » se terminait pour les impérialistes américains. Cette période drainait avec elle ses aspects contradictoires, intrinsèquement générés par le système capitaliste lui-même.
D’une part, elle offrait pour les plus favorisés des capitalistes avancés — surtout les Américains — un surplus de richesse (sucée sur le dos des pays pauvres que l’impérialisme continuait d’exploiter), richesse permettant une plus grande expression libre des besoins et qui posait les bases objectives pour une plus grande expérimentation sexuelle ; (la bourgeoisie exerçait alors moins de contrôle moral sur la population, car elle en avait moins besoin étant donné sa prospérité) ; richesse qui posait aussi les bases objectives pour une plus grande expression libre des besoins et des aspirations de la jeunesse en général ; bases objectives aussi pour le développement du mouvement gai (aspect progressiste du développement inégal du capitalisme).
D’autre part, cette période mettait au grand jour les limites du capitalisme, révélait sa nature profondément oppressive même, en générant une crise de l’idéologie bourgeoise qui continuait de véhiculer les vieux schémas incompatibles avec « tant de liberté ».
En générant une prise [de conscience] de la famille, des institutions, en générant des phénomènes de révoltes de la jeunesse, en donnant naissance au mouvement contre-culturel (phénomènes relativement tolérés dans la mesure où le pouvoir de la bourgeoisie n’était pas directement menacé et qu’elle pouvait récupérer la majeure partie de la contestation par des avantages matériels sans précédent).
Mais les chantres du « capitalisme éternel » ont ravalé leurs beaux discours. Le même genre de crise cyclique prévue par Marx, plus de 100 ans auparavant, réapparaissait. C’était la fin du boom expansionniste, le début d’une période indéterminée de récession plus ou moins généralisée.
Déjà, Kennedy ordonnait la guerre au Vietnam, machine à sous facile et machine de propagande anticommuniste par excellence. C’était le massacre des Vietnamiens. La jeunesse mondiale et américaine se révolte, se mobilise. C’est le mouvement anti-guerre. Par décantation affective et idéologique, le mouvement anti-guerre permet des prises de conscience « nouvelles » de la part des femmes et des homosexuels, qui font pratiquement l’expérience de leur oppression dans le mouvement. Les femmes subissaient la discrimination. C’est ainsi que les premiers militants du futur mouvement homosexuel et du mouvement des femmes (américain) faisaient leurs premières armes, dans le mouvement anti-guerre.
Aujourd’hui, après mai 1968 en France, où étudiants et ouvriers ont posé la question du pouvoir en érigeant leurs barricades par-dessus la tête des bureaucrates syndicaux ; après l’invasion de la bureaucratie russe en Tchécoslovaquie, après l’offensive du Têt lancée par les Vietnamiens pour finalement faire reculer l’impérialisme américain, le rapport de force entre la bourgeoisie et le prolétariat à l’échelle mondiale s’est relativement modifié pour donner l’espoir de révolutions socialistes victorieuses dans plusieurs pays. La crise du capitalisme s’est installée dans tous les pays capitalistes avancés.
De même, les masses ouvrières et populaires, opprimées par leur bureaucratie d’État dans les États ouvriers bureaucratisés et dégénérés de l’Est, déjà se sont insurgées à maintes reprises, posant elles aussi (Hongrie, Tchécoslovaquie, Pologne) la question du pouvoir.
Toute cette effervescence, couplée à la crise du stalinisme (comme courant prédominant du mouvement ouvrier international jusqu’à ce moment), a stimulé les couches opprimées de la population comme le mouvement des femmes et le mouvement des homosexuels.
Les attaques législatives sournoises plus récentes de la bourgeoisie (qui sent son pouvoir ébranlé par la crise) contre les acquis légaux des différents mouvements ouvriers, des femmes et des homosexuels, attaques couplées à la répression policière, contribuent à mousser le militantisme des différents activistes. Aux USA, par exemple, le Congrès américain a adopté en 1977 des amendements stipulant que sous aucune condition, une aide légale ne pouvait être accordée dans un litige quelconque concernant les droits des homosexuels.
Le Sénat y a mis du sien en ajoutant un amendement qui refuse qu’un couple homosexuel soit logé dans un logement subventionné par des fonds publics. Pour démontrer qu’elle est au diapason avec la Chambre des représentants et le Sénat en matière de droits des homosexuels, la Cour suprême a confirmé le caractère constitutionnel des lois contre la sodomie promulguées par certains États.
La plupart des pays d’Europe ont maintenant leur mouvement homosexuel, qui mobilise à ses propres rythmes et qui débat des enjeux politiques de la lutte des homosexuels, comme sa liaison au mouvement des femmes et au mouvement ouvrier. En France, le GLH (Groupe de libération homosexuelle) organise des manifestations de milliers de personnes. En Italie, le FUORI est actif nationalement. En Espagne, près de 10 000 gais et lesbiennes descendaient dans la rue cet été 1977 pour demander amnistie et liberté. Au Portugal, la révolution des Œillets a donné lieu à la naissance du MHAR. En Angleterre, le mouvement gai, bien qu’éprouvant certaines difficultés à se structurer à l’échelle nationale, a dû affronter à maintes reprises les fascistes dans la rue et s’en est sorti souvent victorieux.
Dans les États ouvriers bureaucratisés, le mouvement homosexuel s’organise aussi.
Alors qu’en Europe, la crise du capitalisme servait de moteur principal au « sortir » et à la mobilisation des gais, en Amérique du Nord, les événements de la rue St-Christopher à New York donnaient le coup d’envoi au mouvement gai le plus fort et le plus puissant de toute l’histoire des homosexuels. En 1969, à Stonewall à New York, les homosexuels, après avoir connu une période de relative liberté sexuelle, faisaient reculer les flics lors d’une descente dans un bar, avec des bouteilles cassées. Il y eut même des morts. C’est ce qui faisait dire à un article de Temps Fou n°2, que les caciques locaux ont sans doute tiré les leçons de Stonewall en envoyant les flics faire leurs descentes avec des mitraillettes dans les bars de Montréal. Plusieurs ont érigé en théorie cette période de relative liberté sexuelle, en prévoyant la libération des homosexuels comme processus linéaire ascendant (le GHAP – Groupe homosexuel d’action politique – dans son texte d’orientation exprimait son désaccord face à cette relative « libéralisation » en soulevant les problèmes de répression, l’enfermement dans le ghetto, en essayant de tracer les limites de la tolérance bourgeoise). À Stonewall, les homosexuels faisaient de l’agitation pendant une semaine sur la rue St-Christopher et avaient gain de cause des autorités municipales : la paix et leurs quartiers à eux.
Aujourd’hui, le mouvement gai américain dans la plupart des grandes villes américaines, et dans certaines régions comme la Californie, rayonne par sa présence. Sa force s’évalue à l’ampleur de la riposte à Anita Bryant dans une série de grandes villes (300 000 à San Francisco l’été 78) qui a dû reculer vite dans son terrier publicitaire d’annonceuse de jus d’orange. Il est sur le chemin de la conquête de ses droits, de sa politisation, de sa coordination. Il fait écho dans la population. Les réactionnaires locaux font campagne contre lui. On essaie sur la côte du Pacifique d’enlever, avec l’amendement Briggs, le droit aux homosexuels d’enseigner, de travailler dans le secteur public. Des appuis d’autres secteurs opprimés de la population, de la résistance immédiate aux fascistes dépendra l’issue de cette bataille.
Dans ce contexte, la lutte pour les droits démocratiques élémentaires à vivre sa sexualité librement est fondamentale, mais elle doit tenter d’y impliquer d’autres secteurs opprimés de la population : le mouvement des femmes, des Noirs, des ouvriers. Surtout qu’en cette période plus difficile pour la bourgeoisie, tout sera fait pour tenter de rogner par tous les moyens les acquis passés et pour résister aux lobbyings. La nécessité de rompre l’isolement du mouvement en créant des alliances dans le mouvement des femmes, dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement populaire devient urgente face aux attaques de la bourgeoisie.
Le mouvement gai au Canada
Faisant écho à la résistance de leurs frères gais américains à Stonewall, à la percée des fronts de libération gaie à travers les USA, sont apparus les premiers groupes de militants au Canada. Les leaders de ces groupes ont été impliqués ou touchés par le courant « Nouvelle gauche » (New Left) et se sont définis comme « radicaux », donnant leur appui aux mouvements anti-guerre et à d’autres mouvements sociaux. Ce sont ces groupes qui ont donné le premier assaut public contre l’hétéronormativité, allant dans les clubs hétérosexuels et organisant des contingents dans les manifestations anti-guerre. Incapables de fonder leur action sur une stratégie cohérente de lutte, ils se sont effondrés après l’euphorie des débuts.
Les lesbiennes qui se sont impliquées dans les premiers groupes existants ou dans les groupes « radicaux » ont été influencées par la montée du mouvement féministe. Plusieurs d’entre elles ont commencé à réaliser qu’elles continuaient d’être opprimées dans les groupes gais dominés par des hommes. Les hommes se sont à peine occupés des préoccupations des femmes. Plusieurs lesbiennes ont quitté ces groupes pour former leurs propres collectifs ou pour jouer un rôle actif au sein du mouvement féministe. Plus récemment, les lesbiennes ont formé leurs propres groupes autonomes qu’elles regroupent dans une organisation comme la Lesbian Organization of Toronto. À quelques endroits, comme en Colombie-Britannique, les lesbiennes se sont d’abord organisées dans le mouvement des femmes, dans ce cas, dans la B.C. Confederation of Women. On a aussi parlé de mettre sur pied une organisation de lesbiennes à travers le Canada.
Après l’effondrement de la première vague « radicale », les militants gais mâles se sont regroupés autour d’une stratégie de lutte pour les droits. Cette stratégie consistait en une lutte publique pour l’égalité avec les hétérosexuels, pour la protection légale des homosexuels et contre les lois anti-gais. Cette stratégie avait le mérite de mettre de la pression publique pour l’obtention des droits, mais s’écartait de l’aspect radical véhiculé par les premiers groupes qui n’avaient pas manqué de mettre en question la famille, les rôles sexuels, et la nature même du système capitaliste. Une coalition pour les droits des gais fut mise sur pied à l’échelle du Canada. Elle s’appelle maintenant : Coalition pour les droits des gais et des lesbiennes.
Depuis un an et demi, les attaques contre les gais et les lesbiennes se sont accentuées : répression policière, descente au Body Politic (journal gai), bigoterie réactionnaire des médias, assauts des réactionnaires dans la rue, tournée d’Anita Bryant, montée d’une droite anti-gaie (particulièrement une organisation nommée Renaissance qui a organisé la tournée d’Anita Bryant). Mais les lesbiennes et les gais ont riposté en grand nombre : 1 000 à Toronto, 350 à Winnipeg, 350 à Edmonton, 200 à Moose Jaw, etc.
La jeunesse gaie a aussi fait une percée publique, luttant pour ses droits en mettant sur pied une coalition binationale. Au cours de ces mobilisations contre la répression et la droite, les lesbiennes ont joué un rôle dirigeant et ont tissé des liens avec le mouvement féministe. Malheureusement, ces actions n’ont pas réussi à vraiment se coordonner à travers le Canada, ce qui aurait pu renforcer l’impact de la riposte.
La montée de la répression et de la droite crée une nouvelle situation pour l’orientation des luttes. La stratégie de lutte pour les droits n’est plus suffisante. Il faut que les gais et les lesbiennes organisent des actions de masse et soient capables de combattre les mensonges de la droite et la bigoterie des réactionnaires.
Pour y arriver, il faut soulever toute la question de la répression sexuelle, l’oppression de la jeunesse dans la famille et à l’école, le droit d’exister hors de la famille et des rôles sexuels stéréotypés, et expliquer comment la lutte des lesbiennes et des gais est dans l’intérêt de tous les opprimés dans le combat pour la liberté sexuelle.
En résumé
En résumé, on peut identifier une première phase du mouvement gai entre 1864 à 1934-35. Il s’est fait sous l’influence de la révolution bourgeoise et des bouleversements politiques et sociaux qui ont donné naissance au mouvement ouvrier allemand. Ces leaders ont développé une perspective libérale exclusive de luttes pour les droits. C’est ce mouvement qui a influencé les bolcheviks pour la libéralisation de l’homosexualité en 1917.
Deuxièmement, on parle de l’émergence du mouvement gai moderne à la fin des années soixante, mouvement qui a émergé dans un contexte de crise sociale, principalement aux USA, au moment où les mouvements anti-guerre, noir, féministe battaient leur plein. À partir de la révolte de Stonewall aux USA en 1969, les mouvements gais sont apparus dans la plupart des pays capitalistes avancés. Apparaît de façon cristalline une contradiction fondamentale par rapport à la sexualité au sein du système capitaliste. Le développement social, économique, scientifique et culturel du 20e siècle a posé les BASES MATÉRIELLES POUR LA SÉPARATION DE LA SEXUALITÉ D’AVEC LA REPRODUCTION, de même que pour la création de meilleures relations sociales, et LE CAPITALISME (PAR SA NATURE INTRINSÈQUE) FREINE LE DÉVELOPPEMENT DE CETTE CONTRADICTION ET LE PROCESSUS DE LIBÉRALISATION SEXUELLE.
De plus, la crise de la famille s’est exacerbée par l’ampleur des révoltes des femmes, celles des jeunes, l’accroissement de l’éducation des femmes, l’intégration des femmes dans la force de travail. On a aussi vu une augmentation du nombre de ceux qui fuient la famille, l’augmentation du divorce qui ont contribué à cette crise. Le développement technologique qui a permis l’avortement et la contraception a aussi contribué à accentuer cette crise de la famille. Quant aux mouvements contre-culturels et à la « nouvelle gauche », ils ont questionné la famille et tenté d’y trouver des alternatives.
Les mouvements de protestation des années 60 et les contradictions du système ont affaibli l’hégémonie idéologique de la classe dominante dans plusieurs domaines dont la sphère sexuelle. On stimule le désir pour de meilleures formes de sexualité et on ne présente aucune alternative au modèle.
La contradiction entre la possibilité réelle de la révolution sexuelle en même temps que cette possibilité était niée par les relations sociales existantes est une des CONTRADICTIONS FONDAMENTALES QUI A CONDUIT À L’ÉMERGENCE DES MOUVEMENTS GAIS ET FÉMINISTES MODERNES.
Le mouvement gai moderne a développé, sous l’influence de la révolte de Stonewall, une approche plus radicale que celle de son homologue des années 1864-1934-35. Ses militants les plus avancés ont tenté de montrer l’importance de lier les luttes et objectifs du mouvement à celles et ceux du mouvement des femmes et du mouvement ouvrier. Son orientation n’est plus exclusivement centrée sur l’obtention des droits.
De plus, les militants voient l’homosexualité et le lesbianisme comme un potentiel pour tous, ils et elles ne quémandent plus seulement la tolérance mais sortent publiquement dans la rue pour crier leur fierté et leur joie d’être gai.
Essai critique sur l’histoire du mouvement gai québécois 1970-1977
Avant le FLH (Front de libération des homosexuels)
Suite à son écrasement sous la botte fasciste pendant la Deuxième Guerre mondiale (plus de 250 000 homosexuels tués), le mouvement homosexuel européen prendra 20 ans à se relever. Après la guerre, l’impérialisme américain en pleine expansion divisait, à l’extérieur de ses frontières, la Corée en 2 (1954) pour faire échec à l’influence communiste après la puissante victoire de la révolution chinoise en 1949, tandis qu’il sonnait (avec McCarthy) le clairon de la chasse aux sorcières contre les communistes, harcelant les militants progressistes. L’interdiction du film La Rumeur, qui raconte l’ampleur de l’oppression sociale qui s’abat sur deux jeunes filles, au cours de la même période, montre que cette chasse s’étendait aussi aux homosexuels.
Ce climat social tant propice à l’accumulation du capital et si vanté par les chantres du capitalisme qui ne juraient que par son éternité, contribuait à marginaliser, à étouffer, sinon à réduire à sa plus simple expression toute contestation de l’ordre établi.
Cette vague de moralité et d’anticommunisme déferlait sur le Québec où Duplessis (qui vendait pour un plat de lentilles — dixit Lévesque — nos richesses naturelles aux Américains) en profitait pour faire tirer sur les grévistes d’Asbestos par la Sûreté du Québec en 1949, et sur ceux de Murdochville, de Louisville un peu plus tard. Durant cette longue période noire, les homosexuels québécois, eux aussi victimes de l’oppression nationale, se débrouillaient comme ils le pouvaient dans cette mare de droiture et de morale renforcée par l’idéologie obscurantiste catholique. Le clergé s’occupait alors de «l’éducation» (il faudrait dire du dressage des enfants), les plus récalcitrants passant à la strappe. Cette idéologie faisait de l’homosexualité la pire des abjections qu’il fallait éviter à tout prix. Pour celui qui osait lever le petit doigt pour contester, surtout avec la mentalité d’esprit de famille et de clocher qui régnait, c’était la réprobation générale, la honte. Les homosexuels connaissent malheureusement mal cette période de leur histoire qu’il faudrait reconstituer.
Puis la mort de Duplessis en 1959 ouvrait la porte qui allait frayer le passage, difficile accouchement, à l’apparition des homosexuels sur la scène politique québécoise, 12 ans plus tard. Reléguant l’idéologie obscurantiste duplessiste aux oubliettes, les forces libérales «progressistes» amorçaient (sous le dictat des impérialistes américains qui avaient besoin d’un Québec plus «moderne» pour s’adapter aux impératifs de l’accumulation du capital américain) un processus de réformes sociales – laïcisation de l’éducation – et de modernisation de l’infrastructure et de l’appareil d’État bourgeois. On a ainsi connu une baisse progressive et rapide de la pratique religieuse qui a permis à nombre de gais de se déculpabiliser et à rendre moins difficile l’acceptation de son homosexualité.
À la même époque, naissaient au Québec plusieurs groupes nationalistes et socialistes (dont les objectifs étaient la lutte pour l’indépendance), auxquels participaient plusieurs homosexuels ; certains devenaient même parmi les leaders des grandes mobilisations extraparlementaires des années soixante.
Puis, les années charnières 1969-1970 amenaient une série de grands événements et politiques rapprochés qui les secouaient suffisamment pour leur faire picorer leur dure coquille. L’invasion du Québec par l’armée canadienne en 1970, le Stonewall américain en 1969, l’influence du courant contre-culturel américain, le mouvement anti-guerre, la force du mouvement nationaliste extraparlementaire au Québec furent autant de préludes à la prise de conscience individuelle de cette situation d’isolés et de marginalisés sociaux et au désir de trouver des alternatives collectives à cette situation, au ghetto. Ainsi, après le FLQ (Front de libération du Québec), le FLF (Front de libération des femmes), la situation était mûre pour la naissance du FLH.
Du FLH au CHAR (Comité homosexuel anti-répression) 1971-1976
On peut dire que le mouvement des homosexuels québécois est né au printemps 1971 avec la création du Front de libération des homosexuels (FLH). En février 1971, lors du 3e numéro de Mainmise (porte-parole du mouvement contre-culturel au Québec), on peut lire quelques articles traitant de l’homosexualité, articles traduits de l’américain. Dans ce même numéro, un article appelait à la création d’un front de libération des homosexuels à Montréal. Plusieurs meetings initiaux conduiront à la création du FLH.
Le 1er juillet, un contingent impressionnant (près de 100 personnes) s’organise lors d’une manifestation contre la Confédération. Cette apparition pour le moins inusitée au Québec surprit les autres manifestants et provoqua un considérable sentiment anti-homosexuel. Un manifestant homosexuel qui n’hésita pas à braver la foule, s’empara du micro, qu’on ne lui aurait jamais laissé approcher, et s’écria : «Nous aussi les tapettes, on est avec vous autres», en parlant de la lutte pour la libération nationale. Cette phrase lancée avec détermination essayait peut-être de contrebalancer à sa façon la boutade anti-homosexuelle dirigée contre Trudeau : «Trudeau la tapette», dans le manifeste du FLQ lu en pleine télévision durant les événements d’octobre, 9 mois plus tôt.
Même si, à dessein, cette boutade visait, à juste titre, à dénoncer et à rabaisser celui qui (au service de la grande bourgeoisie canadienne) nous avait envoyé son armée pour mater le mouvement nationaliste, elle ne faisait que discréditer aux yeux des militants progressistes nationalistes, aux yeux de la population en général, aux yeux des homosexuels eux-mêmes, les homosexuels dans la société. Cette boutade handicapait idéologiquement aussi la montée du mouvement, renforçant l’auto-répression des homosexuels en leur donnant une image réactionnaire et dégueulasse d’eux-mêmes, en les identifiant à l’oppresseur Trudeau, accentuant la distance entre le mouvement de la classe ouvrière et des couches exploitées de la population dont se réclamait le manifeste du FLQ.
Cette manifestation de juillet 1971 fut la première, mais non moins éclatante apparition publique du mouvement homosexuel naissant au Québec.
La naissance du FLH, c’est-à-dire les premières tentatives sérieuses pour jeter les bases d’un mouvement autonome d’homosexuels, a été motivée par le même genre de conditions qui avaient poussé les homosexuels américains et canadiens anglais des mouvements contre la guerre au Vietnam à se regrouper pour poser le problème de leur oppression spécifique, comme les femmes d’ailleurs.
Les homosexuels militants activement dans les luttes et mobilisations nationalistes extraparlementaires des années soixante (McGill Français, Bill 63, libération de Vallières-Gagnon), même s’ils partageaient les mêmes idéaux de libération de la nation québécoise que les militants progressistes hétérosexuels avec qui ils militaient, commencèrent à refuser la discrimination qui leur était faite et aussi à refuser de refouler leur sexualité plus longtemps.
Les premières manifestations du mouvement homosexuel québécois furent ainsi conditionnées plus spécifiquement par les mobilisations nationalistes-étudiantes extraparlementaires des années soixante, par leur radicalisation sur la question nationale, plus généralement par l’influence du mouvement homosexuel américain, par celle du courant contre-culturel.
Les rythmes des mobilisations nationalistes et étudiantes ont ainsi moussé le militantisme des membres du FLH et conditionné sa seule apparition politique au début des années 70. Cependant, né deux ans après l’entrée fracassante du mouvement des femmes sur la scène politique en 1969, qui s’enchaînait dans la rue pour protester contre le règlement anti-manifestation promulgué par le maire Drapeau, le FLH, tout comme le FLF, se désintègre dans le cadre de la vague de dépolitisation du mouvement étudiant qui a suivi les événements d’octobre 1970. Son impact sur la scène politique fut faible bien que «choquant». Il fut essentiellement dans l’ombre du mouvement nationaliste.
Le FLH perdit plusieurs membres en novembre 1971, quelques-uns plus conscients, refusant ou renonçant après plusieurs tentatives à politiser les réunions dominées par l’autoritarisme morbide de quelques-uns, un byzantinisme et une structurite aiguë aptes à faire fuir n’importe qui. Il devint un groupe de service à la communauté à partir de ce moment. Le 17 juin 1972, il ouvrait son nouveau centre en organisant une danse. Aux petites heures, une descente de police arrêtait 40 personnes parce qu’ils se trouvaient dans un établissement qui vendait de l’alcool sans permis. Même si les accusations furent retirées pour des raisons techniques, les homosexuels furent pris de panique et n’y retournèrent point. Le FLH mourait ce même automne, incapable de développer des perspectives politiques claires pour construire un mouvement homosexuel au Québec, incapable de fournir une analyse suffisante des causes de l’oppression des homosexuels dans la société et d’en dégager une stratégie pour s’attaquer à la racine de ces causes et travailler à une véritable libération des homosexuels, incapable aussi de situer cette oppression par rapport aux autres formes d’oppression dans la société (oppression nationale, oppression et exploitation des travailleurs et des travailleuses, oppression et surexploitation des femmes, oppression des immigrants, des couches opprimées et pauvres de la population) et d’éviter ainsi d’œuvrer seul.
Ainsi s’éteignait, en dernière instance, frappée par la répression policière (leitmotiv maintenant connu des homosexuels) le premier groupe homosexuel de Montréal qui avait réussi à rejoindre et à rassembler le plus important nombre d’homosexuels en dehors du ghetto proprement dit et cela avant la répression olympique.
À ses tous débuts, ayant reçu la pichenotte des contre-culturels, incapable d’offrir des perspectives, le FLH mourait au moment même où le mouvement ouvrier prenait place sur l’avant-scène politique. Le Front commun 72 où l’ensemble des travailleurs et travailleuses du secteur public et para-public posaient de façon embryonnaire la question du pouvoir (occupation de radios, de ville comme Sept-Îles, commençaient à fixer les prix). Combien d’homosexuels (des hôpitaux surtout) ont participé à ce soulèvement sans précédent en Amérique du Nord.
Dans la Taupe Rouge No 1 (journal du GMR, composante fondatrice de la LOR) Michel Mill décrivait ce mouvement avec netteté :
Le soulèvement extraordinaire du 9 au 15 mai était sans précédent sur le continent nord-américain depuis la grève générale de Winnipeg en 1919. Sans direction, sans coordination nationale sans structures sauf celles boîteuses et datant d’une semaine ou deux des Fronts communs régionaux, les militants ont organisé non pas une grève légale et passive, mais une grève générale sauvage et active. Il s’en est suivi un refus d’obéir à un État qui n’est pas le leur, une démocratie active sans distinction de secteur, de métier ou de centrale, une unité syndicale et politique qui dépassait de loin l’unité timide et jalouse des dirigeants en haut et finalement une action de contrôle ouvrier sur l’information, sur les écoles (Cégeps parallèles) sur la médecine (Institut Albert Prévost) et sur des villes entières.
Comme on peut le voir, cette période d’intenses luttes sociales aurait pu permettre au FLH, si sa direction avait eu une orientation ouvrière, de s’insérer ce mouvement et de poser toute la question de la répression sexuelle.
Et c’est dans le sillage du FLH que le mouvement a continué de mûrir. Certains militants parmi les plus conscients du FLH se sont dispersés (achetant des fermes, menant une vie de couple) un peu désabusés, d’autres ont fait partie d’autres groupes, assurant ainsi la continuité historique de la conscience des homosexuels québécois, parcourant péniblement (individuellement ou en groupe) leur démarche.
Le GHAP (Groupe homosexuel d’action politique)
Vers 1974, au moment où le mouvement des femmes commençait à se recomposer sous la poussée des luttes ouvrières, un groupe d’homosexuels pro-féministes distribuaient, à l’une des fameuses danses à McGill, des tracts appelant à appuyer la lutte des femmes le 8 mars. Ces tracts dénonçaient l’année internationale des femmes proclamée par l’ONU comme une manœuvre visant à récupérer les luttes des femmes dans le monde; les tracts appelaient les homosexuels à se manifester publiquement. On voyait poindre (l’expérience se répétant l’année suivante sous l’initiative du GHAP) chez les homosexuels l’émergence d’une prise de conscience plus structurée de leur oppression de même que les jalons épars pouvant mener à l’élaboration de perspectives politiques pour la construction d’un mouvement gai au Québec. Les homosexuels du GHAP se définissaient clairement comme anti-capitalistes tout en se référant à certains éléments de l’analyse marxiste de la société, identifiant les racines et les causes de l’oppression des homosexuels dans la structuration du système. Ils entendaient systématiquement dénoncer toute manifestation de discrimination à l’égard des homosexuels, où qu’elle soit. Un de ses slogans résume bien sa pensée : « On n’est pas des malades, c’est l’système quié malade ».
Le GHAP considérait aussi comme une nécessité objective de lier la lutte des homosexuels contre leur oppression à celle des femmes et à celle des travailleurs dans une tentative pour briser l’isolement du mouvement gai et comme alternative à la simple lutte pour les droits démocratiques. Il considérait la lutte pour les droits quelque chose de moindre importante, car « tant que le système capitaliste ne sera pas renversé, il ne pourra y avoir de véritable libération homosexuelle ». À l’époque, les militants du GMR, et membres du GHAP, étaient d’accords avec ce raisonnement.
Nous croyons qu’une telle attitude, que poser ainsi les termes du débat ne pouvait mener qu’à une relative sectarisation/marginalisation du GHAP par rapport au milieu gai. La lutte pour les droits même si limitée, représentait alors pour les quelques militants dégagés des luttes antérieures la seule perspective à terme susceptible de rallier les homosexuels à la construction du mouvement pour ne pas condamner le mouvement gai à l’isolement. La fondation de l’ADGQ se situait dans cette perspective. Cette stratégie aurait dû se combiner, cependant à une perspective de liaison aux luttes des femmes et à celle du mouvement ouvrier, à la lutte contre la répression policière. Ceci dit le bilan du GHAP reste à faire.
Aujourd’hui le PQ au pouvoir a passé la loi 88 et les homosexuels se rendent bien compte (comme les gais de la LOR l’avaient mentionné à maintes reprises) qu’entre le passage d’une loi et son application, il y a une marge. Car il y a toujours des forces réactionnaires qui n’entendent pas (sexologues, commissaires de la CECM, catholiques puristes à Québec, Pro-Vie) rester tranquilles et respecter une loi qui ne fait pas leur affaire. Face à cela, seules des mobilisations massives comme celle du CHAR et celle du 22-23 octobre 77 au soir contre les arrestations au Truxx peuvent établir un rapport de force nécessaire à tenir en échec ces forces sociales anti-homosexuelles.
Il faut aussi souligner que la naissance des groupes homosexuels marxistes n’est pas un phénomène unique au Québec. Dans plusieurs pays d’Europe comme le souligne Jean Nicolas dans son article La question homosexuelle, une nouvelle génération du mouvement tente de lier ses luttes à celles des femmes et à celles de la classe ouvrière. Sous l’impact de la montée des luttes des femmes elles-mêmes étroitement liées aux luttes du mouvement ouvrier depuis 1970 à travers le monde, luttes exacerbées par la crise généralisée du capitalisme, les militants gais ont essayé de comprendre la nature de leur oppression et de commencer à réfléchir pour l’élaboration de perspectives en vue de la construction d’un mouvement homosexuel.
Au Québec, beaucoup de facteurs politiques contribuent à radicaliser les homosexuels. Beaucoup d’entre eux travaillent dans les hôpitaux et ont connu et connaîtront les lois matraques genre 253 de l’État bourgeois. Beaucoup affrontent quotidiennement les patrons dans leur milieu de travail, à l’usine. Le poids de l’oppression nationale se fait aussi sentir dans tous les secteurs de l’activité quotidienne.
En plus ils doivent affronter la répression qui leur tombe durement, parfois sauvagement dessus (descentes répétées, harcèlement, caméra de TV dans les places publiques, arrestations policières, attaques physiques par des bandes de jeunes réactionnaires dans les parcs souvent encouragés par les policiers, sollicitation par les flics dans les pissotières, descentes avec mitraillettes, censure à la TV, reportage tronqué dans les journaux, refus par Le Devoir de couvrir la manifestation du CHAR en juin 76, refus du gouvernement de faire retirer les accusations contre les arrêtés du Truxx, de faire cesser le harcèlement policier, « nettoyage » pré-olympique, CECM, Pro-Vie, réactionnaires de toutes sortes, molestement des lesbiennes chez Jojo avant les olympiques, chez Jelly’s, etc.) Les homosexuels subissent ainsi un traitement, comme beaucoup d’autres citoyens québécois, inacceptable et des entraves les plus violentes aux droits démocratiques les plus élémentaires. Pour nous cette situation n’est pas un hasard, mais est directement déterminée par la lutte des classes au Québec, que le gouvernement péquiste ne pourra pas « enrayer », car il se dit en faveur du système capitaliste et de l’entreprise privée.
Le CHAR et la riposte à la répression
Après l’échec du FLH à offrir des perspectives claires pour bâtir un mouvement gai au Québec, après les difficiles piétinements des différents groupes existants pour trouver des « alternatives » à l’oppression du ghetto, suite à la marginalisation extrême des militants homosexuels, face au mouvement ouvrier qui prenait, après l’expérience du FRAP et du FLQ en 1970, la place sur l’avant-scène sociale, suite aux difficultés du GHAP à se lier au milieu et articuler sa perspective d’appui aux luttes des femmes et à celles du mouvement ouvrier à celle de la lutte pour les droits, la sauvage répression pré-olympique (près de 120 arrestations au Sauna Neptune) donnait naissance à une coalition anti-répression (CHAR) qui mobilisait pour la première fois dans l’histoire du Québec et du mouvement gai au Québec, 800 homosexuels et lesbiennes dans la rue.
Les homosexuels et lesbiennes le 19 juin 1976 portaient bien ahut et fièrement une gigantesque bannière (À BAS LA RÉPRESSION POLICIÈRE) et sortaient (non sans une certaine crainte vite dépassée) dans les rues de Montréal, affrontant les sarcasmes de certains puristes, et en colère scandaient : « LES FLICS, HORS DES BARS, HORS DES SAUNAS », « NOS DROITS, TOUT DE SUITE ». Toute cette répression visait clairement d’après son ampleur à casser le mouvement gai québécois avant qu’il ne se développe (ILS N’ONT DE TOUTE ÉVIDENCE PAS RÉUSSI). 300 gais et lesbiennes, dont le contingent tranchai nettement par son dynamisme, criaient : « ON N’EST PAS DES MALADES, C’EST L’SYSTÈME QUIÉ MALADE », « LEURS JEUX ON LES PAIERA PAS », « RETRAIT DE TOUTES LES ACCUSATIONS », « ARRÊTER LES DESCENTES DANS LES BARS ET LES SAUNAS ».
Le CHAR s’est organisé rapidement en se donnant une structure militante et démocratique (un comité de coordination élu et révocable de semaine en semaine et contrôlé par l’assemblée générale qui réunissait de 50 à 100 personnes). Malgré les divergences d’opinion sur la façon de mener la lutte (divergences qui ont donné lieu à des débats, parfois houleux, mais tranchés par des votes démocratiques en AG), la ligne de la majorité était appliquée dans la plus grande unité d’action qui a permis de faire reculer l’administration à Drapeau, à faire diminuer la répression, et ceci même pendant les Olympiques. Le CHAR restera le symbole d’une première victoire gravée dans l’histoire du mouvement gai au Québec. Les débats au sein du CHAR ont permis aux homosexuels québécois (où pour la première fois les francophones étaient majoritaires depuis le FLH) de se parler pour organiser des actions concrètes; ça n’a pas traîné, la riposte fut rapide et efficace. Malgré les difficultés inhérentes au début, les difficultés de chacun à s’exprimer (c’est un peu normal, on commence à peine à avoir une langue bien à nous autres), ces débats sont nécessaires. Ils ne peuvent qu’aider à comprendre les enjeux des luttes à mener. Il faut souligner à cet égard l’importance d’un slogan qui fut rejeté en assemblée générale : « Que les gais soient solidaires des autres groupes frappés par la répression; militants du Front commun, immigrants, clochards, militants de la gauche ». Plusieurs militants ont compris la nécessité d’accepter un tel slogan, mais l’ensemble de l’assemblée l’a rejeté. Nous croyons qu’il est absolument essentiel pour le mouvement homosexuel de poser des gestes concrets qui lui permettront de se lier aux autres secteurs opprimés de la population. Les homosexuels ont toujours été isolés des autres secteurs de la population, et cette division est entretenue volontairement par la bourgeoisie : nous devons briser cette dynamique qui ne pourra que renforcer en retour le mouvement gai. Alors que le CHAR recevait l’appui du RCM, de la gauche, les militants refusaient d’appuyer les autres opprimés directement frappés comme eux par la répression pré-olympique. Stuart Russel, membre du comité de coordination du CHAR, a été victime à titre individuel de cette répression.
Il faut tirer une très importante leçon de cette expérience. Voter pour cette motion d’appui aurait pu avoir un impact réel sur les militants québécois (quels qu’ils soient) en général. D’autres occasions se présenteront pour les militants d’appuyer d’autres groupes opprimés dans la société. Cette attitude d’appui ne pourra qu’avoir un effet de retour sur le mouvement lui-même.
Malgré une conscience accrue de leur oppression depuis 1970, les homosexuels québécois ont éprouvé une certaine lenteur à traduire de façon concrète dans la formation de groupes autonomes d’homosexuels, dans la mise de l’avant de revendications spécifiques aux homosexuels lors des luttes syndicales et autres, dans la production culturelle exprimant leur oppression et à lui donner une expression, une forme organisationnelle. Au niveau de la gauche révolutionnaire, il a fallu et il faudra que les militants homosexuels, membres de ces organisations, mettent de la pression, de même que les différentes organisations gaies, pour que la question commence à être discutée et assumée politiquement dans leur organisation.
À l’heure actuelle, malgré l’essor remarquable de l’acceptation de soi (« sortir ») en tant qu’homosexuels par les Québécois, acceptation sociale aussi, phénomène beaucoup plus visible depuis la manifestation du 19 juin 76, le mouvement en est encore à ses débuts. Faute d’unité, faute de niveau de conscience suffisant, les différents groupes homosexuels existants sont assez isolés et leurs luttes le sont de même. Seule l’ADGQ, à Montréal, commence sérieusement à tenter de regrouper les forces.
On pourrait dire qu’au Québec, la radicalisation des homosexuels se fait à deux niveaux : d’une part, ceux qui sont déjà radicalisés à travers la lutte spécifique politique qu’ils mènent dans leur milieu, et qui prennent conscience de leur oppression au cours de leur expérience militante ; d’autre part, ceux qui prennent d’abord conscience de leur oppression en tant qu’homosexuels dans la société capitaliste (à cause de leur oppression quotidienne, de la répression policière, de la réaction de la droite), sans pour autant automatiquement évoluer vers une conscience anticapitaliste. Il faut dire que c’est cette prise de conscience généralisée de l’oppression spécifique en tant qu’homosexuels qui fait le plus défaut actuellement. Il faut saisir l’importance de ces questions : le refoulement sexuel, le rôle de la famille, le couple, les institutions sociales au service de la répression des homosexuels, la nature du système qui opprime, toutes les questions touchant de près ou de loin à l’oppression. La compréhension de ces divers éléments est indissociable d’une compréhension de la nature et du comment va se faire ce changement social, et de la nécessité de bâtir une société socialiste pour transformer tous les aspects aliénés de la vie quotidienne, pour la construction du mouvement gai.
Un autre facteur a retardé historiquement le développement du mouvement gai au Québec : c’est le poids de l’oppression nationale. Les homosexuels québécois, en plus d’être opprimés en tant qu’homosexuels, vivent aussi quotidiennement l’oppression nationale. Beaucoup considèrent la lutte pour l’affirmation de la nation québécoise comme un prérequis à toute autre expression. Le fait que beaucoup d’homosexuels refusent consciemment ou inconsciemment de descendre dans la rue « pour ne pas nuire au PQ » en est une illustration frappante. Cet aspect important mériterait un développement beaucoup plus long. Nous y reviendrons dans des publications ultérieures.
Ainsi donc, faute de perspectives claires pour se construire, faute d’analyse, refermé sur lui-même, peu lié aux luttes sociales, frappé par la répression policière, le FLH est mort. Après les nombreux groupes de service à la communauté gaie, après les groupes d’étude, le mouvement s’est mûri et renaît avec l’ADGQ, qui offre une perspective claire de lutte : la lutte pour les droits.
On peut dire que trois groupes ont tenté de développer des perspectives politiques pour la construction d’un mouvement gai au Québec : le CHAR (lutte contre la répression policière) ; le CHAP (lutte directe contre le système et liaison avec le mouvement des femmes et le mouvement ouvrier) ; l’ADGQ (lutte pour les droits) ; et plus récemment quelques militants du collectif Androgyne qui, tout en mettant un accent important sur la nécessité pour le milieu gai de se lier aux luttes des femmes, parlent de créer des services à la communauté comme aspect important de la construction du mouvement gai.
La stratégie de libération qui en résultera relèvera en fin de compte de la discussion sur ces différentes perspectives, discussion non dans l’abstrait mais en fonction des luttes nécessaires pour la construction du mouvement gai.
La lutte pour les droits
L’ouverture d’une nouvelle période politique au Québec avec la venue du PQ au pouvoir (parti nationaliste petit-bourgeois) a changé les données du débat pour la construction d’un mouvement gai au Québec. Avant le 15 novembre 76, l’attitude intransigeante du gouvernement Bourassa envers tout ce qui bougeait, y compris les gais, commençait à discréditer l’appareil parlementaire, législatif et tout ce qui lui était lié. Ainsi, la lutte pour les droits des gais, la lutte pour faire amender l’article de la charte des droits de la personne relatif aux motifs de non-discrimination sexuelle, même si c’était la seule perspective à laquelle les militants s’accrochaient, avait ses limites. Choquette, ex-ministre matraque de la Justice, n’avait-il pas dit que toute autre loi aurait priorité sur la charte en cas de conflit entre les deux? En ce sens, on peut dire que le GHAP avait compris la nécessité de ne pas s’en tenir qu’aux lois. Le GHAP, s’il continuait à exister, pourrait dire que ce n’est pas sa perspective qui a changé, mais les événements politiques qui ont influé sur la perception qu’ont les gens de sa perspective.
Déjà, après deux ans de pouvoir, les gais se demandent bien ce que le gouvernement Lévesque fait contre la répression policière qui a atteint une ampleur inégalée à l’automne 77. En fait, la victoire du PQ change beaucoup de choses. Les gens croient plus dans le PQ que dans le Parti libéral et croient dans ses politiques, même si une réelle désaffection commence à s’installer, notamment chez beaucoup d’ouvriers qui s’aperçoivent que le gouvernement péquiste ne fait rien contre la crise du capitalisme. Les lois qu’il se voit obligé de passer (loi sur la langue, loi anti-scab) sont le résultat de la pression du mouvement de masse qui aurait trouvé d’autres expressions que la voie parlementaire si le PQ n’avait pas pris le pouvoir. Aussi en est-il de même pour les homosexuels. Le drapeau du Québec qui flottait au-dessus des têtes au Studio I6 le soir des élections et l’euphorie générale qui se dégageait, les lettres et les commentaires du défunt Gai Montréal face au PQ dans l’opposition avant les élections qui soulignaient que 600 000 voix gaies au PQ n’étaient pas négligeables, les propos de Burns en commission parlementaire proposant un amendement pour faire inclure les termes « orientation sexuelle » dans la charte, les prises de position personnelles de certains députés péquistes durant la campagne électorale de 1976 (surtout où les militants gais avaient fait des pressions Hull-St-Louis) ont soulevé de grands espoirs. Qu’en est-il exactement après près d’un an au pouvoir ?
Dans les faits, le PQ met la pédale douce : « Nécessité du pouvoir, donc du possible », ne cesse de répéter Lévesque. Pendant ce temps, les travailleurs continuent de se faire exploiter en attendant l’indépendance (que bien entendu ils ne peuvent faire eux-mêmes selon les dirigeants du PQ), les femmes continuent d’être exploitées et opprimées, les gais matraqués, le gouvernement Lévesque refuse de faire sien le vote démocratiquement majoritaire au dernier congrès du parti sur la question de l’avortement.
Sous l’impact de la grande mobilisation du 22-23 octobre au soir en 1977, le PQ a bougé. Il a dû accorder la loi 88. Mais cette loi ne garantit pas la fin de la discrimination (le jugement des commissaires de la commission des droits de la personne le démontre bien : il donne raison à la CECM d’avoir discriminé les gais en leur refusant la location de ses salles). Cette loi ne garantit pas la fin de la discrimination à la TV, au travail, de la part des réactionnaires de toutes espèces comme les sexologues qui ont appelé à Radio-Canada pour protester contre l’émission de Télémag sur l’homosexualité, contre les bandes de jeunes qui attaquent les homosexuels dans les parcs, contre la répression policière, contre les fascistes, contre Pro-Vie. Dans ce contexte, l’ADGQ (Association pour les droits des gais du Québec) devra forcer l’application de la loi 88.
Oui, les homosexuels devront continuer de se battre pour leurs droits. Ils devront se battre dans leur syndicat pour que la question de leur oppression ne soit pas glissée en dessous du tapis. Ils devront former des groupes autonomes partout, les coordonner entre eux, centraliser les informations, les acquis des luttes, discuter de leur oppression, de ses origines, des moyens pour lutter, pour riposter contre la répression policière, organiser des manifestations, trouver des moyens pour embarquer d’autres forces avec eux, comprendre l’oppression spécifique des femmes, se mobiliser avec le mouvement des femmes sur la question de l’avortement libre et gratuit qui pose toute la question des rôles sexuels et du droit à la jouissance libre, tisser des liens avec leurs sœurs lesbiennes. Il faudra riposter aux campagnes contre les réactionnaires (comme celle d’Anita Bryant aux USA contre les homosexuels). Il ne faut à aucun prix céder un pouce de terrain. Il faut penser dès maintenant en termes de liaison avec les forces qui luttent au Québec pour nous débarrasser des exploiteurs étrangers et locaux et pour être réellement indépendants.
L’appui récent de la CEQ, de la Ligue des droits de l’homme, de l’AGE UQAM sont des pas en avant dans cette direction. Il faudrait aussi organiser de larges débats dans tous les syndicats pour faire comprendre la nature de l’oppression et ses liens avec le système capitaliste.
C’est une lutte à long terme, où chaque geste posé, chaque jour est important.
Les homosexuels et la théorie marxiste
Les homosexuels et les lesbiennes ont toujours été très critiques et ont pris leur distances face aux idées socialistes et communistes. La répression très connue des homosexuels par la caste qui gouverne bureaucratiquement les États ouvriers dégénérés et qui s’affuble de l’étiquette de socialiste ou de communiste (URSS, Chine, États ouvriers de l’Est) a contribué à cette distanciation idéologique et politique et à cette désaffectation. De même, l’incapacité de l’État ouvrier cubain à se confronter à l’idéologie sexiste, à penser à des structures pouvant remplacer la famille, a engendré une répression contre les homosexuels.
Dès 1934, Staline et ses épigones n’ont pas tardé à renverser les lois passées par les bolcheviks en 1917, libéralisant l’avortement et l’homosexualité. Aujourd’hui même, la position officielle des partis staliniens et mao-staliniens sur l’homosexualité (paradoxalement partagée par les fascistes), c’est que « l’homosexualité est un sous-produit de la décadence de la société bourgeoise que la ‘révolution socialiste’ a déjà éliminée (dans le cas de la Chine) ou qu’elle éliminera », maladie qu’on « guérit » par la répression, après la révolution (ou la contre-révolution selon le cas). L’attitude « d’ouverture » récente des PC anglais et français face à l’homosexualité (essentiellement des discussions en atelier à l’intérieur des partis) peut paraître surprenante, mais non pas si l’on considère et comprend l’importance des pressions des mouvements gais dans ces pays et la force du mouvement ouvrier où militent beaucoup d’homosexuels. Dans ces deux pays, le mouvement homosexuel est en voie sérieuse de structuration nationale, organisationnelle et politique.
Le mouvement gai en Europe ou au moins ses couches les plus avancées commencent à déboucher sur une perspective de classe et prennent une orientation marxiste. En Allemagne, les groupes gais les plus actifs participent à des manifestations et supportent les luttes ouvrières. En Angleterre, des secteurs du Gay Liberation Front interviennent dans la lutte des classes tout en menant leurs propres actions autonomes. Plusieurs groupes homosexuels marxistes ont pris naissance en Angleterre. En France, plusieurs groupes d’homosexuels ont une orientation clairement anti-capitaliste. Le Groupe Anti-Norme Sexpol supportait Alain Krivine (candidat de la LCR, section française de la IVe Internationale) aux élections présidentielles. En 1975, ils ont distribué plus de 5 000 tracts à l’occasion d’une manifestation anti-militariste organisée par des soldats.
Pour le moment, il ne semble pas y avoir de concertation ouverte entre les différents PC partisans de l’euro-communisme (nouvelle formule inventée par les staliniens qui subissent la pression du mouvement des masses) pour étouffer la voix des homosexuels dans leurs rangs.
L’expulsion récente d’un militant homosexuel, membre du PC canadien pro-Moscou, nous permet de constater que les PC n’ont pas une attitude homogène à ce sujet.
Contrairement à tous les staliniens et/ou mao-staliniens (y compris au Québec), nous ne croyons pas que l’homosexualité est une maladie ; c’est un comportement sexuel qui a toujours existé selon le degré de répression des diverses sociétés. Plusieurs études scientifiques contemporaines sur le vécu sexuel de la population (Master and Johnson, Kinsey, Reich, Freud, rapport Hite, Ford et Beach) le montrent. Selon Kinsey, 37 % de la population mâle a au moins eu une expérience culminant en orgasme. En plus, un autre 13 % a eu des désirs homosexuels sans contact et sans culmination en orgasme (Homosexual Behaviour among males, W. Cheruchill). Les études de Freud démontrent clairement que dès la naissance l’enfant, quel que soit son sexe, n’a pas d’orientation sexuelle ou désir sexuel fixe. C’est la société, son environnement, qui décide pour lui de son vécu sexuel. Et ce conditionnement social est extrêmement fort. Qu’on songe à toutes les pressions sociales qui s’exercent sur les gens pour qu’ils entrent dans un rôle sexuel. Et quand ce conditionnement ne marche pas, on utilise les thérapies aversives, les chocs électriques, les lobotomies, pour en arriver à ce que les homosexuels se sentent et se croient malades ou fous à cause de la force de ces pressions sur eux, quand ils ne se suicident pas.
Sans parler de la répression sauvage et dure commandée par ceux qui décident de l’organisation sociale et qui eux, ne s’interdisent pas les plaisirs homosexuels. Et malgré tout ceci, aucun régime n’est jamais parvenu à étouffer le désir homosexuel.
L’abrogation par Staline des lois légalisant l’homosexualité a aussi été accompagnée de purges dans plusieurs grandes villes. Dans la flotte soviétique, un grand nombre de marins ont été victimes de ces décisions qui incitaient à la dénonciation systématique. Ce qu’il faut voir, c’est que la répression des homosexuels par Staline et sa clique n’était pas un fait isolé mais coïncidait avec le renforcement de la famille dite « prolétarienne », le renforcement de l’autorité des directeurs d’usine au détriment des droits des travailleurs et des travailleuses, l’abolition à toutes fins pratiques des Conseils ouvriers (soviets) qui avaient été au cœur de la prise du pouvoir, l’extermination de la grande majorité des bolcheviks qui avaient dirigé la révolution d’octobre, l’expulsion de toute opposition et la suppression du droit de tendance dans le parti, la préparation des procès frauduleux de Moscou, l’écrasement des artistes issus de la révolution et leur remplacement par des fonctionnaires appointés au service d’un « art » gris et lugubre baptisé « réalisme socialiste ».
Dans La révolution trahie, Trotsky analyse les causes et les mécanismes de cette dégénérescence bureaucratique de l’État ouvrier soviétique. Son chapitre intitulé Thermidor au foyer rend compte en particulier de la réaction stalinienne en matière de famille, de morale et de sexualité, qui a entraîné un renforcement énorme de l’oppression des femmes. C’est dans ce contexte d’ensemble que prend place l’oppression des homosexuels dans l’URSS stalinienne.
Il n’est donc pas surprenant que les homosexuels ont spontanément tendance à regarder la théorie marxiste d’un œil louche. Et ce n’est pas le comportement des mao-staliniens québécois qui va les rassurer. Ces groupes puisent leurs références théoriques dans l’Internationale communiste dégénérée de Staline, qui voyait dans l’homosexualité une tare du capitalisme destinée à disparaître avec la révolution.
Bien sûr, les groupes staliniens québécois et canadiens n’ont jamais explicitement repris ou rejeté cette conception, puisqu’ils ont conservé un silence complet sur la question. Les mobilisations les plus combatives du mouvement gai, comme la manifestation des 2 000 gais et lesbiennes qui ont bloqué la rue Sainte-Catherine le 22-23 octobre au soir en 1977 n’ont trouvé aucun écho dans la presse des mao-staliniens. Malheureusement, il faut aussi dire que le Groupe socialiste des travailleurs du Québec, qui se réclame des idées de la IVe Internationale, n’en a pas soufflé mot non plus. Mais à la longue, le développement du mouvement gai et de la prise de conscience de l’oppression spécifique que nous subissons feront certainement sentir leurs effets. Ainsi, le journal maoïste En Lutte a finalement laissé filtrer dans ses colonnes une faible lueur relative à l’oppression des homosexuels. Dans un numéro de septembre 1978, En Lutte a consacré une colonne à la dénonciation de la campagne d’Anita Bryant comme droitière et fasciste. Mais En Lutte a réussi le tour de force de présenter la campagne de Bryant comme étant simplement réactionnaire sans préciser clairement son orientation anti-homosexuelle.
Toutefois, il semble que ce groupe s’oriente vers une prise de position sur la question homosexuelle. Nous ignorons encore ce que sera cette position (même si nous en avons une idée), mais nous pouvons déjà dire qu’En Lutte éprouvera de grandes difficultés à concilier cette évolution avec l’héritage du stalinisme, que ce groupe continue de revendiquer. Il lui faudra aussi se poser bien des questions sur des pays comme la Chine et l’Albanie où l’homosexualité est censée ne pas exister, d’après ce que prétendent les directions bureaucratiques de ces États.
Pour notre part, nous rejetons catégoriquement ces caricatures staliniens du socialisme. Nous luttons pour une véritable démocratie socialiste, pour le pouvoir effectif des masses laborieuses et non pour le monopole d’une bureaucratie qui exerce le pouvoir au nom et à la place de la classe ouvrière. Ceci veut dire l’élection des responsables par les travailleurs et les travailleuses à tous les niveaux de l’État ouvrier, la liberté des partis et des courants politiques, l’autonomie des syndicats et de toutes les organisations de masse et leur capacité à choisir eux-mêmes leur propre direction. Dans ce cadre, il reviendra au parti révolutionnaire de lutter politiquement pour faire adopter ses orientations et faire élire ses candidat-es en combattant politiquement les autres courants. Nous rejetons la farce stalinienne du parti unique où les prétendues élections ne font qu’entériner la nomination d’un seul et unique candidat désigné par en haut. Ceci est exposé de façon beaucoup plus élaborée dans la résolution du secrétariat unifié de la IVe Internationale, Démocratie socialiste et dictature du prolétariat (publiée aux Éditions d’Avant-garde). Pour nous, le socialisme que nous voulons exige aussi le développement d’un puissant mouvement autonome des femmes, capable de combattre l’oppression et indépendant de l’État et des partis. C’est aussi pourquoi nous nous battons pour un mouvement gai indépendant.
De plus, nous appuyons tous ceux et toutes celles qui avaient dû auparavant se cacher, à cause de l’homophobie, des pressions économiques, familiales, ou sociales, et qui maintenant s’affichent ouvertement. Il faut que les membres des organisations révolutionnaires prennent conscience de l’oppression spécifique des gais et des lesbiennes et qu’ils contribuent à combattre cette oppression en leur propre sein et publiquement comme le fait la LOR.
Puisque l’oppression des homosexuels est enracinée dans la famille nucléaire, on ne peut vraiment s’en débarrasser qu’en se mettant à la tâche pour construire une société socialiste. Cependant, les exemples des pays comme l’URSS, la Chine et Cuba, montrent que cette libération ne se fera pas spontanément après le renversement du capitalisme. Dans ces pays, il existe une caste bureaucratique conservatrice qui domine et maintient la famille, la division sexuelle du travail, et l’oppression des homosexuels. C’est pourquoi il faut construire un mouvement gai indépendant qui pourra se battre et gagner la classe ouvrière à assurer la libération des homosexuels, avant, pendant, après la révolution.
Pour mener à bien ces tâches, il faut aussi construire une direction révolutionnaire (un parti révolutionnaire) pour la classe ouvrière et tous les opprimés qui en comprennent la nécessité. C’est à cette tâche que la LOR s’est attelée, tâche où la lutte pour la libération totale du Québec du joug de l’impérialisme, passe par la prise en charge de la lutte anti-impérialiste pour la faire transcroître en lutte anti-capitaliste et la lutte pour l’indépendance par les travailleurs eux-mêmes, les travailleuses elles-mêmes, l’instauration du socialisme, la République des travailleurs et des travailleuses du Québec.
Nous pouvons concrétiser notre perspective pour la libération des homosexuels par le slogan suivant :
LA LIBÉRATION HOMOSEXUELLE SE FERA PAR LA RÉVOLUTION SOCIALISTE
IL N’Y AURA PAS DE VÉRITABLE SOCIALISME SANS LIBÉRATION HOMOSEXUELLE
Quelques perspectives?
Une fois de plus, et une semaine après le 2e congrès d’orientation de l’ADGQ, la répression policière s’est violemment abattue sur la communauté homosexuelle de Montréal. 150 personnes arrêtées, des violences physiques, des insultes, des brimades. La réaction du milieu gai fut massive, nécessaire sursaut pour éviter l’écrasement. 2 000 gais et lesbiennes en colère, au cri de « Gestapo, Gestapo » ont bloqué la rue Sainte-Catherine le 22-23 octobre au soir suivant. Intimidations policières (camions de pompiers, bouncers policiers) n’ont pas suffi à éteindre la rage que tous et toutes criaient du plus profond d’eux-mêmes et d’elles-mêmes. Le gouvernement péquiste, devant l’ampleur de la mobilisation a accordé la loi 88. C’est une grande victoire pour les gais, sans précédent en Amérique du Nord, mais la mobilisation doit continuer pour forcer l’application de la loi.
Un comité de défense des accusés du Truxx s’est formé, un comité de soutien à ce comité a mis en œuvre ses ressources pour organiser le soutien nécessaire à cette lutte. L’organisation de dances et autres activités pour ramasser des fonds est importante et nécessaire dans la lutte légale, pour le retrait des accusations injustes contre les arrêtés du Truxx. Mais ce n’est pas suffisant et déterminant. La justice demeure la justice des bourgeois et vu l’ampleur de l’opération, il faut se douter qu’ils ne lâcheront pas de sitôt. Cette « gestapo » qui a brandi le gourdin, elle obéit aux ordres de ceux qui tirent les ficelles dans cette société capitaliste, il ne faut pas l’oublier.
Ainsi, dans ce contexte, seules les mobilisations, les manifestations, les actions de masse sont capables de gagner des points, de gagner la lutte. Ces gens-là ne comprennent que par l’établissement d’un rapport de force.
RETRAIT DE TOUTES LES ACCUSATIONS CONTRE LES ARRÊTÉS DU TRUXX
POUR DES ACTIONS DE MASSE CONTRE LA RÉPRESSION POLICIÈRE
De plus, le mouvement gai, comme les autres mouvements de revendication, ne peut se permettre de rester isolé et doit s’unir pour se renforcer. Son allié le plus précieux est le mouvement des femmes en lutte contre leur oppression et leur surexploitation. En marchant ensemble, en frappant ensemble, les possibilités de victoires augmentent.
APPUI DU MOUVEMENT GAI AUX LUTTES DES FEMMES CONTRE LEUR OPPRESSION ET LEUR SUREXPLOITATION
À BAS LE CHAUVINISME ET LE SEXISME
APPUI AUX LUTTES DES LESBIENNES
Une vigilance de tous les instants et des mobilisations sont nécessaires pour que la loi 88 s’applique malgré les pressions des réactionnaires comme Pro-Vie et la CECM.
QUE LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE RENDE JUSTICE À L’ADGQ ET RENVERSE SON JUGEMENT QUI ACCORDE RAISON À LA CECM QUI A REFUSÉ DE LOUER SES SALLES À L’ASSOCIATION
FIN AUX PROPOS DISCRIMINATOIRES DE TOUS LES RÉACTIONNAIRES ET DE PRO-VIE
La population est victime des préjugés véhiculés par les médias, les institutions réactionnaires de la société.
POUR UNE ÉDUCATION DE MASSE DE LA POPULATION SUR LES QUESTIONS SEXUELLES, SUR LA QUESTION DE L’HOMOSEXUALITÉ
DROITS D’ANTENNE ÉGAL POUR LES ORGANISATIONS HOMOSEXUELLES À LA RADIO ET À LA TÉLÉVISION
Conclusion
Nous ne croyons pas avoir tout dit. L’histoire d’un mouvement et son sort dépendent de l’implication militante du plus grand nombre et de la perspicacité de ses dirigeants, de l’issue des autres luttes sociales, de l’issue de la lutte pour l’indépendance au service des travailleurs et des travailleuses, de la victoire de la révolution socialiste. De ce point de vue, l’histoire du mouvement gai au Québec en est à ses tous débuts. Plusieurs luttes sont à mener. Les plus importantes de l’heure demeurent le retrait des accusations contre les arrêtés du Truxx, la lutte contre la répression policière, et la droite active (Pro-Vie et la CECM).
Pour la libération des homosexuels, nous réaffirmons la nécessité du mouvement autonome qui se bat pour ses propres revendications et qui se lie aux autres mouvements sociaux en lutte (principalement le mouvement des femmes et le mouvement ouvrier). Le mouvement gai peut contribuer à combattre l’homophobie au sein du mouvement ouvrier, en permettant de souligner (pour mieux la combattre par exemple) la misère sexuelle et affective des travailleurs et des travailleuses. Ce mouvement doit se donner des structures unitaires basées sur des discussions démocratiques et sur la plus grande unité dans l’action. Ce mouvement, pour sa survie, doit être capable de développer des capacités de mobilisations de masse (comme celle en réaction aux arrestations du Truxx), des réponses militantes aux attaques contre le milieu gai. Mais aussi il doit être capable de s’insérer dans le processus dynamique du changement social et de gagner une crédibilité auprès des plus opprimés et de ceux et celles qui luttent contre ce système d’oppression. Il doit tout mettre en œuvre pour combattre le sexisme et le chauvinisme en son sein et faciliter ainsi des alliances avec les lesbiennes et les femmes en lutte contre leur oppression.
Il doit reconnaître le droit inaliénable des lesbiennes à se constituer en mouvement autonome avec ses propres revendications.
Allié ainsi aux mouvements féministes, il peut aider à combattre le sexisme, les rôles sexuels, la famille, la division sexuelle du travail.
Son impact sur la société peut être réel, la plupart des gais étant forcés de sortir de la famille et questionnant de fait le caractère réactionnaire et la possibilité de bien vivre à l’extérieur.
En brisant avec le modèle dominant de l’hétérosexualité comme modèle de reproduction, les gais et les lesbiennes montrent de nouvelles avenues. Ils et elles posent de nouvelles avenues, de nouvelles alternatives.
Les lesbiennes elles-mêmes ont un rôle important à jouer au sein même du mouvement des femmes en questionnant les rapports dominants/dominés hommes/femmes.
Le mouvement des homosexuels a un potentiel anti-bureaucratique réel dans les États ouvriers dégénérés en questionnant la répression de la bureaucratie et de la famille réactionnaire dite « prolétarienne ».
En s’organisant au sein même des syndicats et des organisations de masse, les gais et lesbiennes peuvent susciter des interrogations, des prises de conscience, de l’aliénation quotidienne, de l’oppression sexuelle. Étant donné que la plupart des gais sont des travailleurs, le mouvement gai autonome devrait aider à mettre sur pied des caucus gais dans les syndicats de même qu’appuyer la lutte des syndiqués gais pour l’inclusion des termes « orientation sexuelle » dans leur contrat de travail et contre le chauvinisme, le sexisme, et l’homophobie. D’autre part, les syndiqués gais approfondiront leur conscience de l’oppression spécifique des homosexuels en militant dans un groupe gai qui se bat pour les droits des homosexuels et contre la répression.
Parce qu’ils sont parmi les premières victimes de choix des fascistes, les gais sont des alliés de première importance de toutes les forces antifascistes pour combattre cet ennemi des peuples, des masses opprimées et de la classe ouvrière.
La réaction à la campagne anti-homosexuelle d’Anita Bryant a donné lieu à la plus grande mobilisation de masse aux États-Unis depuis la fin de la guerre du Vietnam. Plus de 500 000 personnes ont manifesté contre la campagne de Bryant en juin 1978.
Les mouvements homosexuels, en revendiquant le droit de vivre une sexualité différente de celle érigée en norme naturelle, s’attaquent effectivement à une des formes de mutilation de la personnalité par le répression sexuelle. Ils gênent objectivement les efforts de la bourgeoisie pour dresser la jeunesse à travers la famille, l’école, l’Église, les médias, à travers l’idéologie de la normalité et de la « perversion », à travers le chauvinisme des rapports dominants-dominés, hommes-femmes.
C’est pourquoi les forces réactionnaires mènent une campagne hystérique contre le mouvement homosexuel. Cette offensive montre la nécessité urgente de la mobilisation pour faire triompher les droits des gais et des lesbiennes. Mais, à notre sens, la portée du mouvement gai dépasse de loin la simple défense des droits d’une « minorité » opprimée. Le mouvement est porteur d’implications colossales sur l’ensemble des relations sociales, en ouvrant de nouvelles possibilités de rapports effectifs entre ce que le moule stéréotypé dans lequel la bourgeoisie voudrait couler l’ensemble de la population.
Nous sommes convaincus qu’une libération sexuelle authentique et durable ne pourra pas avoir lieu sans une réorganisation totale de la société. Et ceci exige le renversement de la classe dominante actuelle, la bourgeoisie, qui modèle le monde en fonction de ses intérêts propres. La libération de la sexualité présuppose une mobilisation massive et révolutionnaire — la révolution socialiste — pour mettre fin à l’exploitation, planifier la disparition des inégalités sociales, et de la division sexuelle du travail, remplacer la structure familiale actuelle en travaillant à la socialisation des tâches domestiques et ménagères.
En même temps, la réalisation effective de ce programme, la transformation en profondeur de la société ne pourra être menée à terme sans une prise de conscience de toutes les dimensions de leur oppression chez la majorité des travailleurs, des travailleuses et de leurs alliés potentiels dans les masses populaires. Le mouvement gai a un rôle important à jouer à ce niveau. Pour nous, pour la Ligue ouvrière révolutionnaire, la lutte de libération gaie fait partie intégrante de la lutte pour le socialisme, pour un monde débarrassé de l’exploitation et de l’oppression.
VIVE LA LIBÉRATION GAIE
BOURGEOISIE : classe minoritaire et dominante dans la société, classe qui contrôle l’économie, possède les moyens de production (usines, machines), qui contrôle l’appareil d’État, détient le pouvoir politique dans la société et utilise ses appareils de répression contre les masses ouvrières et populaires.
Les appareils de répression de la bourgeoisie sont bien connus : l’armée (l’armée canadienne nous a déjà envahis 21 fois depuis la Confédération), la police (matraquages sanglants à la United Aircraft, à la manifestation de la Presse en 71, durant le Front commun en 72, les bandes armées du capital qui ont tiré sur les travailleurs à Robin-Hood). La bourgeoisie oblige les travailleurs à vendre leur force de travail pour gagner leur pitance.
Au Québec, nous n’avons pas de bourgeoisie nationale québécoise. Le gouvernement péquiste a comme projet de faciliter le développement d’une telle bourgeoisie. La bourgeoisie au Québec est étrangère, américaine et canadienne, principalement, et contrôle plus de 90 % de notre économie. Les Desmarais, Simard, Jean-Louis Lévesque et cie, complètement inféodés à la bourgeoisie étrangère.
1 Karl Marx, 1843, Contribution à la critique de La philosophie du droit de Hegel
2 Manifeste du Groupe marxiste révolutionnaire, composante fondatrice de la LOR, page 75, avril 1976
3 Commission des écoles catholiques de Montréal [ndlr]
4 Parti québécois [ndlr]
5 Jean Nicolas, La question homosexuelle, p. 16
6 Le Studio I est un bar gai du centre-ville.
La pertinence du marxisme aujourd’hui
Ces notes sont tirées d’une conférence donnée par Louis Gill à l’UQAM, le 5 décembre 2012, à l’invitation du groupe Étudiant-e-s socialistes UQAM.
Survol de la théorie et de la méthode marxistes
Ce passage est tiré du livre L’économie capitaliste: une analyse marxiste. Tome I, écrit par l’économiste Louis Gill.
Combattre les riches et leurs guerres : Non à la guerre en Iran!
Le 21 juin, des avions de guerre américains ont largué des bombes «bunker buster» sur trois sites nucléaires iraniens, dont le site lourdement fortifié de Fordo, qui est essentiel au programme nucléaire iranien. L’armée américaine est désormais directement entrée en guerre contre l’Iran, aux côtés d’un régime israélien toujours plus sanguinaire.
On estime que 700 personnes en Iran et 24 en Israël ont déjà été tuées au cours de la semaine dernière. Cela intervient après plus de 17 mois de guerre génocidaire de l’armée israélienne contre Gaza, qui a tué plus de 60 000 Palestiniens et Palestiniennes. Aujourd’hui, le régime israélien veut faire couler le sang en Iran afin de consolider sa position au Moyen-Orient.
Trump n’a jamais été contre la guerre
Donald Trump a fait d’innombrables promesses pour mettre fin à toutes les guerres sur Terre et pour ne plus jamais impliquer les États-Unis dans une «guerre sans fin». Cependant, il est également un adversaire du régime iranien qui, en 2018 et à la demande de Benyamin Netanyahou, a déchiré l’accord visant à limiter le programme nucléaire iranien. Trump, inquiet d’un nouvel imbroglio dans l’assaut actuel d’Israël, s’est laissé convaincre par l’aile belliciste de l’establishment politique: un assaut américain serait «rapide et facile» et donnerait aux États-Unis et à Israël une domination totale dans la région.
Or, cette campagne ne fait que commencer et s’avérera tout sauf «facile». Le régime iranien promet déjà d’importantes représailles, la télévision d’État déclarant, quelques heures à peine après les bombardements américains, que «tout citoyen américain ou personnel militaire dans la région est désormais une cible». Des troupes américaines mourront à cause de l’escalade imprudente de Trump.
Trump, comme beaucoup d’autres dirigeants impérialistes avant lui, cherche à obtenir un succès militaire spectaculaire à l’étranger pour détourner l’attention de ses problèmes intérieurs croissants. L’intensification de sa campagne de terreur contre les personnes immigrées était elle-même une tentative de distraction face à une cote de popularité en baisse et à une coalition de plus en plus divisée. Après un retournement spectaculaire, provoquant la plus grande journée de protestation de l’histoire des États-Unis le 14 juin, Trump, «l’homme fort», avait besoin d’une nouvelle distraction.
Nous vivons dans une nouvelle ère de conflit inter-impérialiste qui s’intensifient à un rythme accéléré. L’impérialisme américain, avec l’erratique et imprévisible Trump à sa tête, est coincé dans une lutte à mort contre l’impérialisme chinois pour le statut de puissance mondiale dominante. L’alliance étroite de la Chine avec l’Iran, combinée à l’importance de l’alliance des États-Unis avec Israël en tant que bastion au Moyen-Orient, signifie que l’impérialisme américain a un intérêt significatif à saper les capacités nucléaires de l’Iran et même à remplacer le régime iranien.
Le capitalisme, c’est la guerre
Les travailleuses et les travailleurs n’ont aucun intérêt à ces guerres brutales que se livrent les gouvernements impérialistes contrôlés par les milliardaires. Le coût combiné des guerres en Irak et en Afghanistan est estimé entre 4 et 6 billions $, avec environ 4,7 millions de morts directes et indirectes dans les zones de guerre, y compris le Pakistan, la Syrie et le Yémen. Des millions de travailleuses, de travailleurs et de jeunes aux États-Unis n’ignorent pas à quel point l’escalade actuelle est similaire à la façon dont les guerres sans fin en Irak et en Afghanistan ont commencé. Dans un récent sondage, seuls 16% des Américaines et Américains soutiennent l’action militaire des États-Unis contre l’Iran.
Les billions $ (milliers de milliards) dépensés pour la guerre devraient plutôt être consacrés aux soins de santé, à l’éducation et à la création massive d’emplois verts et syndiqués dédiés à la construction de logements et de transports publics abordables de haute qualité. Mais cela n’arrivera jamais sous le capitalisme, qui conduit inévitablement à l’éclatement de guerres lorsque des pays impérialistes assoiffés de pouvoir se battent pour le contrôle des terres, des ressources et de la main-d’œuvre afin de les exploiter à des fins lucratives. Il est urgent d’intensifier le mouvement anti-guerre international contre cette nouvelle escalade militaire. Cela devrait inclure des manifestations de masse, de la désobéissance civile et des actions ouvrières telles que des grèves et le refus de transporter des armes.
Pas de confiance envers les démocrates
Tout comme pour l’Irak et l’Afghanistan, la grande majorité des élu·es démocrates sont susceptibles de rentrer dans le rang. Les démocrates ont massivement soutenu l’invasion de l’Irak sous George W. Bush. Chuck Schumer et Hakeem Jeffries, les démocrates les plus puissants du Congrès, sont tout aussi fidèles à la campagne belliciste de Benyamin Netanyahu que de Trump.
Même les soi-disant démocrates progressistes concentrent leur colère sur la décision de Trump d’entrer en guerre sans l’approbation du Congrès. Mais un vote au Congrès ne changerait rien à la nature destructrice de la guerre impérialiste. Nous devons être clairs: les démocrates et les tribunaux ne nous sauveront pas de Trump. Nous avons besoin d’une lutte de masse et d’un nouveau parti de la classe ouvrière pour nous opposer à la fois à Trump et aux Démocrates.
Socialisme ou barbarie
Il est clair qu’Israël veut un «changement de régime» en Iran. Il n’existe aucun scénario dans lequel un régime mandataire soutenu par les États-Unis et Israël conduirait à la stabilité dans la région ou améliorerait la vie des travailleuses, des travailleurs et des personnes opprimées en Iran. Mais le régime actuel n’est pas non plus une solution pour les masses iraniennes. Le mouvement de masse Femme, vie, liberté de 2022 a posé le germe du type de mouvement nécessaire pour remplacer la dictature brutale et oppressive de l’Ayatollah Khamenei par une véritable alternative de la classe ouvrière. Mais ce mouvement avait besoin d’un programme, d’une stratégie et d’une direction socialistes clairs.
Il n’y a pas de solution au bain de sang apparemment sans fin du Moyen-Orient sur la base d’une intervention militaire des puissances impérialistes ou de tout régime capitaliste réactionnaire dans la région. La seule voie à suivre est celle d’une lutte de masse internationale de la classe ouvrière pour un monde socialiste, dans lequel toutes les guerres peuvent enfin prendre fin pour de bon.
- Non à la guerre avec l’Iran! Mettez immédiatement fin à l’intervention militaire américaine en Iran et à tout financement du régime meurtrier d’Israël.
- Réduisez le budget militaire américain de près de 1 000 milliards $ et consacrez cet argent à l’éducation, aux soins de santé et à la création massive d’emplois verts et syndiqués dédiés à la construction de logements et de transports publics abordables de haute qualité.
- Il faut construire un mouvement anti-guerre international avec des manifestations de masse, de la désobéissance civile non violentes et des actions ouvrières telles que des grèves et le refus de transporter des armes.
- Ne faites pas confiance aux démocrates pro-impérialistes! Il faut construire un nouveau parti de la classe ouvrière qui s’oppose fermement à toute guerre impérialiste.
- Il n’y a pas de capitalisme sans guerre: il faut construire un mouvement socialiste révolutionnaire de masse pour renverser ce système barbare et inaugurer une nouvelle ère définie par la paix, la solidarité et la fin de la souffrance humaine.