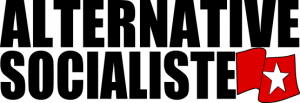Conférence donnée à l’UQAM, le 5 décembre 2012
à l’invitation du groupe Étudiant-e-s socialistes UQAM
Le marxisme se fonde :
- sur un mode de pensée et d’analyse, la méthode dialectique;
- sur une conception du monde, la conception matérialiste.
La méthode dialectique
L’observation des phénomènes de la nature, de la vie humaine et des sociétés, révèle:
– que les choses sont en mouvement, en évolution permanente;
– qu’elles ne sont pas isolées les unes des autres, mais interdépendantes;
– que l’accumulation de changements quantitatifs produit des changements qualitatifs;
– que la réalité est traversée de contradictions, moteurs du changement; toute chose est à la fois elle-même et son contraire.
Ces caractéristiques qui se dégagent de l’observation du monde réel, la théorie doit en rendre compte. Le monde réel est de nature dialectique; sa représentation fidèle au niveau de la pensée ne peut être que dialectique.
La conception matérialiste
Dans l’interprétation des phénomènes de la nature, de la vie humaine et des sociétés, selon la conception matérialiste, il y a d’abord l’existence matérielle des choses, puis leur reflet dans la pensée, leur compréhension. On envisage les choses comme progressivement connaissables. Les progrès de la connaissance, les reculs de l’ignorance, suppriment toute base à la croyance en l’existence de choses « en soi », vues comme inexplicables.
Le matérialisme historique
Le matérialisme historique est l’application du mode de pensée dialectique et de la conception matérialiste à l’étude de l’évolution historique des sociétés.
Le point de départ de l’analyse est l’évolution des conditions matérielles d’existence et de production de ces conditions d’existence au cours de l’histoire, l’évolution des forces productives et des rapports sociaux qui leur correspondent. L’évolution historique consiste en une succession de modes de production qui sont les étapes d’un développement progressif, chaque mode de production dépassant et intégrant les acquis du précédent comme résultat d’une révolution sociale.
Dans cette perspective, le capitalisme est envisagé comme une phase nécessaire et transitoire du développement historique, et non comme un système arrêté et immuable. L’histoire n’est pas une suite d’événements survenant au hasard, mais un processus évolutif soumis à des lois de développement.
Une production historiquement et socialement déterminée
L’objet de l’étude est la production matérielle, non pas la production en général, mais une production qui est historiquement et socialement déterminée. Au centre de l’analyse marxiste se trouve la distinction permanente entre ce qui est commun à toutes les époques de l’histoire et ce qui est spécifique à chacune d’elles. Un même contenu prend des formes différentes dans des conditions historiques et sociales différentes.
L’objectif est de mettre en lumière les lois particulières, spécifiques, qui régissent la naissance, la vie, la croissance d’un organisme social et son remplacement par un autre, supérieur
C’est la société en tant que tout qui est objet d’étude. Marx vise à découvrir les connexions entre phénomènes d’ordre social, qui à leur tour déterminent les phénomènes d’ordre individuel. L’individu vit en société; c’est elle qui détermine ses mobiles et les limite. La méthode de Marx est l’inverse de la méthode « atomistique » qui procède à partir de l’individu isolé, celle du courant dominant, néoclassique, de l’économie contemporaine.
La question du socialisme
Du point de vue du matérialisme historique, le socialisme est un stade de l’évolution historique. Il se fonde sur les bases matérielles créées par le stade précédent, celui du capitalisme, et fournit les moyens de les dépasser. A un certain point du développement historique, ce stade devient nécessaire, tout comme le capitalisme avant lui est devenu nécessaire pour surmonter les limites atteintes par les institutions féodales.
S’il devient une nécessité, c’est aussi parce qu’il est devenu une possibilité réelle fondée sur les bases matérielles léguées par le capitalisme.
Au stade avancé du capitalisme, une situation contradictoire s’est développée. Le formidable développement des forces productives réalisé par plus de deux siècles d’organisation capitaliste de la production a créé la possibilité matérielle de l’émancipation économique de la population mondiale. Pourtant, on voit persister famine et pauvreté. On voit les réserves agricoles mondiales atteindre des sommets pendant que des populations entières sont décimées par la famine. Les découvertes scientifiques et les progrès incessants de la technologie fournissent les moyens de l’allègement des tâches, de la réduction du temps de travail tout en améliorant le niveau de vie. Pourtant on voit croître le chômage, se dégrader les conditions de vie et de travail, à la fois comme conséquence et comme condition de la rentabilité nécessaire à la marche de l’économie capitaliste fondée sur l’intérêt privé et le profit.
Envisagé sous cet éclairage, le socialisme ne saurait être compris comme une simple variété de capitalisme amélioré, « civilisé », visant par exemple une meilleure répartition des revenus, mais laissant survivre la propriété privée des moyens de production, la primauté de l’intérêt individuel, la concurrence et le profit comme fondements du régime, c’est-à-dire les racines mêmes de l’exploitation, des inégalités, etc.
Il s’impose comme successeur historique nécessaire d’un régime qui démontre son inaptitude à gérer dans l’intérêt de l’humanité les forces productives qu’il a développées. Il s’impose comme le moyen de triompher du chômage, de la famine, des inégalités, comme substitut à une économie de marché qui engendre inévitablement ces plaies sociales. Il implique un combat où s’affrontent des intérêts diamétralement opposés.
Le cheminement complexe de la transition
Quel chemin empruntera la transition du capitalisme au socialisme? Combien de temps durera-t-elle? Le processus ira-t-il jusqu’à sa conclusion? Il va sans dire que nul ne peut répondre avec certitude à ces questions. Et encore moins après les événements qui ont ramené les pays de l’Est à l’économie de marché. Dans l’histoire de l’humanité, l’immense complexité de la réalité déborde toujours les prévisions de la théorie.
La nécessité, expression des lois que l’analyse scientifique dégage, se manifeste toujours sous la forme du hasard, du contingent. Il n’y a aucune automaticité dans cette marche, ni même aucune certitude de l’atteinte du but. La nécessité contient elle-même la possibilité de son contraire. Cela s’est exprimé dans la tradition socialiste sous la forme de l’alternative « socialisme ou barbarie » formulée par Rosa Luxemburg. La nécessité du socialisme désigne avant tout un combat à mener, dont l’issue comme celle de tout combat n’est jamais connue à l’avance.
La voie de la transition est donc destinée à être marquée de victoires et de défaites, d’avancées, de retours en arrière, de rythmes différents d’un pays à l’autre. Le cheminement empruntera une voie qui sera tout sauf une voie uniforme et unidirectionnelle.
Les événements se déroulant à l’échelle mondiale dans une situation d’interdépendance générale de tous les pays et d’intégration de chaque économie dans le marché mondial, les pays arrivés les premiers à la révolution socialiste sont destinés à souffrir de leur isolement. Le poids de cet isolement sera d’autant plus lourd que leur importance relative dans l’économie mondiale est plus faible. Ils seront à la fois limités dans les mesures à mettre en œuvre pour avancer dans la voie de la nouvelle société, et menacés de se voir imposer des reculs sur les plans politique et économique et cela, tant que les forces productives dominantes demeureront concentrées dans les pays dominés par le capital.
Tout espoir de construction de « socialismes autarciques » est ainsi pure illusion. Même une grande puissance économique comme l’URSS, flanquée de ses satellites d’Europe de l’Est au sein du « marché commun socialiste » que le COMECON1 prétendait être, a été incapable de se soustraire au réseau d’interdépendance mondial. Subissant les effets de la supériorité technique des pays capitalistes industrialisés, elle a été forcée de s’intégrer dans le marché mondial dominé par le capital, notamment pour s’approvisionner à moindres coûts en moyens techniques fabriqués avec une plus grande efficacité à l’Ouest. Elle a été poussée par les forces économiques à entretenir des relations commerciales et financières avec les pays capitalistes. Ses satellites d’Europe de l’Est ont été encore plus qu’elle sensibles à ces forces qui les poussaient presque naturellement à se rattacher au reste de l’Europe en raison de liens géographiques et historiques.
La loi du marché, qui joue pleinement au niveau du marché mondial et que l’économie planifiée s’efforçait de dominer, se faisait donc sentir bon gré mal gré et exerçait son influence sur la détermination des prix à l’intérieur même de l’économie planifiée, même si celle-ci a réussi à en atténuer l’effet direct grâce au monopole d’État du commerce extérieur.
Il ne saurait y avoir d’autarcie économique, même à l’intérieur de grands ensembles. Les possibilités d’avances réelles dans la voie du socialisme seront d’autant moindres que l’environnement capitaliste demeurera dominant, que les principales forces productives seront toujours sous l’emprise du capital. Et il va de soi que les réalisations dans la voie de la révolution sociale seront d’autant plus menacées de reculs, voire de renversement, que le degré de domination du capital sera plus élevé.
Il serait illusoire de penser que la société nouvelle puisse se construire pays par pays de manière isolée par rapport au reste du monde. Dans un contexte d’interdépendance générale qui est celui du capitalisme avancé, tout est influencé par tout. Le sort des pays d’Europe se joue autant en Amérique, au Japon et dans les pays dominés qu’en Europe même. Une victoire des luttes sociales dans un pays a un effet d’encouragement et d’entraînement en d’autres pays et à l’inverse les défaites font sentir de la même manière leur effet déprimant.
Le processus de la transition se déroulant de cette manière complexe qui est celui du développement de la lutte des classes, on peut comprendre qu’il serait impossible d’en prévoir à l’avance le cheminement et a fortiori la durée et les échéances. Combien d’années s’écouleront avant que de nouvelles révolutions sociales se produisent et surtout qu’elles atteignent un nombre suffisamment élevé de pays industrialisés dominants pour qu’on puisse parler de l’accession à une nouvelle période historique, celle du socialisme? Le monde atteindra-t-il jamais ce stade? Dégénérera-t-il plutôt dans la barbarie, se désintégrera-t-il dans une guerre nucléaire, périra-t-il dans la destruction progressive de l’environnement?
Ces questions sont du plus grand intérêt, mais elles demeurent d’ordre spéculatif à moins de les relier aux intérêts en présence qui font intervenir des individus et des classes et au combat à engager pour en contrer l’éventualité. La nécessité du socialisme désigne essentiellement ce combat à mener. Souhaiter de tout son cœur voir le résultat se réaliser de son vivant est une aspiration des plus légitimes que tout véritable socialiste a raison de nourrir dans le fond de lui-même. Poser arbitrairement une échéance de 10, 20, 30 ans à la réalisation de cet objectif est une opération entièrement subjective qui est étrangère à une analyse scientifique du processus.
On ne peut poser d’ultimatum à l’histoire, au processus vivant de la lutte des classes. Puisqu’il est question d’un combat, il s’agit avant tout de l’organiser pour qu’il soit victorieux. A chaque étape de ce cheminement, il faut dégager les moyens de faire un nouveau pas en avant. Du point de vue du marxisme, seule cette question importe. Ainsi compris, le marxisme n’a rien d’un dogme. Il est, comme nous l’avons déjà vu, un guide pour l’action, un instrument aidant à trouver dans chaque situation concrète les moyens concrets de faire avancer la marche au socialisme, de rapprocher l’heure entièrement contingente de la réalisation de cette nécessité historique.
Les bases matérielles du socialisme
Si le socialisme est vu comme un stade devenu nécessaire du développement historique, c’est que les bases sans lesquelles il ne peut être édifié ont été créées par le stade auquel il a pour mission de succéder, le stade capitaliste. L’analyse marxiste de l’histoire de l’humanité, nous l’avons vu, accorde une importance de premier plan au niveau de développement des forces productives comme facteur explicatif de l’évolution des sociétés.
L’émergence des sociétés de classes s’explique notamment par la faiblesse du rendement du travail, l’insuffisance de la production qui en découle et la lutte pour l’appropriation d’un produit social insuffisant pour satisfaire les besoins de toute la population.
Si la division de la société en classes a eu une certaine légitimité historique, celle-ci se fondait essentiellement sur l’insuffisance de la production [Engels, Anti Düring, Éditions sociales, p. 318-19]. Cette légitimité sera balayée par le plein déploiement des forces productives, c’est-à-dire par la possibilité d’assurer au moyen de la production sociale à tous les membres de la société une existence convenable au point de vue matériel, ouvrant par son amélioration progressive la possibilité de leur épanouissement physique et intellectuel. Le développement des forces productives rendant possible la réalisation matérielle de cet état de choses est à la fois une condition nécessaire et un enjeu.
Il est d’abord une condition nécessaire, qui supprime par ailleurs toute validité aux espoirs idéalistes de construction du socialisme du pauvre, fondé sur la répartition de la pénurie où « l’enthousiasme révolutionnaire des masses » est vu comme un substitut à la puissance technique de l’industrie moderne et dont la Chine des années 1960, celle de Mao Zedong et de la « Révolution culturelle » a été le modèle.
Dans leur ouvrage intitulé L’idéologie allemande, rédigé en 1845-46 et dans lequel ils ont jeté les bases du matérialisme, Marx et Engels ont exprimé cela dans des termes très clairs, désignant le développement des forces productives comme une « condition pratique absolument indispensable, sans lequel c’est la pénurie qui redeviendrait générale et avec le besoin c’est la lutte pour le nécessaire qui recommencerait et on retomberait fatalement dans la même vieille gadoue » [Marx-Engels, L’Idéologie allemande, Éditions sociales, p. 64]. Une nation ne peut « ni dépasser d’un saut, ni abolir par décrets les phases de son développement naturel » [Marx, Préface de la première édition allemande du Capital, Éditions sociales, tome I, p. 19].
La menace croissante que le développement sauvage d’une industrialisation motivée par la recherche du profit privé, sans égard à la préservation de l’environnement, à l’épuisement des ressources, etc., fait désormais peser sur la survie même du monde pourrait inciter à tourner le dos à ce fondement de l’analyse marxiste qu’est le développement des forces productives comme condition nécessaire de l’émancipation économique.
Pourtant, le triomphe sur la pénurie demeure l’objectif de base à réaliser et c’est en ce sens que le contenu à donner au développement des forces productives devient un enjeu social, un enjeu de la lutte des classes. L’étendue à l’échelle sociale des moyens de production rend pour la première fois possible dans l’histoire de l’humanité leur prise de possession par la société.
Elle rend aussi nécessaire cette prise de possession comme moyen indispensable de surmonter l’obstacle que constitue désormais leur appropriation privée par une classe qui domine de ce fait politiquement, économiquement et intellectuellement le reste de la société, lui impose les conséquences néfastes de sa course aux profits et bloque ainsi un réel développement des forces productives en précipitant des millions de travailleurs et de travailleuses en chômage, en maintenant inutilisées des quantités énormes de capacités productives, en créant délibérément des raretés comme moyen de garantir les taux de profit, en érigeant le gaspillage en mode de vie et en menaçant la survie de la planète par sa destruction de l’environnement.
La prise de possession sociale des moyens de production se présente ainsi, à ce stade particulier de l’évolution historique, comme la mise en place des conditions qui se prêtent le mieux à la prise en main collective de son devenir par l’humanité, qui ouvrent la perspective de la domination des forces du marché et de la concurrence par l’organisation consciente et planifiée de l’activité économique et sociale.
Socialisme utopique et socialisme scientifique
Bien avant Marx et Engels, des penseurs critiques des injustices sociales et des privilèges réservés à une minorité possédante ont recherché des solutions à ces maux dans l’édification de sociétés nouvelles. Déjà au début du 16e siècle, à l’époque de la Renaissance, le réformateur anglais Thomas More (1478-1535) avait imaginé un système collectiviste égalitaire qu’il a décrit dans son Utopie, publiée en 1516. Dans le même esprit, le moine dominicain italien Tommaso Campanella (1568-1639) publia sa Cité du soleil en 1623. Le 18e siècle connut à son tour son cortège d’utopies, fondées sur l’abolition de la propriété privée et l’égalité des citoyens; ses principaux représentants sont Morrelly et l’abbé Gabriel de Mably (1709-1785).
Mais les véritables fondateurs de ce que Marx et Engels ont appelé le « socialisme utopique » sont le produit même des premiers développements de la société capitaliste. Leurs écrits datent du début du 19e siècle. Leurs principaux représentants sont Claude-Henri de Saint-Simon (1760-1825), Charles Fourier (1772-1837) et Robert Owen (1771-1858). Ces penseurs, aux largeurs de vues pénétrantes pour leur époque, n’en étaient pas moins limités par les développements mêmes de l’époque. La grande industrie n’en était encore qu’à ses débuts. Son développement n’avait pas encore atteint le stade où s’accentuent les conflits entre forces productives et rapports de production et les conflits entre les classes qui en résultent, faisant du bouleversement du mode de production une nécessité et créant simultanément les moyens matériels d’édifier la société nouvelle. La classe ouvrière qui commençait à peine à émerger était encore incapable d’une action politique indépendante.
A l’immaturité de la production capitaliste, à l’immaturité de la situation des classes, répondit l’immaturité des théories. La solution des problèmes sociaux, qui restait encore cachée dans les rapports économiques embryonnaires, devait jaillir du cerveau. La société ne présentait que des anomalies; leur élimination était la mission de la raison pensante. Il s’agissait à cette fin d’inventer un nouveau système plus parfait de régime social et de l’octroyer de l’extérieur à la société, par la propagande et, si possible, par l’exemple d’expériences modèles. Ces nouveaux systèmes sociaux étaient d’avance condamnés à l’utopie. [Engels, Anti-Düring, p. 294-95]
Ne pouvant se fonder sur des conditions matérielles encore inexistantes, la société socialiste ne pouvait être que le produit de l’imagination. Si les utopistes étaient des utopistes, s’ils devaient tirer de leur tête les éléments d’une nouvelle société, c’est que ces éléments n’émergeaient pas encore de la vieille société elle-même.
Ils critiquaient les conséquences négatives de la société capitaliste dans laquelle ils ne voyaient d’ailleurs que le côté négatif. Ils ne voyaient pas dans le capitalisme ce stade nécessaire dont le produit est la condition essentielle de l’édification du socialisme. Ils voyaient la société collectiviste comme un idéal d’avenir, mais ne pouvaient comprendre que la prise de possession sociale des moyens de production ne peut devenir possible, ne peut devenir une nécessité historique qu’une fois données les conditions matérielles de sa réalisation.
La propriété privée des moyens de production conserve ainsi une légitimité historique tant que ceux-ci sont insuffisamment développés pour que leur gestion à l’échelle sociale puisse être envisagée comme possible. Elle doit d’abord épuiser sa mission historique qui est de réaliser ce développement au terme duquel la prise de possession sociale devient une possibilité et une nécessité.
Certes, le socialisme antérieur critiquait le mode de production capitaliste existant et ses conséquences, mais il ne pouvait pas l’expliquer, ni par conséquent en venir à bout; il ne pouvait que le rejeter purement et simplement comme mauvais. Plus il s’emportait avec violence contre l’exploitation de la classe ouvrière qui en est inséparable, moins il était en mesure d’indiquer avec netteté en quoi consiste cette exploitation et quelle en est la source. Le problème était, d’une part de représenter ce mode de production capitaliste dans sa connexion historique et sa nécessité pour une période déterminée de l’histoire, avec par conséquent la nécessité de sa chute, d’autre part de mettre à nu aussi son caractère encore caché, la critique s’étant jusque là jetée plutôt sur ses conséquences mauvaises que sur sa marche même. [Engels, Anti-Düring, p. 55]
Ainsi définie, la tâche du socialisme scientifique se démarque radicalement de celle du socialisme utopique. Alors que les utopistes étaient, pour les raisons déjà expliquées, essentiellement des constructeurs de systèmes, Marx et Engels n’ont proposé que des descriptions très sommaires de ce que pourrait être la société socialiste. Ils voyaient l’élaboration de modèles du socialisme comme une préoccupation étrangère à leur conception de l’histoire. Dans une lettre à Arnold Ruge, co-fondateur avec Marx des Annales franco-allemandes en 1843, ce dernier écrivait:
Nous n’anticipons pas sur le monde de demain par la pensée dogmatique, mais nous ne voulons trouver le monde nouveau qu’au terme de la critique de l’ancien (…) Si construire l’avenir et dresser des plans définitifs pour l’éternité n’est pas notre affaire, ce que nous avons à réaliser dans le présent n’en est que plus évident; je veux dire la critique radicale de tout l’ordre existant, radicale en ce sens qu’elle n’a pas peur de ses propres résultats, pas plus que des conflits avec les puissances établies. [Marx-Engels, Correspondance, Éditions sociales, tome 1, p. 297-98]
Jamais, Marx et Engels n’ont conçu le socialisme ou le communisme comme des modèles imaginés à réaliser. Leurs préoccupations ont porté essentiellement sur le mouvement qui transforme la société existante et les forces qui le poussent en avant, comme ils l’expriment, en particulier, dans L’Idéologie allemande:
Le communisme n’est pour nous ni un état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l’état actuel. Les conditions de ce mouvement résultent des prémisses actuellement existantes. [IA, p. 64]
Le socialisme, pour Marx et Engels, que les individus et les classes en aient conscience ou non, n’est rien d’autre que l’aboutissement du mouvement réel, celui qui engage le travail dans la lutte contre le capital, qui « abolit l’état actuel » par la lutte des travailleurs et travailleuses pour la défense de leurs aspirations à des conditions de vie et de travail meilleures. L’accent sur le mouvement réel est ici central.
Ce mouvement doit être guidé, certes, mais il fraye son chemin dans les conditions réelles et concrètes dont les contours ne peuvent être connus à l’avance avec certitude, où les questions pratiques de la transition se posent et doivent être résolues sur le terrain, là où s’affrontent continuellement le passé et un devenir qui lui-même, à terme, doit faire place à un stade plus avancé de la marche en avant.
Il n’y a pas de place dans un tel développement pour un ensemble de recettes que d’aucun ont regretté ne pouvoir trouver toutes prêtes chez Marx. Les rapports entre plan et marché, les problèmes du calcul économique, les méthodes de fixation des prix, de prise des décisions, toutes ces questions d’ordre économique, comme les autres, d’ordre politique et social, doivent être abordées et résolues à mesure qu’elles se présentent.
Connaissance scientifique et abstraction
Comme l’explique Marx dans l’Introduction à la critique de l’économie politique de 1857, la démarche scientifique a pour objectif de connaître la réalité et non simplement d’en prendre conscience, de l’expliquer et non simplement de la décrire. Elle dépasse le fait particulier; elle doit être d’ordre général. Elle vise à reconstruire dans la pensée, par la pensée, le réel expliqué.
Dans ce processus, le point de départ de l’intuition est le concret, le réel, le particulier; mais le concret apparaît dans la pensée comme résultat et non comme point de départ, même s’il est le point de départ de l’intuition.
C’est pourquoi il faut procéder à partir des catégories les plus simples et les plus générales pour reconstruire le réel, un réel désormais compris, éclairé. La méthode scientifique procède du simple au complexe, de l’abstrait au concret, du général au particulier.
L’abstraction consiste à éliminer les particularités d’une chose pour ne conserver que sa généralité: le travail en général ou travail abstrait est une abstraction des travaux concrets particuliers, la matière est une abstraction qui représente ce qu’ont en commun tous les objets matériels. Ces créations de la pensée sont indispensables à la connaissance scientifique.
L’abstraction n’est pas spécifique à la méthode marxiste; ce qui lui est spécifique est la prise en compte du caractère historique et social particulier de toute production. Ainsi, le travail abstrait en production marchande est le travail concret dépouillé de ses particularités selon des modalités propres à l’économie marchande, par l’égalisation des produits dans l’échange.
La méthode du Capital
Le Capital de Marx commence par l’analyse des catégories simples, générales et abstraites de marchandise, valeur, argent, travail en général, capital en général, profit en général ou plus-value… pour en arriver à reconstruire la réalité complexe de l’économie, celle des prix, des profits, des capitaux particuliers et de leur concurrence, celle de l’industrie, du commerce et de la finance, de l’accumulation et de la concentration du capital, du rôle de l’État, du marché mondial, des déséquilibres et des crises.
Aux diverses catégories économiques analysées, correspondent des rapports sociaux, qui sont au centre de l’analyse marxiste.
L’analyse marxiste du capitalisme se présente comme l’analyse d’une succession de rapports sociaux d’une complexité croissante, une analyse de la genèse de ces rapports et des catégories correspondantes, chaque rapport s’outrepassant pour engendrer le suivant, chaque nouvelle catégorie portant la marque de la précédente.
Marx étudie d’abord le rapport le plus simple, le rapport d’échange qui s’établit entre deux producteurs de marchandises.
Ce rapport caractérise la production marchande en général. Il a précédé historiquement la production capitaliste, mais il atteint son plein développement dans la société capitaliste arrivée à maturité.
Il s’agit d’un rapport entre personnes, même s’il se présente sous la forme d’un rapport entre choses, entre marchandises échangées dont on compare les valeurs; la mise en lumière de ce fait est un aspect central de l’apport de Marx.
Les contradictions de ce rapport d’échange simple trouveront leur solution dans le fait que la propriété de représenter la valeur de toutes les marchandises sera transmise à une marchandise particulière, la monnaie.
À son tour, le développement de l’argent en moyen d’accumulation conduira à l’établissement d’un nouveau rapport, celui qui s’établit par l’intermédiaire de l’argent devenu capital, entre le capitaliste et le travailleur, le rapport fondamental de la société capitaliste.
Biens utiles et marchandises
Toute société produit des biens ayant une valeur d’usage, des biens utiles destinés à satisfaire des besoins.
Toute société répartit à cette fin son temps de travail social entre les diverses activités et répartit les produits de ce travail entre leurs diverses utilisations.
Cette répartition prend des formes différentes dans des sociétés différentes; elle peut être réalisée directement par le biais d’un plan ou indirectement par l’intermédiaire du marché.
Dans les sociétés marchandes, où la répartition est assurée par l’échange, les biens utiles deviennent des marchandises; le contenu général qu’est le bien utile prend la forme sociale particulière de la marchandise.
La production de biens utiles est une détermination générale de toute société; la production de marchandises est une détermination historique particulière des sociétés marchandes, fondées sur la propriété privée et l’échange.
Valeur et valeur d’échange
En somme, les marchandises sont des biens utiles ou valeurs d’usage, produits par des producteurs privés indépendants et répartis par l’intermédiaire de l’échange.
Pour pouvoir s’échanger, des marchandises qualitativement différentes doivent être quantitativement égales. Différentes au plan des valeurs d’usage, elles doivent être égales au plan des valeurs. Valeur d’usage et valeur constituent une caractérisation double et contradictoire de la marchandise.
La valeur d’une marchandise détermine les proportions dans lesquelles elle s’échange contre d’autres marchandises; elle se manifeste extérieurement sous la forme de la valeur d’échange, c-a-d du rapport d’échange réel qui s’établit sur le marché et qui varie en fonction des circonstances. Elle a pour substance le travail humain commun à toute activité, le travail abstrait dépouillé des caractéristiques particulières des divers travaux concrets, un travail égal et indistinct, socialement égalisé par l’échange.
Le travail est un contenu qui prend des formes sociales diverses; dans la société marchande où les produits du travail sont nécessairement destinés à l’échange en tant que marchandises, le contenu en travail des marchandises acquiert nécessairement la forme de la valeur. Le travail privé n’y devient social que s’il est mis en équivalence par l’échange avec les autres travaux privés, en tant que valeur.
Il ne faut donc pas confondre travail et valeur. La valeur n’est pas une simple quantité de travail. Elle est du travail sous une forme sociale déterminée, du travail réparti sous l’effet de l’égalisation des marchandises dans l’échange.
Loi de la valeur et fétichisme de la marchandise
C’est par l’intermédiaire de l’échange de produits en tant que valeurs que se réalise la répartition du travail entre les diverses activités. En ce sens, la valeur n’est pas une simple quantité, une simple expression des coûts de la production. Elle exprime un rapport social.
Pour Marx, l’analyse de la valeur est le fondement de la compréhension de la société marchande; elle consiste en une analyse des rapports sociaux qui s’établissent entre les individus par l’intermédiaire des choses. L’échange des marchandises en proportion de leurs valeurs est le moyen par lequel se répartit le travail dans la société marchande et s’établit la coordination entre producteurs d’une part, producteurs et consommateurs d’autre part.
La marchandise acquiert ainsi le caractère d’un fétiche, régulateur de l’activité économique. La société marchande est une société dans laquelle la connexion entre les individus ne peut s’exprimer que sous une forme matérielle, sous la forme des produits du travail que sont les marchandises, dans l’échange.
En économie marchande, les travaux privés ne sont pas immédiatement du travail social. Pour le devenir, il faut que les marchandises qui en sont le fruit subissent avec succès l’épreuve du marché, qu’elles se vendent, qu’elles se transforment en monnaie.
La transformation des marchandises en monnaie est le moyen par lequel les travaux privés dont elles sont le produit se trouvent validés en tant que travail social. Elle constitue la preuve que ces travaux privés étaient socialement justifiés, qu’ils n’étaient pas « de trop » ni en quantité insuffisante compte tenu du besoin social solvable, c-à-d de la demande globale de ces marchandises.
Le fondement de l’analyse marxiste de la monnaie est cette dimension qualitative de la monnaie, la nécessaire transformation de la marchandise en monnaie, qui inclut la possibilité de sa non-transformation. Ainsi comprise, la monnaie ne saurait être réduite à un contenu technique et quantitatif d’unité de compte et de moyen qui facilite les échanges. Elle exprime avant tout un rapport social de coordination des producteurs privés au sein de la société marchande.
Elle est la forme spécifique par laquelle le travail y acquiert son caractère social. Elle est la médiation nécessaire par laquelle s’opère la socialisation du travail dans cette société. Telle est la substance de la monnaie, son essence, sa dimension la plus importante, celle qui est négligée par les théoriciens non-marxistes pour qui l’analyse de la monnaie se résume à celle de ses différentes fonctions.
Dans une société planifiée, où la répartition du travail et des produits qui en découlent serait le résultat, non de l’échange, mais d’un plan, une comptabilité sociale directe serait nécessaire, qui reposerait sur l’utilisation d’une unité de compte. Mais une telle unité de compte ne serait pas l’équivalent de la monnaie, selon le sens qui vient de lui être donné. En économie marchande où les produits du travail sont des marchandises, la mesure du temps de travail nécessaire à leur production ne peut être le résultat d’un calcul direct a priori, pas plus que le travail privé n’est immédiatement social. Elle est révélée a posteriori par l’échange, en tant que valeur.
La mesure commune des valeurs par la monnaie est donc la forme indirecte que prend nécessairement la mesure du travail en économie marchande. L’unité de compte est une catégorie générale commune à toutes les sociétés. La monnaie est sa forme sociale spécifique en économie marchande, tout comme la marchandise et la valeur sont respectivement les formes qu’y prennent les catégories générales de bien utile et de temps de travail socialement nécessaire.
La théorie marxiste de la monnaie se distingue des autres théories en ce qu’elle envisage la monnaie non comme une catégorie universelle, mais comme l’expression d’un rapport social spécifique de la phase historique de la production marchande. Elle distingue la substance ou l’essence de la monnaie de ses divers rôles fonctionnels ou des services qu’elle rend. Elle analyse par ailleurs ces derniers non comme une pure question technique, mais dans leurs rapports réciproques, dans le cadre de la fonction sociale de la monnaie comme équivalent général.
Dans sa fonction de moyen de circulation, la monnaie permet la vente des marchandises, leur transformation en argent. Elle permet aux travaux privés de démontrer leur validité sociale.
La genèse du capital
L’étape suivante consiste à faire la genèse du capital. Des limites de la circulation simple M-A-M, surgit la nécessité de la circulation de l’argent comme capital, A-M-A’.
Dans la circulation simple, la finalité de l’opération est la consommation finale improductive de valeur d’usage, à l’extérieur de la circulation; l’argent en tant qu’argent ne sert que d’intermédiaire dans l’échange des marchandises. Il est simplement dépensé.
Dans la circulation du capital, ce sont les marchandises qui servent d’intermédiaire au mouvement de l’argent en tant que capital et dont la consommation productive permet sa conservation et son accroissement; l’argent n’est qu’avancé et doit revenir en quantité supérieure.
Comme forme universelle de la richesse, l’argent ne peut avoir qu’un mouvement quantitatif, tendre à se multiplier sans limites. Le capital est l’expression de ce mouvement ininterrompu de mise en valeur, de poursuite de l’enrichissement comme fin en soi. Il se présente ainsi comme un processus.
Le développement de l’argent en moyen d’accumulation conduit à l’établissement d’un nouveau rapport, celui qui s’établit par l’intermédiaire de l’argent devenu capital, entre le capitaliste et le travailleur, le rapport fondamental de la société capitaliste.
Comme pour la marchandise et l’argent, Marx parle du fétichisme du capital identifié à une masse de choses, les moyens de production, et de la réification du rapport social qu’il représente.
À la réification des rapports sociaux, Marx associe une autre propriété de la société marchande, la personnification des choses. Le capitaliste est une simple personnification du capital, le capital en chair et en os, un individu dont la seule raison d’être est de faire fructifier le capital.
L’accumulation sans limites, à l’origine de la crise écologique
D’entrée de jeu, ce résultat qui se dégage des notions de base les plus élémentaires tirées des premiers chapitres du Capital jette un éclairage sur l’un des problèmes les plus cruciaux de notre époque, celui de la crise écologique.
La course à l’abîme dans laquelle l’humanité est engagée par la surconsommation des ressources jusqu’à leur épuisement et par la destruction de l’environnement trouve son origine dans les fondements mêmes d’un système poussé à accumuler le capital sans limites.
La logique du système capitaliste, dont les dérèglements sont enracinés dans ses fondements, donne lieu à une accumulation sans égard à la destination sociale des investissements. Le seul objectif est la réalisation du rendement visé et plus particulièrement, avec le tournant néolibéral des vingt-cinq dernières années, du rendement à court terme.
Dans le cadre du capitalisme, le travail humain interagit avec la nature, non pas en tant que travail concret producteur de valeurs d’usage, mais en tant que travail abstrait producteur de valeurs, dans un processus sans fin de valorisation du capital.
La production de valeur d’usage n’a d’autre fonction que de contribuer à accroître la valeur. En un mot, elle n’est qu’un mal nécessaire pour faire de l’argent, sans considération des conséquences. La société est ainsi poussée à s’autodétruire comme conséquence de son fonctionnement normal.
À titre d’illustration, l’exploitation effrénée des sables bitumineux de l’Alberta, propulsée par l’appât des profits pétroliers, constitue non seulement le principal obstacle à la contribution du Canada à la nécessaire lutte mondiale contre les gaz à effet de serre, mais a des incidences négatives gigantesques, banalisées par le système, sur l’environnement immédiat des champs d’exploitation.
Le capital dont il s’agit à ce niveau de l’analyse est le capital en général, ou capital abstrait, que Marx développe dans les deux premiers livres du Capital. Les formes concrètes du capital sont étudiées dans le Livre III.
Capital financier, capital porteur d’intérêt, capital fictif
Il convient de mettre l’accent sur une dimension fondamentale de ces formes concrètes mise en lumière par Marx, qui a tardé à être prise en compte, à savoir le mouvement propre du capital financier. Marx décrit le capital financier comme une fraction, sous forme de capital de prêt, issue de l’accumulation réelle, mais séparée du capital total (industriel et commercial) et devenue autonome.
Ce caractère autonome du capital financier est mis en évidence dans la forme d’accumulation du « capital porteur d’intérêt », A-A’, un processus qui est à la fois dépendant et distinct de l’accumulation du capital réel, où nous avons, comme l’écrit Marx, « de l’argent produisant de l’argent, une valeur se mettant en valeur elle-même, sans aucun procès qui serve de médiation entre les deux termes » .
La notion de « capital porteur d’intérêt » comprend la dimension du crédit, c’est-à-dire du « capital de prêt » ou de financement de l’activité réelle, ce qui inclut le financement des besoins des particuliers comme celui du capital industriel et du capital commercial. Mais elle la transgresse pour incorporer le « capital fictif », dont le rôle est déterminant dans le développement des crises financières.
Une composante majeure, sinon la plus importante, du virage intervenu à partir des années 1960 et, de manière déterminante, des années 1980 est le passage, à la faveur de la libéralisation et de la déréglementation, d’un régime d’accumulation international dans lequel le cycle du capital se déroulait sur une base nationale, à un régime proprement mondial où des masses de capital volatil détachées de l’investissement dans la production sont désormais libres de se déplacer dans l’espace planétaire strictement en fonction des besoins de leur auto-valorisation.
La principale spécificité de cette nouvelle donne est la prédominance de la finance, le développement à grande échelle de cette catégorie de capital que Marx désignait déjà comme le capital fictif il y a 150 ans et dont il a minutieusement analysé la nature dans le Livre III du Capital.
Ce que Marx désigne comme le capital fictif consiste dans les divers titres, tels les actions émises par les entreprises en contrepartie de participations au financement de leur capital réel, et les obligations émises par les entreprises et les organismes publics en contrepartie des prêts qui leur sont consentis.
Ces titres circulent comme des marchandises en bonne et due forme sur un marché spécifique, le marché de la finance, distinct du marché où se transigent les marchandises réelles. Leurs prix fluctuent sur ce marché et sont fixés selon des lois qui leur sont propres « renforçant l’illusion qu’ils constituent un véritable capital à côté du capital qu’ils représentent » (Le Capital, Éditions sociales, tome VII, p. 129).
Les transactions financières, portant sur des titres, finissent par rendre invisible le processus qui est à l’origine des dividendes et des intérêts qui en sont les revenus.
Ainsi, il ne reste absolument plus trace d’un rapport quelconque avec le procès réel de mise en valeur du capital et l’idée d’un capital considéré comme un automate capable de créer de la valeur par lui-même s’en trouve renforcée. (idem).
Le seul fait qu’un bout de papier permette à son détenteur de percevoir un montant déterminé à date fixe fait apparaître ce bout de papier comme un capital et le montant d’argent auquel il donne droit comme l’intérêt que rapporte ce capital. À la limite, la séparation entre le capital réel et le capital fictif censé le représenter, mais devenu autonome face à lui, peut être telle que l’apparence des choses, traduite dans les données du capital financier, soit en contradiction totale avec la réalité.
« Même une accumulation de dettes, écrit Marx, arrive à passer pour accumulation de capital » (Le Capital, tome VII, p. 139). Mieux encore, les titres d’une dette publique contractée pour faire l’acquisition de biens détruits par la guerre par exemple continuent à circuler alors que ces biens n’existent plus, de sorte que la ruine prend la forme de l’enrichissement; le capital fictif s’enfle dans la mesure même où le capital productif est détruit » (Manifestes, thèses et résolutions des Quatre premiers congrès de l’Internationale communiste, Paris, Maspero, 1972, p. 86)].
Dans la sphère financière, l’argent semble faire de l’argent sans rapport avec le processus réel de production des valeurs. Des transactions boursières portant sur les actions d’une entreprise peuvent produire un rendement financier supérieur à celui que cette même entreprise obtient dans la sphère réelle par la fabrication et la vente de marchandises. Une envolée des cours boursiers peut très bien se produire à un moment où l’économie est stagnante.
Comme fruit des politiques néolibérales, dans un monde où les marchés financiers dominent l’économie de part en part, la spéculation tend à devenir le mode de fonctionnement normal de la sphère financière.
De par sa nature, la sphère financière est par ailleurs le lieu propice de la manipulation et de la fraude, le lieu où les « initiés » influencent les fluctuations des valeurs des titres pour en tirer un profit par la magie de la « comptabilité créative », par le rachat de leurs propres titres par les entreprises, grâce à l’endettement. L’éclatement de la bulle financière du début des années 2000 en a fourni un exemple frappant avec les retentissants scandales d’Enron, World Com, Tyco, etc. qui ont révélé une fraude érigée en système.
À l’aune de la déréglementation, on a vu déferler au cours de cette période, dans l’ensemble des secteurs mais particulièrement dans celui des technologies de l’information et des communications, une vague de création de méga-conglomérats résultant de fusions-absorptions et d’acquisitions, souvent à des prix nettement supérieurs à la valeur des actifs acquis et en contrepartie d’un endettement massif.
Pour toutes les débâcles qui en ont résulté, les mêmes causes : des acquisitions tous azimuts aux fins de l’élimination de la concurrence, réalisées à des prix dépassant la valeur réelle des actifs acquis et source d’un endettement prohibitif, dans l’expectative optimiste de bénéfices qui n’ont pas été au rendez-vous.
Les conséquences : la faillite pure et simple de l’entreprise, son démantèlement ou son sauvetage in extremis par la vente d’actifs et des mesures dites de rationalisation, telles des licenciements massifs; dans tous les cas, des radiations d’actifs (de valeurs équivalant à la différence entre la valeur très élevée d’acquisitions et la valeur du marché au moment de la radiation), la volatilisation de milliards de dollars qui révèlent brutalement leur caractère de capital purement fictif dont la valeur élevée n’était qu’artificielle, poussée à ces sommets par la spéculation et les pratiques frauduleuses.
Cela illustre le fait que, livré à lui-même, le capitalisme est en proie à de profondes difficultés et qu’il est constamment à la recherche de moyens artificiels pour tenter de les surmonter, comme la création de masses de capital fictif, qui s’écroulent par la suite comme des châteaux de cartes.
Une succession ininterrompue de crises
L’importance de la crise des valeurs technologiques en 2000-2001 ne doit faire oublier que la totalité de la période de la mondialisation du capital de placement à l’aune de la libéralisation et de la déréglementation a été parsemée de crises financières : crise mexicaine de 1982, suivie de la crise de la dette des pays sous-développés, provoquées par la hausse du dollar et des taux d’intérêt aux États-Unis, crise boursière de 1987 aux États-Unis, suivie en 1989 par la faillite et le sauvetage des Caisses d’épargne et de crédit, crise de la bourse de Tokyo et crise immobilière japonaise en 1990, nouvelle crise de la dette au Mexique en 1995, crise des pays « émergents » d’Asie en 1997 et contrecoup de cette crise au Brésil, en Argentine et en Russie.
En août 2007 une nouvelle crise, dont le monde n’est toujours pas sorti, a secoué le monde entier, par l’éclatement de la bulle immobilière et la crise du papier commercial adossé à des actifs (PCAA).
Cette crise a été engendrée par les moyens mêmes qui avaient été favorisés pour tirer l’économie des États-Unis de la léthargie consécutive au dégonflement de la « bulle technologique » en 2001 et 2002 : taux d’intérêt fixés à un niveau exceptionnellement bas par la banque centrale, la Réserve fédérale, désignation du secteur immobilier comme un vecteur majeur de la relance économique, promotion de l’accès à la propriété sans égard aux moyens financiers des acheteurs et refinancement des hypothèques sous la forme de marges de crédit hypothécaires destinées à accroître la consommation courante.
S’en est suivi un fort mouvement spéculatif qui a transformé le logement de lieu de résidence en actif financier revendable avec profit et donné lieu à un investissement excessif dans la construction de logements, composante d’une surproduction générale de marchandises et d’une sur-accumulation de capital sous la forme de moyens de production atteignant tous les secteurs de l’économie.
En arrière plan de la crise financière on retrouve, comme dans toutes les crises capitalistes, la crise économique comme telle, celle d’une sur-accumulation du capital en proie à des difficultés de valorisation.
De la crise de la dette privée à la crise de la dette publique
À la suite de l’éclatement de la crise financière en 2007, les gouvernements et les banques centrales de la plupart des pays ont mis en œuvre des programmes de relance économique et des mesures de sauvetage d’établissements financiers et de grandes entreprises industrielles qui ont gonflé leurs dépenses.
Un fort accroissement de l’endettement public en a résulté qui a acculé certains pays à la crise et menacé les banques créancières.
En dépit de leurs interventions massives, gouvernements et banques centrales ne sont pas parvenus à relancer les économies avancées. Le chômage demeure à des niveaux très élevés et la croissance anémique.
Se refusant à restaurer un niveau adéquat d’imposition, ils ont adopté de sévères politiques d’austérité en vue de rééquilibrer les budgets et de réduire l’endettement : tarification accrue et réduction des services publics et de l’aide sociale, réduction des salaires des fonctionnaires et licenciement de personnel, réduction des avantages des régimes de retraite, relèvement des taxes à la consommation, etc.
Non seulement ces mesures d’austérité ont-elles pour effet de reporter sur la population travailleuse le coût de la réparation de manœuvres financières dont elles ne sont pas responsables alors que les coupables jouissent de l’impunité, mais elles ont aussi pour conséquence d’empirer la situation en bloquant la reprise économique et en maintenant le chômage à des niveaux historiquement élevés. La médecine imposée tue le malade au lieu de le remettre sur pied.
« Trop gros pour faire faillite »
Ne jurant jusqu’alors que par le marché, les gouvernements des principaux pays capitalistes sont intervenus massivement à coup de milliards de dollars de fonds publics pour acquérir une partie du capital de grandes banques, de sociétés d’assurance et d’autres établissements privés, dans le but d’en assurer le sauvetage aux frais de la collectivité et de jeter les bases d’un retour intégral à l’initiative privée rentable, par conséquent à l’anarchie qui en est le fondement et aux crises à venir qui ne peuvent qu’en découler.
Ils ont invoqué pour ce faire l’argument du « trop gros pour faire faillite » et agité l’épouvantail des risques encore plus grands pour l’économie et l’emploi, qui résulteraient d’un refus des pouvoirs publics d’intervenir.
Ces interventions de l’État mettent clairement en évidence l’impasse à laquelle le système de la propriété privée mène lorsqu’il est livré à lui-même, et l’obligation qui s’impose à lui de chercher la voie de sortie de cette impasse à l’extérieur de ses propres cadres, c’est-à-dire à l’extérieur du cadre de l’initiative privée en faisant appel à l’État.
La crise actuelle met éminemment en relief les limites de ce système, l’incompatibilité, comme le disait Marx, entre la taille de plus en plus grande, c’est-à-dire de plus en plus sociale, des moyens de production et le caractère de plus en plus privé et concentré de leur propriété.
Une incompatibilité qui désigne la nécessité de leur prise en main par la collectivité et de leur planification démocratique en tant que biens publics dotés d’une mission de service public.
« Trop gros pour demeurer privé »
Il faut d’abord prendre conscience de ce qu’une entreprise privée qui serait jugée « trop grosse pour faire faillite » et dont la survie reposerait sur le soutien de l’État devrait être considérée comme « trop grosse pour demeurer privée », sous gestion privée et source de profits privés.
La mise sous propriété publique des grandes banques et des établissements de crédit garantirait l’exercice de la fonction sociale qui est la leur et bannirait la spéculation, la fraude et les indécentes rémunérations des dirigeants qui gangrènent le système.
Elle serait un outil clé du contrôle à conquérir par la collectivité sur l’organisation générale de l’activité productive et distributive et sur l’orientation de l’investissement en fonction des besoins sociaux et de la protection du milieu de vie.
Pour reprendre les termes du grand collaborateur de Marx qu’était Friedrich Engels, ce processus constitue une « nécessité économique objective » qui pousse le « représentant officiel de la société capitaliste, l’État », à prendre la direction de grandes entreprises à ce stade de leur développement, lorsqu’elles sont devenues « réellement trop grandes pour être dirigées par les sociétés à actions ».
Une telle étatisation, précisait-il, « signifie un progrès économique, même si c’est l’État actuel qui l’accomplit ». Elle signifie « qu’on atteint à un nouveau stade, préalable à la prise de possession de toutes les forces productives par la société elle-même »2.
L’illégitimité des dettes publiques
L’autre question cruciale que soulève la crise, plus particulièrement sa transmutation en crise des dettes publiques et en crise sociale des peuples, est celle de l’illégitimité de ces dettes et du refus de les rembourser.
Elle s’est manifestée en Islande par le double refus de la population par voie référendaire de payer pour l’indemnisation des déposants de la banque internet faillie Icesave, face à laquelle elle ne se reconnaît aucune responsabilité.
Elle se pose aussi de manière brûlante en Grèce, en Irlande et au Portugal, ainsi qu’en Espagne et en Italie, où les populations sont écrasées par des plans d’austérité plus sévères les uns que les autres, qui ne parviennent pas à réduire les déficits budgétaires en pourcentage du PIB, mais qui ont plutôt pour effet d’accroître l’endettement en déprimant l’activité économique.
On a procédé en Grèce, en octobre 2011, à la radiation d’un peu plus de 50% de la dette détenue par les banques privées.
La situation est aggravée par les pratiques criminelles des agences de notation qui, par les abaissements successifs des notes de crédit des États débiteurs, provoquent une augmentation encore plus forte de leur dette dont la source principale est le poids des intérêts astronomiques qui en découlent et non le déficit d’opérations, ou déficit primaire, c’est-à-dire le déséquilibre entre les dépenses courantes (sans les intérêts sur la dette) et les revenus courants.
Les pays débiteurs sont ainsi précipités dans une spirale sans fin qui confine à l’impasse. Plus un pays a de la difficulté à « honorer » sa dette, plus les agences de notation abaissent sa note de crédit, ce qui entraîne une nouvelle augmentation des taux d’intérêt et par conséquent une intensification des difficultés de financement, voire une incapacité de payer les intérêts périodiques dont le montant vient grossir la dette; suit un nouvel abaissement de la note de crédit et ainsi de suite, ce qui finira tôt ou tard par acculer le pays au défaut de paiement, quelles que soient les mesures d’austérité toujours plus sévères qu’on tentera d’imposer aux populations.
Celles-ci sont de plus en plus conscientes de ce que ces dettes ne sont pas les leurs, mais qu’elles sont le résultat de la spéculation, de la hausse des frais d’intérêt provoqués par l’abaissement des notes de crédit par les agences de notation, du coût du sauvetage des banques et des entreprises renflouées par l’État, du maintien des budgets militaires, ainsi que de la complaisance des États envers l’évasion et l’évitement fiscaux et des réductions d’impôt accordées aux entreprises et aux nantis de la société, ceux-là même dont l’épargne qu’ils en récoltent est offerte aux États en prêts bien rémunérés.
Les détenteurs de titres de la dette publique sont gagnants sur les deux tableaux : bénéficiaires d’une fiscalité favorable, l’État se tourne vers eux pour solliciter, sous forme de prêts dont le rendement est garanti, les sommes dont ils sont exonérés en impôts et taxes. Il y a là une injustice évidente qui ne pourra manquer d’amener les populations à s’interroger sur la légitimité des dettes qui les étouffent et à douter de l’opportunité d’en assumer le fardeau.
Il n’y aura pas de fin au marasme sans action concertée des mouvements sociaux et des grandes organisations du travail, cherchant leur voie sur le terrain politique et se portant candidats à la direction de la société.
Ce serait une erreur de voir la crise actuelle comme une crise de la seule phase néolibérale du capitalisme ou de sa forme « financiarisée », qu’on pourrait surmonter par un sain retour à un capitalisme « civilisé » purgé de ses récents excès et dérives.
Il s’agit au contraire d’une crise des fondements mêmes du capitalisme et de sa capacité de réaliser la profitabilité essentielle à sa seule finalité qu’est l’accumulation sans limite du capital, indépendamment de ses conséquences sur la destruction du milieu de vie et la survie de l’humanité.
Ces notes s’appuient sur les deux livres suivants dont je suis l’auteur : «Fondements et limites du capitalisme», Montréal, Boréal, 1996, et «La crise financière et monétaire mondiale», Deuxième édition, Montréal, M Éditeur, 2012.
Notes :
1. COMECON ou CAEM (Conseil d’aide économique mutuelle), fondé en 1949 et dissout en 1991. Il regroupait l’URSS, ses six satellites d’Europe de l’Est, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, République démocratique allemande et Tchécoslovaquie, et Cuba, la Mongolie et le Vietnam.
2. Friedrich Engels, Anti-Dühring, Éditions sociales, p. 314.