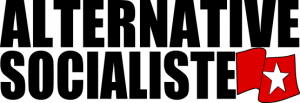Ce livre écrit par l’écrivain uruguayen Eduardo Galeano, paru en 1971, est rapidement devenu un classique. En dépit de ses cinquante ans, ce récit détaillé et compact de l’histoire coloniale de l’Amérique latine est toujours d’actualité.
L’ouvrage revient sur cinq siècles d’exploitation exceptionnelle. D’abord l’or, l’argent et les diamants, puis le sucre, le cacao, le coton, le caoutchouc, les fruits et finalement le pétrole. Afin d’extraire ces richesses, les peuples indigènes ont été exploités dans un travail cruel au fond des mines et, lorsqu’ils n’ont plus suffi, les esclaves du continent africain ont été envoyés dans les plantations.
Il existe une grande différence entre l’histoire de l’Amérique du Nord et celle de l’Amérique latine. Les colonisateurs d’Amérique du Nord sont venus construire une nouvelle vie, bien que sur des terres volées, et se sont ensuite libérés de la couronne britannique. Les colonisateurs d’Amérique latine ont au contraire vidé le continent de ses richesses. Galeano explique les choses ainsi: «Car le nord de l’Amérique n’avait ni or ni argent, ni civilisations indiennes avec des concentrations denses de personnes déjà organisées pour le travail…»
Alors que l’Amérique du Nord se remplissait d’ouvriers et de paysans devenus obsolètes en Europe, les capitalistes d’Amérique latine disposaient d’une réserve de main-d’œuvre énorme et bon marché sous la forme des peuples indigènes et des esclaves. L’exploitation des richesses de l’Amérique latine était synonyme d’emplois, de développement et de prospérité en Europe et en Amérique du Nord, mais pas pour les peuples d’Amérique latine ni pour les victimes de la traite des esclaves. «L’exploitation des conquérants européens a entraîné non seulement un génocide, mais aussi de nombreux génocides parallèles au cours desquels des civilisations entières ont été anéanties.» En plus de conduire à l’anéantissement horrible et systématique d’êtres humains, cette exploitation a également entraîné une destruction culturelle et scientifique ainsi qu’un désastre écologique.
En même temps, le succès de chaque matière première était de courte durée. Bientôt, un autre continent produisait les mêmes biens moins chers, plus rapidement et plus efficacement, et l’effondrement devint vite un fait. L’Amérique du Nord a repris la production de coton et le Ghana celle de cacao. Parallèlement, toutes les tentatives d’industrie nationale étaient contrecarrées par les marchandises importées. «Des agents commerciaux de Manchester, Glasgow et Liverpool visitèrent l’Argentine et copièrent les ponchos de Santiagan et Córdoban et les articles en cuir de Corrientes, ainsi que les étriers en bois locaux. Les ponchos argentins coûtent sept pesos, ceux des Yorkshire trois. L’industrie textile la plus avancée du monde l’emportait au galop sur les produits des métiers à tisser indigènes, et il en était de même pour les bottes, les éperons, les grilles de fer, les brides et même les clous.»
Le Paraguay s’est toutefois distingué. Au milieu de l’Amérique du Sud, sans côtes, voici un pays avec ses propres industries sans profiteurs étrangers. Un État fort au lieu d’une bourgeoisie fantoche a posé les bases d’une économie qui a connu un certain développement et une certaine forme de prospérité au lieu d’un libre-échange défavorable avec l’Europe ou les États-Unis. Mais l’exemple n’a pas été de longue durée. Au cours d’une guerre de six ans menée sur trois fronts, le Paraguay a été écrasé à la fin des années 1800 avec l’aide de capitaux venus d’Angleterre. Plus de 60% de la population y a trouvé la mort et le pays a été laissé en ruines. Aujourd’hui encore, le Paraguay est un pays pauvre caractérisé par l’inégalité, l’instabilité et la corruption.
Un pays qui base toute son économie sur l’exportation de matières premières sans industries ni raffinage est très sensible aux caprices du marché. Nous l’avons encore constaté en 2016 lorsque les prix des matières premières ont chuté et que des pays comme l’Argentine, le Brésil et le Venezuela ont plongé avec eux. Dans «Les veines ouvertes de l’Amérique latine», Galeano décrit en détail comment le continent reste un producteur de matières premières et n’obtient jamais la plus grande part du gâteau: «Avec le pétrole, comme avec le café ou la viande, les pays riches profitent davantage du travail de consommation que les pays pauvres du travail de production.»
La hausse du prix du café entraîne une augmentation des profits, mais pas des salaires. La baisse des prix du café réduit les revenus des travailleurs d’un seul coup dévastateur. Les exportations ont été de pair avec la faim. Les enfants mangeaient la terre pour éviter l’anémie, tandis que les bénéfices quittaient librement le continent. Au Salvador, un quart de la population est décédé à cause de carences en vitamines, tandis qu’une poignée de capitalistes faisaient fortune grâce aux exportations de café.
Le livre de Galeano est rempli d’exemples déchirants, mais il ne tombe jamais dans le sentimentalisme. Il y a un paradoxe ridicule dans le fait que les régions les plus fertiles et les plus riches sont celles qui ont été plongées dans une pauvreté et une famine abyssales. Des terres qui pouvaient nourrir un si grand nombre de personnes ont été vidées de leur substance en y plantant la nouvelle denrée recherchée pour donner naissance à d’immenses monocultures.
Il n’y a plus eu de place pour la production alimentaire. Il a fallu importer des aliments d’autres endroits moins fertiles pour maximiser les profits à court terme. En novembre de cette année, l’ONU a averti que le nombre de personnes souffrant de la faim en Amérique latine a augmenté de 30% depuis 2019. Environ 9% de la population d’Amérique latine et des Caraïbes souffre de la faim, rapporte la chaîne Al Jazeera.
En plus de la violence directe, du travail forcé et de la famine, les infections virales, importée par les colonisateurs, ont tué de larges pans des peuples indigènes. La pandémie de coronavirus a démontré que, même ces dernières années, les peuples indigènes sont toujours marginalisés en Amérique latine. Nombre d’entre eux travaillent comme femmes de ménage, nounous, concierges, etc. dans les maisons des familles aisées des grandes villes.
Lorsque la pandémie a frappé de plein fouet, nombre d’entre eux se sont retrouvés sans travail et ont dû retourner dans leurs villages d’origine en emportant l’infection avec eux. Dans des endroits isolés, avec une population vieillissante et de longues distances pour accéder aux hôpitaux et aux médecins, le virus s’est rapidement propagé. L’isolement, qui aurait pu être une aide pour échapper à la pandémie est devenu une condamnation à mort. Le taux de mortalité parmi les personnes ayant reçu la Covid-19 chez les peuples indigènes du Brésil est de 9,1%; le chiffre correspondant pour le reste de la population est de 5,2%.
En même temps, la pandémie a créé une instabilité économique supplémentaire dans la région. L’Amérique latine est l’une des régions les plus inégalitaires du monde. Et ce sont les peuples indigènes et les descendants d’esclaves qui sont de loin les plus mal lotis.
Si l’exploitation et la colonisation sont ancrées dans les 500 dernières années de l’histoire de l’Amérique latine, il en va de même pour la résistance, comme le montre brillamment Galeano dans son livre. La première grande révolte d’esclaves a eu lieu dès 1522, lorsque les esclaves se sont soulevés contre le fils de Christophe Colomb, Diego Colomb. Cette première révolte fut loin d’être la seule.
Dans les années 1600, les esclaves qui se sont échappés ont construit leur propre société, Palmares, sur la côte est du Brésil. À Palmares, la faim n’existait pas. On y pratiquait diverses cultures qui permettaient à la communauté d’environ 10.000 personnes de rester autosuffisante, contrairement aux régions où l’on cultivait la canne à sucre.
Dans plusieurs de ces révoltes, la redistribution des terres était l’une des réformes les plus importantes à l’ordre du jour. La vision d’Artiga d’une Amérique latine unie où les peuples indigènes retrouveraient leur droit à la terre est peut-être la plus ancienne. On y trouve les graines d’un rêve d’une société complètement différente. Une vie sans oppression ni violence, où les richesses sont distribuées équitablement. La lutte de dix ans menée au Mexique en 1910-20 par des paysans indigènes sous la direction d’Emiliano Zapata fut porteuse de leçons d’organisation : nationalisation, expropriation des terres, conseils populaires, juges et policiers élus.
C’est une histoire brutale que décrit Galeano. La résistance a été noyée dans le sang par des exécutions, la persécution et la torture. La contre-révolution est généralement bien plus sanglante que la révolution, et les capitalistes, qui, même dans les cas ordinaires, n’ont aucun problème à bâtir leur richesse sur des cadavres, n’ont pas hésité à recourir aux armes quand leur pouvoir fut menacé en Amérique latine.
En 1968, juste avant les Jeux olympiques, le mouvement étudiant en plein essor de Tlatelolco, au Mexique, a manifesté contre la pauvreté et la faim. Les militaires et les paramilitaires ont ouvert le feu sur la manifestation. Lorsqu’il a écrit «Les veines ouvertes de l’Amérique latine», Galeano ne savait pas que les Etats-Unis et la CIA avaient été impliqués dans le massacre de Tlatelolco.
La violence continue d’être présente dans toute l’Amérique latine. Au Mexique, les proches des 43 étudiants disparus il y a 7 ans recherchent toujours leurs corps. À Rio de Janeiro, au Brésil, près de 60 fusillades ayant fait trois morts ou plus ont été signalées en 2021. La majorité de ces fusillades ont eu lieu lors d’interventions policières qui s’apparentent davantage à de pures exécutions.
L’histoire n’est pas terminée. Les veines sont encore ouvertes. Aujourd’hui, le nouvel engouement pour les avocats assèche l’eau potable du Chili, les plantations de quinoa épuisent les sols en Bolivie et l’utilisation intensive de pesticides pour les bananes tue prématurément les travailleurs des plantations au Nicaragua. Pendant ce temps, le poumon du monde, l’Amazonie, est ravagée pour faire place au soja, et ainsi la dévastation continue.
Mais la résistance est bien vivante. Au Brésil, au Paraguay et en Bolivie, les peuples indigènes luttent contre la déforestation et les produits toxiques. Il faudrait rendre compte de 50 autres années d’exploitation, d’impérialisme et de mouvements de lutte, les 50 dernières. Lorsque ce livre a été écrit, le mouvement ouvrier était en plein essor. On était optimiste et on croyait en l’avenir. C’était avant le coup d’Etat d’Augusto Pinochet et l’arrivée au pouvoir des dictatures militaires soutenues par les États-Unis en Amérique du Sud. Le souffle de la gauche est arrivé et est reparti. Des tentatives réformistes visant à abolir, étape par étape, le pouvoir du capital et des propriétaires terriens ont été faites et contrecarrées.
Eduardo Galeano a vécu la chute de la dictature en Uruguay et aussi la victoire de la gauche. Mais il n’a pas vu comment la droite est revenue aux affaires et comment l’État-providence qui a existé pendant une courte période et qui a donné à la classe ouvrière un répit dont elle avait tant besoin est en train de s’effondrer.
Le bras de fer entre la classe supérieure capitaliste et les travailleurs prend constamment de nouvelles formes. Les États-Unis continuent d’utiliser l’Amérique latine comme terrain de jeu, sur lequel intervient également la Chine aujourd’hui. Tout a changé, rien n’a changé. Le livre reste une importante contribution historique à l’histoire coloniale de l’Amérique latine et, aujourd’hui, il aurait besoin d’une suite, voire de deux.
A l’époque de la rédaction de ce livre, l’Union soviétique et un bloc stalinien existaient encore comme contrepoids rival de l’impérialisme américain. Les dictatures militaires en Uruguay, au Chili et en Argentine n’avaient pas encore écrasé le mouvement ouvrier, qui était en plein essor au début des années ‘70. La fleur pourrie du néolibéralisme n’avait pas encore éclos au Chili, ni les énormes manifestations qui ont eu lieu en 2019 en riposte aux politiques néolibérales.
Si ce livre avait été écrit aujourd’hui, les énormes migrations qui ont lieu actuellement d’Amérique latine et des Caraïbes vers les États-Unis auraient eu leur propre chapitre. Un autre chapitre aurait été consacré à la vague de mobilisations féministes pour le droit à l’avortement et contre la violence à l’égard des femmes qui a déferlé sur l’Amérique latine, et qui a également gagné d’autres continents.
Beaucoup de choses se sont passées depuis 1971, mais l’exploitation de la nature et des peuples d’Amérique latine persiste. Tout comme la résistance sociale. Ce n’est que lorsque la classe ouvrière quittera l’arène du parlementarisme et du réformisme et s’unira au-delà des frontières nationales pour renverser les esclavagistes que les veines pourront véritablement conduire le sang au cœur et nourrir toute l’Amérique latine.