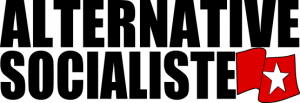Quelque 3000 personnes sont rassemblées le 15 octobre 1970 au centre Paul-Sauvé pour apporter leur appui au FLQ (Photo: René Picard, Archives La Presse)
Lorsque les événements d’octobre 1970 sont abordés, les discours sensationnalistes sur l’action terroriste du FLQ ou le romantisme révolutionnaire cachent souvent la trajectoire radicale que prenait alors la marche de la classe ouvrière. Cet épisode de notre histoire constitue un moment charnière dans l’organisation politique du mouvement ouvrier québécois.
L’année 1970 est un moment où, à travers ses luttes contre l’oppression nationale et l’exploitation capitaliste, toute une couche de travailleurs et de travailleuses prend conscience de son identité de classe. Tout au long des années 1960, la prise de conscience nationale engendre des luttes massives pour la conquête de droits démocratiques. En réaction à la discrimination anti-francophone au travail, un fort appui se développe en faveur du Français comme langue officielle de travail, de la création d’un réseau universitaire public francophone et ultimement pour l’indépendance politique du Québec. Pour un nombre grandissant de personnes de la classe ouvrière, le combat contre l’oppression nationale des Québécois et Québécoises implique la lutte contre le système capitaliste des élites.
Cette radicalisation transforme le mouvement syndical. Elle l’amène à formuler un objectif stratégique fondamental, celui de construire lui-même une force politique capable de représenter et de défendre les intérêts de la classe ouvrière dans son ensemble. En 1968, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ouvre Le deuxième front. Il lance la centrale dans la poursuite d’une société socialiste par l’amélioration des conditions de vie de toute la classe ouvrière. Fer de lance de cette approche, le Conseil central de Montréal (CCSNM)1 décide d’appuyer tous les mouvements «qui veulent la libération des travailleurs contre l’exploitation capitaliste».
L’arbre du FLQ qui cache la forêt
L’action du Front de libération du Québec (FLQ) – qui s’étend de 1963 à 1972 – s’intègre dans le large mouvement de contestation de l’ordre établi des années 1960. Le FLQ recrute spécialement dans la jeunesse intellectuelle, mais aussi chez des syndicalistes. Ses positions politiques connaissent un large appuie dans la population et le mouvement ouvrier. À la fin des années 1960, les centrales syndicales vont même jusqu’à endosser le diagnostic de la société québécoise dressé par le FLQ. En revanche, son action terroriste est presque unanimement dénoncée comme un «cadeau empoisonné».
À la fin de la décennie, le FLQ est le seul pôle politique socialiste et indépendantiste. D’un côté, les nationalistes du Mouvement souveraineté-association, puis du Parti québécois (PQ) fondé en 1968, opèrent dans l’illusion que l’indépendance s’atteindra grâce à l’action parlementaire et aux discussions avec Ottawa. De l’autre, les syndicalistes, les nationalistes et les intellectuels de gauche échouent à mettre sur pied des organisations socialistes hors du mouvement syndical2.
Quant à lui, le FLQ est une succession de petits regroupements ou de réseaux informels sans direction, qui agissent au nom du FLQ. Frange marginale d’activistes, il utilise la violence pour appuyer les ouvriers et les ouvrières en conflit de travail (et en tue d’ailleurs plusieurs). Les enlèvements d’octobre 1970 et la répression massive qui s’en suit marquent un tournant dans la lutte des classes au Québec. Ils servent de prétexte aux autorités afin d’emprisonner le leadership militant du mouvement ouvrier, nationaliste et de gauche en général.
Réaffirmer le pouvoir fédéral
Dans la nuit du 15 au 16 octobre 1970, le gouvernement fédéral de Pierre Eliott Trudeau – sur demande du maire de Montréal Jean Drapeau et du premier ministre du Québec Robert Bourassa – déclare la Loi sur les mesures de guerre. Il s’agit de la vague de répression la plus massive opérée par l’État fédéral depuis la crise de la conscription de 1917.
Prétextant un état «d’insurrection appréhendée»3 et un complot pour renverser Bourassa, Ottawa envoie 7 000 soldats au Québec. Environ 13 000 policiers sont mobilisés. Toutes les libertés publiques sont supprimées. La Sûreté du Québec arrête arbitrairement plus 500 personnes et fait 31 700 perquisitions. Environ 125 syndicalistes sont arrêté·es, dont le président du CCSNM, Michel Chartrand. Au final, 90% des personnes arrêtées sont relâchées sans accusations, souvent après de longs séjours en prison.
Les raisons à l’origine de cette réponse autoritaire sont par la suite complètement déconstruites. La thèse du complot n’a été que pure propagande. Les services secrets de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’ont jamais proposé ni appuyé la Loi sur les mesures de guerre4. En 1975, Bourassa avoue sur les ondes de la chaîne anglophone de Radio-Canada qu’il n’y a jamais eu «d’insurrection appréhendée». À l’automne 1970, tout ce qui reste de la centaine de membres du FLQ se résume à deux cellules isolées composées d’une douzaine d’irréductibles. De plus, les services policiers semblent avoir su qu’ils planifiaient le kidnapping de James Richard Cross (5 octobre) et de Pierre Laporte (10 octobre)5.
Malgré les appels au dialogue lancés notamment par les porte-paroles syndicaux, Trudeau décide de réaffirmer brutalement le pouvoir fédéral au Québec avec la loi martiale du 16 octobre. Il révèle ainsi la position d’un État prêt à tout pour maintenir l’ordre tel qu’il existe.
Le premier Front commun intersyndical
Au cours de la première semaine de la loi martiale, les centrales syndicales (CSN, FTQ6 et CEQ7) organisent une rencontre spectaculaire. Le 21 octobre à Québec se réunissent plus de 500 délégué·es des instances suprêmes des centrales lors du premier Front commun intersyndical. L’instance adopte cinq résolutions. Elles concernent la condamnation du FLQ, le retrait des mesures de guerre, la défense des personnes emprisonnées et l’élaboration d’un programme d’urgence de redressement social, économique et politique.
Ce front commun se distingue des coalitions intersyndicales précédentes par son ampleur et l’aspect politique des intérêts à défendre. Il constituera le principal foyer d’opposition organisé aux mesures de guerre. Il sera le plus redouté.
Le mouvement syndical défend alors la cause des prisonniers politiques en organisant des manifestations et en participant au Mouvement de défense des prisonniers politiques québécois. La frange syndicale la plus militante, en particulier le CCSNM, défend déjà les felquistes victimes de procès politiques depuis l’emprisonnement de Pierre Vallières et Charles Gagnon en 1966. L’implication culmine au début de 1971 lors du procès des Cinq, durant lequel Michel Chartrand est accusé de «conspiration séditieuse».
Les comités d’action politiques intersyndicaux
La contestation du régime capitaliste par le mouvement syndical l’amène à formuler son projet politique. La combativité des syndiqué·es de la base pousse les centrales à se doter de Comités d’action politique (CAP) intersyndicaux. En hiver et au printemps 1970, les CAP participent à des colloques dans 15 régions du Québec. Plus de 2 500 personnes participent aux délibérations et adoptent des positions progressistes.
Le FRAP
En mai, les CAP et des comités citoyens créent le Front d’action politique des salariés à Montréal (FRAP). Ce parti est considéré comme la première étape vers la création d’un parti national. Le FRAP gagne en popularité. La moitié des candidatures proviennent du mouvement syndical. Le CCSNM et son président sont très impliqués, fournissant fonds et locaux au FRAP. Or, les élections du 25 octobre ont lieu sous la loi martiale. Le maire Drapeau et le ministre fédéral Jean Marchand prétendent que le FRAP est un paravent du FLQ. Deux candidats sont emprisonnés. Le parti de Drapeau l’emporte avec une majorité écrasante. Le FRAP récolte néanmoins 15,6% des voix, un résultat jugé décevant. Le FRAP se divise et disparaît en 1974.
Les colloques régionaux des CAP devaient être suivis d’une réunion nationale en automne 1970, qui n’eut jamais lieu. Dans la foulée de la loi martiale, la volonté du Front commun de rédiger un programme d’urgence intersyndical ne se concrétise pas. Néanmoins, la répression contre le mouvement syndical accentue sa radicalisation politique, tant au niveau du discours8 que de l’intensité des luttes9.
De larges pans de la classe ouvrière réalisent la jonction entre la lutte nationale et la lutte des classes. Les grèves s’intensifient et la demande de création d’un parti des travailleurs demeure ardemment débattue dans les congrès syndicaux. Ce n’est pas un hasard si ces conclusions sont tirées au moment où la classe ouvrière est plongée dans de grandes batailles qui lui font découvrir sa puissance politique. Toutefois, l’idée d’un parti basé sur les syndicats recule au fur et à mesure que les directions syndicales défendent une alliance avec le PQ.
Un rendez-vous avec le nationalisme
À l’automne 1970, le FLQ montre l’impuissance de sa stratégie terroriste une bonne fois pour toutes. Sans un enracinement qui lui permet de faire corps avec le mouvement ouvrier, une organisation n’a ni les moyens, ni les forces, ni le nombre pour accomplir un programme révolutionnaire.
De son côté, le mouvement ouvrier prouve dans la pratique que la faiblesse de son organisation politique l’empêche de faire face à la répression de l’État. Présentée comme l’alternative modérée idéale, l‘alliance avec le PQ permet aux directions syndicales d’éviter de construire leur propre parti politique. Elles prétendent alors faussement que le nationalisme péquiste implique une approche pro-ouvrière. Or, la lune de miel avec le PQ est de courte durée. Dès la ronde de négociations de 1982, le gouvernement Lévesque coupe de 20% les salaires des employé·es du secteur public, inaugurant l’ère néolibérale au Québec.
Sortir de l’impasse
Même après des décennies d’attaques, de coupures et d’austérité, le mouvement syndical est toujours dans l’impasse politique d’antan. Jusqu’ici, aucune organisation politique de classe ne se construit dans les luttes populaires et à travers leur coordination. À l’inverse, aucune lutte populaire n’évolue en fonction de la construction d’une telle organisation.
Québec solidaire a bien un potentiel d’être reconverti de la sorte. Mais les liens organiques avec le mouvement syndical ont toujours été presque inexistants. Il semble possible d’en construire, mais à un niveau très local. Du côté syndical, les dernières élections ont démontré que certains grands syndicats sont toujours la force vive des campagnes du PQ au provincial et du Bloc québécois au fédéral.
La crise actuelle du capitalisme mondial offre l’opportunité de retisser les liens entre les problèmes du monde du travail et leurs racines politiques. Seule une organisation politique basée sur le mouvement syndical peut dresser les travailleurs et les travailleuses contre les multinationales et leurs partis. Seule une telle organisation démocratique peut lutter concrètement pour des solutions en mesure de nous sortir de la crise économique et sanitaire actuelle. Seule une telle organisation est en mesure d’orienter la lutte de libération nationale pour ce qu’elle est vraiment, une dimension de la lutte des classes. Aucun raccourci ne peut nous dispenser de la construire.
Notes
- Ancien nom du Conseil central du Montréal métropolitain CSN
- Notamment le Parti socialiste du Québec (PSQ), le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) – tous deux dissouts en 1968 – ainsi que le NDP-Québec
- À la mi-novembre 1969, le ministre de la Justice du Québec, Rémi Paul, soutient que jusqu’à 3 000 terroristes reliés au mouvement communiste international seraient armés de carabines et de dynamite et se tiendraient prêts à l’assaut.
- Voir à ce sujet Secret Service. Political Policing in Canada from the Fenians to Fortress America de Whitaker, Kealey et Parnaby, p.287
- Whitaker, Kealey et Parnaby, p.283
- Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
- Centrale de l’enseignement du Québec, deviendra la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
- Pensons aux manifestes syndicaux anticapitalistes L’État, rouage de notre exploitation (FTQ, 1971), Il n’y a plus d’avenir pour le Québec dans le système économique actuel et Ne comptons que sur nos propres moyens (CSN, 1971), L’École au service de la classe dominante (CEQ, 1972), Écoles et lutte de classes au Québec (CEQ, 1975))
- La grève de La Presse (1971), le Front commun du secteur public (1972 et 1976)
OCTOBRE 70 ET LE
MOUVEMENT OUVRIER
Conférence ZOOM
le 5 nov 2020 à 19h
par Alternative socialiste,
ES UQAM et la collaboration
du CCMM-CSN