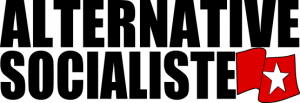En janvier 2014, l’ONG Oxfam publiait un rapport controversé exposant l’incroyable inégalité économique mondiale. Les données révélées étaient ahurissantes. En 2010, les 388 personnes les plus riches au monde détenaient autant que la moitié la plus pauvre de l’Humanité, soit autant que 3,5 milliards de personnes. En 2014, seuls 85 super riches suffisaient. Un an plus tard, Oxfam a livré un nouveau rapport actualisé. La croissance de la fortune des riches augmente si rapidement que, désormais, 80 personnes détiennent autant de richesses que la moitié de la population mondiale. Pour les très riches, la crise semble n’être rien de plus qu’une perverse course à l’élimination pour appartenir à cette couche infime au sommet de la société.
De vastes inégalités
Dans son rapport de janvier 2015, basé notamment sur les données du Credit Suisse, Oxfam dévoile qu’en 2014, les 1% les plus riches détenaient 48% de la fortune mondiale. Les 99% de la population restante devraient donc se partager les 52% restants mais, là aussi, la richesse est très inégalement répartie puisque les 80% les plus pauvres de l’Humanité doivent se débrouiller avec seulement 5,5% de la richesse mondiale. Une concentration étourdissante de richesse fait face à la misère la plus noire.
Et encore ce constat est-il très certainement une lourde sous-estimation. Récemment, L’Institut allemand pour la recherche économique (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW) a découvert que la majeure partie de la richesse des 0,1% des Allemand·e·s les plus riches avait été mésestimée en raison d’erreurs statistiques. Ce 0,1% ne possède pas 3.000 milliards d’euros mais bien… 9.300 milliards! Plus de trois fois plus! Et des montagnes de milliards se planquent encore dans les paradis fiscaux. Les riches font tout pour éviter de montrer au grand jour l’étendue de leurs possessions.
Des ONG telles qu’Oxfam ne sont pas les seules à se préoccuper de cette évolution. De larges sections de la population sont proprement scandalisées au vu des inégalités croissantes et des économistes comme Pikketty éditent des livres très populaires consacrés au sujet. L’élite capitaliste est gagnée d’inquiétude. Même Warren Buffet, une des plus grosses fortunes mondiales, critique sévèrement l’ampleur des inégalités. Lors du dernier Forum économique mondial de Davos, en Suisse, la thématique était bien plus centrale qu’auparavant. Ce n’est en rien une soudaine prise de conscience morale, mais plutôt la compréhension que ces inégalités commencent à représenter une sérieuse menace pour leur position dominante. Les révolutions au Moyen-Orient et Afrique du Nord ne sont pas survenues par hasard, elles étaient la conséquence du refus d’une situation où une couche sans cesse plus large de la population se voit plongée dans la misère.
Rien de nouveau sous le soleil
On pourrait avoir l’impression que ces inégalités constituent un phénomène neuf. Ce n’est pas le cas. La répartition inégale des richesses est le fil rouge de l’histoire du capitalisme. A l’exception de quelques rares périodes historiques, ces inégalités n’ont d’ailleurs fait que s’accroître.
Au 19e siècle, en pleine révolution industrielle, le contraste était évident. Dans les nouvelles fabriques qui se répandaient rapidement, des biens étaient produits à un rythme inédit, ce qui détonnait grandement avec la misère presque sans précédent des travailleurs·euses qui y étaient exploité·e·s. La situation n’a commencé à s’améliorer que lorsque ceux/celles-ci se sont organisé·e·s en syndicats et en partis.
Les socialistes de l’époque ont tenté de trouver une explication. La plupart en sont resté·e·s au stade de demi-théories ou d’illusions totales. Certain·e·s ont été plus loin que d’autres, mais il a fallu attendre l’arrivée de Marx et de son analyse pour disposer d’une théorie véritablement scientifique. Le/la lecteur·trice actuel·le du ‘‘Capital’’ de Marx remarque bien vite qu’il est toujours bel et bien d’actualité en dépit du fait qu’il date du 19e siècle.
La base : la théorie de la plus-value
Marx explique au début du ‘‘Capital’’ que la plupart des biens produits sous le capitalisme sont destinés au marché. Cela semble évident aujourd’hui, mais au cours de la majeure partie de l’Histoire, la production n’était pas destinée à être vendue mais à être consommée. Les produits spécialement destinés à la commercialisation sont appelés par Marx des marchandises. Selon lui, elles avaient un certain nombre de caractéristiques notables.
Une première caractéristique est qu’elles ont visiblement deux types de valeurs différentes. Il y a tout d’abord la valeur d’usage, c’est-à-dire qu’elles doivent correspondre à un besoin donné (ce qui est logique, des objets insignifiants peuvent difficilement être vendus). Mais elles doivent être échangées en diverses proportions avec d’autres. Elles ont donc une valeur d’échange, ou tout simplement une valeur. Mais qu’est ce qui définit véritablement la valeur d’une marchandise?
Il existe presque autant de réponses sur ce point qu’il existe de tendances économiques. Pour certains, il s’agit simplement de l’effet de l’offre et de la demande. Pour d’autres, différents facteurs de production sont cruciaux comme le capital, le travail, l’environnement,… La conclusion de Marx est qu’en dernière instance, la valeur est déterminée par le travail humain, plus précisément par le temps de travail nécessaire dépensé dans un bien. Ce que tous les produits ont en commun, c’est d’être en dernière instance le fruit du travail de l’humain.
Marx ne réduisait cependant pas tout à ça. Dans le cas contraire, on pourrait rapidement déboucher sur des conclusions absurdes. Quelqu’un qui effectue très lentement un travail inefficace ne produit pas plus de valeur que son homologue très productif·ve et rapide et ne demande donc pas de prix considérablement plus élevés.
Marx n’entendait pas par là le travail individuel effectivement dépensé par un·e producteur·trice donné·e à la production d’une marchandise donnée, mais la quantité de travail nécessaire en moyenne pour produire cette marchandise, à un niveau donné de développement des forces productives. De nouvelles machines productives qui raccourcissent le temps de travail diminuent la valeur. Même ainsi, la valeur peut augmenter parce que, par exemple, une matière première est rare et exige donc plus de travail pour la développer. La main-d’œuvre qualifiée crée aussi une plus grande valeur que la main-d’œuvre non-qualifiée.
Pour Marx, prix et valeur sont deux choses différentes, mais pas indépendante l’une de l’autre. Le prix est ce qu’il définissait sous le terme ‘‘d’expression monétaire de la valeur d’une marchandise’’. Il s’agit donc de la valeur traduite en masse monétaire. On assume communément que le prix et la valeur d’un bien sont égaux, mais ce n’est pas le cas. Les fluctuations de l’offre et de la demande ont pour conséquence que le prix est parfois au-dessus de la valeur d’une marchandise, parfois en-dessous. La spéculation peut aussi très fortement faire varier un prix.
Il suffit de penser à la manière dont le prix du baril de pétrole a chuté ces derniers mois pour ensuite regrimper relativement vite. Pareille fluctuation ne peut être expliquée par un changement de la valeur d’un baril de pétrole (sa production n’est soudainement pas devenue plus efficiente) et pas non plus par une modification de l’offre et de la demande. Ces données sont demeurées relativement stables. La véritable raison de cette variation réside dans la spéculation. La demande spéculative de pétrole est 20 fois plus grande que la demande physique. Les spéculateurs·trices ont un effet énormément perturbateur sur le prix réel.
Dans un marché où aucune entreprise n’exerce de monopole, à long terme, le prix moyen correspondra à la valeur.
Travail, force de travail et exploitation
‘‘Mais qu’est-ce que tout ça peut donc bien avoir à faire avec les inégalités ?’’ pouvez-vous penser. Là réside la première véritable innovation de Marx dans la théorie économique. La théorie de la valeur-travail n’est pas sa découverte, mais un énorme problème restait à régler. Cela n’expliquait pas fermement d’où provenaient les profits des capitalistes.
Le raisonnement est le suivant: un·e travailleur·euse au service d’un·e employeur·euse est payé·e pour le travail qu’il produit, il reçoit un salaire. Selon la théorie de la valeur-travail, le salaire doit être égal au travail fourni. Mais si l’employeur·euse doit vendre le produit qu’il/elle a en mains à sa valeur, il/elle ne lui est pas possible de réaliser un profit. On pourrait affirmer qu’il/elle vend ce produit au-dessus de sa valeur (c’est d’ailleurs ce qui se passe parfois dans la réalité), mais cela suggère implicitement que la théorie de la valeur-travail n’est pas véritablement applicable. Les prix seraient à la merci de l’arbitraire de l’employeur·euse.
Selon Marx, le problème n’était pas issu de théorie de la valeur-travail en elle-même, mais de l’idée que l’échange entre employé·e et employeur·euse était un échange égal. Même si cet échange a toutes les apparences de l’être, ce n’est absolument pas le cas. Marx expliquait qu’un·e travailleur·euse ne vend pas son travail, mais sa force de travail, c’est-à-dire sa capacité à exécuter un travail et non pas sa production concrète de biens dans une entreprise. C’est le capitaliste qui s’approprie cette dernière.
Les marxistes appellent ‘‘plus-value’’ la différence entre la valeur de la force de travail (ou le salaire) et le travail sous forme de produits bénéficiant aux capitalistes. Cela constitue la base du profit du capitaliste. En réalité, le profit ne correspond pas à la plus-value. Une partie est en fait utilisée pour le marketing, la comptabilité,… Pour plus de commodité, nous partons du principe que c’est ainsi. Le rapport entre la plus-value et le salaire est le taux d’exploitation. Au plus la plus-value est grande relativement au salaire, au plus est élevé le taux d’exploitation.
L’exploitation s’accentue
La lutte pour la plus-value est à la base de la lutte entre les classes sociales. Le capitaliste veut rendre la plus-value aussi grande que possible. Il/elle veut donc accroître le degré d’exploitation. Les travailleurs·euses, en revanche, veulent que la plus-value reste aussi réduite que possible. Ces deux groupes ont des intérêts fondamentalement opposés.
On peut accroître la plus-value de plusieurs manières différentes. La plus évidente est d’allonger la journée de travail et de geler voire de diminuer le salaire. De telles mesures sont des attaques ouvertes contre le niveau de vie des travailleurs·euses, elles se heurtent généralement à une vive opposition. C’est pourquoi la classe dirigeante et ses représentant·e·s agissent souvent de manière sournoise.
Elle s’en prend ainsi régulièrement au salaire socialisé, c’est-à-dire la part de nos salaires servant à payer nos pensions, les allocations de chômage, les soins de santé,… au travers de la sécurité sociale. Concrètement, cela se traduit par des allocations réduites, des soins de santé plus chers, le relèvement de l’âge de la pension et ainsi de suite. L’establishment capitaliste veut nous convaincre qu’économiser sur notre salaire socialisé vise à protéger la partie individualisée de notre salaire, mais la vérité est que la classe bourgeoise empoche de cette façon plus de plus-value en accentuant le degré d’exploitation. Parallèlement, de telles mesures entraînent une pression à la baisse sur les conditions de salaire et de travail de tous, des allocations plus faibles et moins de protection sociale nous obligeant, entre autres, à accepter n’importe quelles conditions.
La productivité des travailleurs·euses est simultanément augmentée. L’entreprise spécialisée en ‘‘gestion des ressources humaines’’ Securex a réalisé une étude dont il ressort que 64% des travailleurs·euses subissent un stress excessif au travail, une augmentation de 18,5% par rapport à 2010. L’étude montrait que presque 80% des employeurs·euses ont reconnu que l’augmentation du nombre d’épuisements professionnels est due à une augmentation de la pression au travail (1). Au cours de la dernière moitié du 20e siècle, la productivité des travailleurs·euses belges a augmenté de 650 %. Le nombre d’heures de travail annuellement prestées a diminué et les salaires bruts ont augmenté de 250%. Mais pour recevoir à la fin de cette période une part de la valeur produite égale à celle perçue au début, les salaires bruts réels auraient dû augmenter de 433% !
Le néolibéralisme met fin à l’État providence
Le salaire ou la valeur de la force de travail est, tout comme les autres biens, égal au temps de travail nécessaire pour produire ces biens. Autrement dit, le salaire est égal à la valeur des produits nécessaires à maintenir en vie un·e travailleur·euse et sa famille. Certain·e·s ont fait le postulat que cela signifiait que Marx défendait la ‘‘loi d’airain des salaires’’, qui implique que le salaire ne grimperait jamais au-dessus du minimum d’existence absolu et que les travailleurs·euses seraient donc voué·e·s à une vie de famine sous le capitalisme. Il n’en est toutefois rien. C’est principalement le rapport de force entre travail et capital qui est déterminant pour déterminer le niveau de vie des travailleurs·euses et de leurs familles.
Selon Marx, il existe bel et bien une tendance sous le capitalisme à créer une couche toujours plus large qui soit complètement ou partiellement exclue. Ce groupe a de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts et mène une existence précaire. C’est ce qu’il appelle le ‘‘lumpenprolétariat’’ (‘‘prolétariat en haillons’’ ou sous-prolétariat).
Dans les pays capitalistes développés, cette tendance semblait appartenir au passé étant donné la croissance des années 1950, 1960 et 1970. Cette croissance inédite s’est développée sur les cendres des ravages de la Deuxième Guerre mondiale. La période était aussi marquée par un rapport de forces favorable aux travailleurs·euses en raison de leurs organisations puissantes et de l’existence du bloc de l’Est qui alors, et malgré ses limites, exerçait un pouvoir d’attraction sur les travailleurs·euses et était sorti renforcé du conflit mondial. Les salaires ont fortement augmenté et l’État-providence a été bâti. Il s’agit de l’une des rares périodes de l’Histoire au cours de laquelle les inégalités ont diminué dans ces pays.
Mais depuis l’émergence du néolibéralisme dans la seconde moitié des années ’70 s’est développée une plus large couche marginalisée parmi la population, à un rythme différent selon le pays. Le processus a connu une nouvelle accélération profonde avec la nouvelle crise économique de 2008. Aujourd’hui, nous n’utilisons plus le terme de sous-prolétariat. Nous parlons de travailleurs·euses pauvres, ceux/celles qui sont coincé·e·s dans des emplois intérimaires précaires et mal payés ou qui sont tout simplement touchés par le chômage et doivent vivre d’une allocation sous le seuil de pauvreté. C’est ce groupe de la population qui est le plus directement touché par l’austérité. Dans des pays comme la Grèce, l’Espagne et le Portugal, cette couche a connu une croissance explosive en un temps record.
Concurrence et monopole
Les inégalités ont constitué un des thèmes centraux à l’origine du mouvement de protestation Occupy aux USA, illustrée par le slogan des ‘‘99% contre le 1%’’. Il ressort cependant de rapports comme ceux d’Oxfam que, même au sein de ce groupe, la richesse est très inéquitablement répartie et concentrée dans une très petite fraction. Cette énorme concentration des richesses découle de la logique interne du capitalisme.
Qui dit capitalisme dit concurrence. Le fait que les capitalistes rivalisent directement entre eux/elles crée une pression supplémentaire pour accroître le degré d’exploitation. Mais cela a aussi pour effet que le capitalisme soit un système très dynamique avec renouvellement technologique et augmentation de la productivité. Paradoxalement, cela entraîne aussi sa contradiction. Les nouvelles technologies et nouvelles machines exigent toujours plus d’investissements de capitaux. Les petites entreprises sont absorbées par les grandes. Un secteur constitué d’une multitude de petites entreprises est, à terme, dominé par quelques grandes entreprises qui dominent le marché. Il est ici question de concentration et de centralisation du capital. Presque tous les secteurs sont aujourd’hui dominés par une poignée de multinationales.
Cela ne signifie pas pour autant la fin de la concurrence ou que le capitalisme arrive en eaux moins turbulentes, au contraire. Les contradictions inhérentes et la concurrence prennent seulement de nouvelles dimensions. Les multinationales sont en concurrence au niveau mondial de toutes sortes de manières.
Avec l’arrivée de nouvelles techniques et de nouveaux produits, d’anciens secteurs et monopoles disparaissent et d’autres naissent. La production devient plus rapide au point de dépasser ce que les consommateurs·trices peuvent absorber. La capacité de surproduction augmente, ce qui renforce auprès des capitalistes la recherche d’autres méthodes destinées à arracher des bénéfices rapides, entre autres via la spéculation et l’entretien de bulles financières.
De par leur énorme poids économique, cette concentration de capital mène à la poursuite de la concentration des richesses. Les multinationales peuvent imposer des prix plus bas à leurs fournisseurs·euses et faire payer des prix plus élevés aux consommateurs·trices. De plus, elles ne paient qu’à peine des impôts grâce à leur travail de lobbying et aux technologies fiscales de pointe. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’il ne s’agit pas d’une irrégularité du capitalisme, cela est fondamentalement inhérent au système.
Quelle alternative ?
Les énormes inégalités suscitent indignation et révolte. De larges couches de la population estiment qu’il faut faire quelque chose. Un impôt sur la fortune, par exemple, pourrait être une réponse. Mais ceux/celles qui touchent aux intérêts des super riches et à leurs entreprises sont vite confronté·e·s au chantage sous la forme de la fuite des capitaux, des menaces de délocalisations, etc.
Ce n’est guère étonnant. L’inégalité est inhérente au capitalisme. Ce n’est pas une erreur du système, mais c’est le système qui est une erreur. Finalement, les intérêts d’une infime élite seront toujours centraux dans ce système grâce au fait qu’elle détient les secteurs clés de l’économie et le pouvoir politique qui va de pair.
Répondre à cela nécessite de sortir des limites de la société actuelle. Ce n’est qu’en organisant l’économie dans l’intérêt de la majorité de la population et sous son contrôle démocratique que la production pourra être démocratiquement planifiée et ainsi permettre d’offrir à chacun·e un niveau de vie décent. Les inégalités toucheront dès lors à leur fin.
Mathias, Parti Socialiste de Lutte