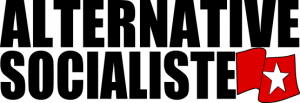Ce n’est ni par un compromis avec les classes possédantes ou les divers chefs politiques, ni en se conciliant l’ancien appareil gouvernemental que les bolcheviks avaient conquis le pouvoir. Ce n’est pas non plus par la violence organisée d’une petite clique. Si, dans toute la Russie, les masses n’avaient pas été prêtes pour l’insurrection, elle aurait échoué. La seule raison du succès des bolcheviks, c’est qu’ils réalisaient les vastes et élémentaires aspirations des couches les plus profondes du peuple, les appelant à l’oeuvre de destruction du passé et coopérant avec elles pour édifier sur ses ruines encore fumantes un monde nouveau…
John Reed, 10 jours qui ébranlèrent le monde, 1919.
Cette année, nous commémorons le 100e anniversaire de la Révolution russe de 1917. Bien trop souvent, cet événement est présenté comme une «aberration de l’histoire » ou comme le résultat des sinistres desseins d’une poignée d’hommes malfaisants. Nous voulons au contraire profiter de l’occasion pour réaffirmer la légitimité historique et la portée gigantesque de ce qui fut la première révolution socialiste de l’histoire.
Le développement inégal et combiné
Dans son livre La révolution permanente, Trotsky dira de la Révolution d’octobre qu’elle fut « la plus grandiose de toutes les manifestations de l’inégalité de l’évolution historique. » Au début du siècle dernier en effet, la Russie présente une situation historique pleine de contradictions. Réduit à un état semi-barbare, le pays est sous le joug d’un régime tsariste autocratique, tandis que l’immense majorité de la population ( 87%) vit dans les campagnes, le plus souvent dans un état de misère et d’arriération lamentable. Le sous-développement culturel est latent : l’analphabétisme atteint un niveau supérieur à celui existant en France au 18e siècle avant la révolution ! Les tentatives de moderniser les structures de la vie nationale se heurtent aux lourdes survivances du féodalisme, à la faiblesse de la bourgeoisie nationale, au système archaïque de gouvernement et à la dépendance économique de la Russie à l’égard du capital étranger. Ce sont pourtant ces investissements de capitaux étrangers qui permettent, dans le dernier quart du 19e siècle, un développement capitaliste accéléré et la formation de centres industriels importants. L’arriération du pays contraste dès lors avec l’apparition rapide d’un prolétariat moderne concentré dans de grosses entreprises, et dont la combativité n’a rien à envier au mouvement ouvrier occidental. Rien qu’entre 1865 et 1890, le nombre d’ouvriers d’usine double, passant de 700.000 à 1.430.000. À la veille de la révolution de 1917, ils sont 4,5 millions. Rosa Luxembourg, révolutionnaire allemande, en déduit : « La situation contradictoire de la Russie se manifeste par le fait que le conflit entre la société bourgeoise et l’absolutisme est déjà surpassé par le conflit entre le prolétariat et la société bourgeoise. » (1)
1905 : la répétition générale
En 1905, la Russie est traversée par une première onde de choc révolutionnaire. L’année débute par une grève à l’usine Poutilov à Saint-Pétersbourg, qui, rapidement, s’élargit. L’épisode du Dimanche Rouge, lorsque des milliers de travailleurs et leurs familles se rendant vers le Palais d’Hiver du Tsar pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail et davantage de libertés publiques se font accueillir à coups de fusil, de sabres et de baïonnettes, au prix de centaines de morts, a pour effet de dissiper la confiance obscure de centaines de milliers de travailleurs dans le Tsar, et enflamme le pays par une vague de grèves. Celle-ci atteint son apogée par la grève de masse du mois d’octobre, qui voit la constitution des premiers Soviets (conseils des députés ouvriers), véritables embryons d’un gouvernement ouvrier révolutionnaire. Mais le pouvoir d’État tsariste a finalement raison de ce déferlement révolutionnaire, qui, insuffisamment préparé et réduit à ses seules ressources, reflue à partir de décembre. Trotsky conclut : « Cet épisode n’a pas seulement montré que la Russie des villes était une base trop étroite pour la lutte, mais aussi que, dans les limites de la révolution urbaine, une organisation locale ne peut assumer la direction du prolétariat. La lutte du prolétariat au nom de tâches nationales exigeait une organisation de classe d’envergure nationale. » (2) Si la défaite de cette première révolution ouvre une ère de répression féroce qui pousse le mouvement ouvrier dans le repli pour plusieurs années, cette expérience révèle néanmoins pour la première fois le prolétariat comme une force avec laquelle il va falloir compter, et restera ancrée dans la conscience collective des travailleurs russes.
Trois conceptions de la révolution
Le caractère de la révolution en gestation fut l’objet d’âpres divergences au sein du mouvement ouvrier russe. Dès 1904, ces divergences aboutissent à la formation de deux tendances fondamentales : le menchevisme et le bolchevisme.
Pour les menchéviks, la Russie devait passer par une révolution démocratique portant au pouvoir la bourgeoisie, laquelle développerait le capitalisme et instaurerait un régime parlementaire. Le rôle du parti ouvrier devait donc se limiter à « donner plus de vaillance à la bourgeoisie libérale » (3) pour l’aider à s’engager dans cette voie. « Les conditions historiques objectives font que la destinée de notre prolétariat est irrémissiblement de collaborer avec la bourgeoisie dans sa lutte contre l’ennemi commun » (4) , résumait le dirigeant menchévik Axelrod. La lutte pour le socialisme était ainsi renvoyée à un avenir indéfini, le contenu de la révolution étant d’avance limité à des transformations acceptables pour la bourgeoisie libérale. Cette perspective partait davantage d’une transcription mécanique, sur le sol de la Russie, du schéma suivi par la Révolution française de 1789 que d’une analyse réelle des conditions sociales et politiques existant en Russie à cette époque.
Jusqu’à un certain point, les bolcheviks admettaient également que la révolution aurait un caractère bourgeois. Lénine expliquait : « Nous ne pouvons sauter par-dessus le cadre démocratique bourgeois de la Révolution russe… Pour le prolétariat, la lutte pour la liberté politique et pour la république démocratique au sein de la société bourgeoise est simplement un stade nécessaire dans sa lutte pour la révolution socialiste. » (5). La vision des bolcheviks se distinguait cependant de celle des menchéviks sur deux points : d’une part, ils ne renvoyaient pas la révolution socialiste aux calendes grecques, mais voyaient au contraire la révolution bourgeoise comme un « stade nécessaire » vers la réalisation de ce but ; d’autre part, ils ne portaient aucune illusion quant à la capacité de la bourgeoisie russe à diriger jusqu’au bout sa propre révolution. L’existence de fait d’un prolétariat moderne contestant l’ordre capitaliste, ainsi que les attaches existant entre l’aristocratie foncière et la bourgeoisie, rendaient cette dernière incapable, selon les bolcheviks, d’entreprendre la moindre initiative sérieuse vers la conquête des droits politiques des travailleurs et la réalisation d’une véritable réforme agraire. L’évolution des rapports de forces pousserait tout au contraire la bourgeoisie vers un compromis avec l’absolutisme. C’est pourquoi, à la position des menchéviks préconisant une alliance entre le prolétariat et la bourgeoisie, les bolcheviks opposaient l’idée d’une alliance entre le prolétariat et la paysannerie. Cette position était résumée dans la formule de Lénine : « la dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie. »
Léon Trotsky, quant à lui, n’adhérait à l’époque ni à l’une ni à l’autre de ces conceptions. Tirant le bilan de l’expérience de 1905, il élaborera dans sa brochure Bilan et perspectives, une analyse clairvoyante qui se verra brillamment confirmée par le développement ultérieur des événements révolutionnaires en Russie, analyse par la suite connue sous le nom de révolution permanente. D’accord avec les bolcheviks sur l’analyse qu’ils font du rôle du libéralisme bourgeois, Trotsky cernait néanmoins les faiblesses de la formule de Lénine. Il soulignait d’une part l’incapacité historique pour la paysannerie, de par son morcellement géographique et social, de jouer un rôle politique indépendant ; la passivité des villages et l’inertie des éléments paysans dans l’armée fut en effet une des raisons principales de l’écrasement de la révolution de 1905. D’autre part, il insistait sur l’impossibilité objective pour le prolétariat de se maintenir dans le cadre d’un programme démocratique bourgeois : « Il serait du plus grand utopisme de penser que le prolétariat, après avoir accédé à la domination politique puisse borner sa mission à créer les conditions démocratiques et républicaines de la domination sociale de la bourgeoisie. » Une fois au pouvoir, la classe ouvrière serait irrésistiblement poussée à entreprendre ses propres tâches, à savoir l’expropriation des capitalistes et la socialisation de l’économie. «La perspective des bolcheviks était incomplète; elle indiquait correctement la direction générale de la lutte, mais caractérisait incorrectement ses stades…La victoire complète de la révolution démocratique en Russie est inconcevable autrement que sous la forme d’une dictature du prolétariat appuyée sur la paysannerie. La dictature du prolétariat mettra inévitablement à l’ordre du jour, non seulement des tâches démocratiques, mais aussi des tâches socialistes, et va en même temps donner une puissante impulsion à la révolution socialiste internationale. » (6)
La guerre mondiale : la trahison historique de la social-démocratie
En août 1914, la nécessité latente pour les États impérialistes d’engager un nouveau partage des marchés et des colonies éclate en une puissante conflagration mondiale. Les belles résolutions contre la guerre de l’Internationale socialiste sont d’un seul coup rangées au placard : presque tous les partis sociaux-démocrates capitulent devant la guerre, en s’alignant sur leurs gouvernements respectifs et leurs discours bellicistes. Le 4 août, le groupe parlementaire social-démocrate allemand, unanime, vote les crédits de guerre. Les députés socialistes français les imitent avec enthousiasme. Lorsqu’en Belgique, le roi Albert se présente devant les Chambres et que le gouvernement catholique demande le vote de crédits militaires, les députés socialistes du POB applaudissent le souverain et, à leur tour, se rallient à l’union sacrée en votant les crédits de guerre. Émile Vandervelde, alors président de l’Internationale, part, sur la demande du roi, haranguer les troupes sur le front de l’Yser. Celui que l’on considérait comme « le père du marxisme russe », Plékhanov, comme la majorité des mencheviques, se rallie au discours de « la guerre jusqu’à la victoire ». De tous les partis sociaux-démocrates de l’époque, les bolcheviques seront les seuls à rejeter l’effort de guerre de façon radicale et conséquente. Rosa Luxembourg qualifie l’Internationale de « cadavre puant » (7). Lénine affirme : « Dès aujourd’hui, je cesse d’être social-démocrate et deviens communiste. » (8)
Si, dans un premier temps, la vague de chauvinisme entraîne tout sur son passage et terrasse des millions de travailleurs, la guerre deviendra par la suite un puissant catalyseur de la colère ouvrière, qui se répandra comme une tempête sur tout le continent. La combativité des masses, enfouie sous la boue et le sang des tranchées, remontera à la surface avec d’autant plus de vigueur. « La première vague des événements a élevé les gouvernements et l’armée à une puissance jamais encore atteinte. D’autant plus effrayante sera la chute des dirigeants, quand le sens réel des événements se révélera dans toute son horreur », commentait Trotsky dans La guerre et l’Internationale.
Février 1917 : l’explosion
Un peu partout, la prolongation du massacre impérialiste excite les sentiments de révolte. La discipline se relâche parmi les troupes, le mécontentement gronde dans les quartiers ouvriers. En Russie, la crise éclate en février 1917 : le 23 de ce mois, à l’occasion de la journée internationale des femmes, des ouvrières du textile de Saint-Pétersbourg débrayent et défilent dans des manifestations de masse en criant : « Du pain ! Du pain ! » Cet événement met le feu aux poudres ; le lendemain, la moitié du prolétariat de la capitale -200.000 ouvriers- a cessé le travail. Le 25, la grève devient générale.
Rapidement, le conflit prend un caractère insurrectionnel ;les mutineries des soldats, entraînées par la marée révolutionnaire, sonnent le glas du régime impérial. Ce dernier, incapable de faire obstacle au soulèvement des masses, ne pouvant s’appuyer sur des troupes sûres, vole en miettes. Le 27 au soir se tient la séance constitutive du Soviet des députés ouvriers et soldats de Petrograd. Le 2 mars, le Tsar Nicolas II, lâché par ses alliés de la veille, abdique. Le même jour les députés de l’opposition libérale constituent à la hâte un gouvernement provisoire présidé par le prince Lvov, grand propriétaire terrien : les classes possédantes, paniquées, cherchent à rebâtir un appareil d’État capable d’endiguer la révolution des masses ouvrières. L’Église orthodoxe, pourtant vieille complice du tsarisme, voit dans la chute du régime « la volonté de Dieu » et invite les fidèles à « soutenir le gouvernement provisoire » (9). Loin d’être un aboutissement, la révolution de février ne marque pourtant que le début d’un processus de révolution et de contre-révolution qui verra se défier sur l’arène politique deux prétendants à la direction de la société.
Les soviets : organes de pouvoir d’un type nouveau
La révolution a fait naître une dualité de pouvoir : à côté du gouvernement provisoire bourgeois s’érige et se développe un autre type de pouvoir : les Soviets des députés ouvriers, élus dans les usines et les quartiers ouvriers. « La dualité de pouvoirs se manifeste là où des classes ennemies s’appuient déjà sur des organisations d’État fondamentalement incompatibles – l’une périmée, l’autre se formant – qui, à chaque pas, se repoussent entre elles dans le domaine de la direction du pays (…) Par sa nature même, une telle situation ne peut être stable… » (10) En effet, une société ne peut pas plus avancer sous la houlette de deux pouvoirs opposés qu’un train ne peut avancer s’il est guidé par deux conducteurs voulant chacun aller dans des directions opposées !
Dès le début mars, des soviets surgissent dans toutes les principales villes et les centres industriels du pays ; la révolution commence à gagner les campagnes, tandis que les soviets de soldats se multiplient dans l’armée pour contester le diktat des officiers. Lénine affirme très justement : « Les parlements bourgeois ne sont jamais considérés par les pauvres comme des institutions à eux. Tandis que, pour la masse des ouvriers et des paysans, les soviets sont à eux et bien à eux. » (11). Ces soviets, organes d’auto-organisation des masses opprimées, véritables parlements ouvriers, reprennent en main la gestion de tâches normalement dévolues à l’appareil d’État officiel (ravitaillement, ordre public, armement des travailleurs…) et contribuent à engager les larges masses de la population laborieuse dans le débat et l’action politique, loin des basses manoeuvres et des intrigues des bourgeois. Pourtant, et c’est là ce que Trostky appelle le « paradoxe de février », les soviets sont initialement composés d’une majorité de délégués des partis menchéviks et socialiste-révolutionnaire, qui n’ont pas la moindre intention de renverser le gouvernement provisoire, appuient la poursuite des hostilités sur le front, et s’évertuent à freiner les revendications sociales. « Non seulement dans les soviets de soldats, mais également dans les soviets ouvriers, les bolcheviks disposaient généralement de1-2%, au mieux 5%. Les menchéviks et les prétendus «socialistes-révolutionnaires» s’assuraient le soutien de 95% des travailleurs, des soldats et des paysans engagés dans la lutte ». (12)
Les thèses d’avril : la révolution permanente en pratique
Dictée par leur ancienne analyse des tâches de la révolution, l’attitude initiale de la direction nationale du parti bolchevik, en ces premiers mois de révolution, est sujette à maintes hésitations et confusions. Staline et Kaménev, à la tête du parti en l’absence de Lénine exilé en Suisse, adoptent une position de soutien critique au gouvernement provisoire et de rapprochement avec les menchéviks. La conférence bolchevique qui se tient à la fin du mois de mars décide par exemple, sous proposition de Staline, que le rôle des soviets est de « soutenir le gouvernement provisoire dans son action aussi longtemps qu’il marche dans la voie de satisfaire la classe ouvrière. » (13). Fort heureusement, le retour de Lénine, le 3 avril, va retourner la situation dans les rangs bolcheviques. S’adaptant à la nouvelle réalité au lieu de s’accrocher aux vieilles formules, il rejoint implicitement la perspective avancée par Trostky : « La formule inspirée du vieux bolchévisme, comme quoi la révolution démocratique bourgeoise n’est pas terminée, a vieilli : elle n’est plus bonne à rien (…) Le trait distinctif de la situation actuelle en Russie consiste en la transition de la première étape de la révolution, qui remit le pouvoir à la bourgeoisie à cause de l’insuffisance de la conscience et de l’organisation prolétariennes, à sa seconde étape, qui remettra le pouvoir aux mains du prolétariat et des couches les plus pauvres de la paysannerie. » (14). Lénine formula sa position dans les Thèses d’Avril, véritable réquisitoire contre le gouvernement provisoire et plaidoyer en faveur du pouvoir des Soviets « seul pouvoir révolutionnaire viable » (15). Par un travail patient et tenace, soutenu par la radicalisation du mouvement révolutionnaire, il parvient à ressaisir le parti. Trotsky, quant à lui, ralliera formellement les bolcheviks au mois d’août
Les journées de juillet
Les 3 et 4 juillet s’opère un tournant décisif : les ouvriers et soldats de Petrograd manifestent leur impatience en exigeant des dirigeants du soviet qu’ils prennent le pouvoir. Les bolcheviks s’opposent à une insurrection, qu’ils estiment prématurée et suicidaire : la capitale est en avance sur le reste du pays, et les larges couches de travailleurs et de paysans ne sont pas encore prêtes à soutenir activement le renversement du gouvernement provisoire. Ce n’est pas parce que l’avant-garde est gagnée au programme révolutionnaire que la situation est déjà mûre pour la prise du pouvoir. N’ayant pas réussi à contenir le mouvement, les bolcheviks ne tournent pas le dos aux travailleurs déterminés à descendre dans la rue : ils descendent avec eux tout en leur expliquant le caractère aventuriste de l’opération. Karl Radek expliquera par la suite : « En juillet 1917, nous avons de toutes nos forces retenu les masses, et, comme nous n’y avons pas réussi, nous les avons conduites au prix d’efforts inouïs, vers la retraite, hors d’une bataille sans espoir. » (16) Les désordres qui s’ensuivent font des centaines de victimes, et une vague de répression s’abat sur le parti bolchevik.
Le putsch de Kornilov
Le reflux de juillet semble rétablir un certain équilibre entre les classes antagonistes. La polarisation des classes est à son comble, et la base sociale du gouvernement provisoire, emmené par Kérenski, s’évapore sous ses pieds. Le dirigeant Mililoukov, du parti cadet (le parti de la bourgeoisie) affirme : « La vie poussera la société et la population à envisager l’inéluctabilité d’une opération chirurgicale ». Il ajoute : « le pays n’a le choix qu’entre Kornilov et Lénine » (17).
Les classes possédantes, en effet, face à l’apathie du gouvernement provisoire et des partis conciliateurs, sentent venu le moment de frapper à la tête le mouvement révolutionnaire : c’est le généralissime ultra-réactionnaire Kornilov qui est choisi comme sauveur suprême, l’objectif étant d’organiser une marche punitive vers Petrograd afin d’écraser la révolution dans le sang…mais le coup d’état s’effondre en quelques jours. Face à l’incapacité du gouvernement provisoire à organiser la résistance, les bolcheviks prennent en main la défense de la capitale. En définitive, même les soldats des troupes de Kornilov se mutinent contre leurs officiers et se rallient à la cause de la révolution : le complot se décompose sans combat. Fouettées par la tentative de la contre-révolution, les masses se radicalisent davantage encore : cet événement a pour effet de renverser la situation en faveur des bolcheviks, qui relèvent la tête et gagnent un prestige, une audience et une confiance parmi les masses jusque-là inégalées.
Octobre : la prise du pouvoir
Le 31 août, le soviet de Petrograd vote une résolution réclamant tout le pouvoir aux soviets et, tout comme 126 soviets de province, accordent la majorité aux bolcheviks. Les uns après les autres, les soviets des grandes villes alignent leur position sur celle du soviet de la capitale. « Avant septembre, l’avant-garde des masses était plus bolchevik que les bolcheviks. Après septembre, ce sont les masses qui sont plus bolcheviks que l’avant-garde. » (18) Lénine, quant à lui, parle de la « rapidité d’un ouragan incroyable » (19). Dès la mi-septembre, il martèle : « L’Histoire ne nous pardonnera pas si nous ne prenons pas le pouvoir dès maintenant. » (20) L’irrésistible ascension des bolcheviks culmine finalement dans l’insurrection et la prise du Palais d’Hiver, qui ont lieu dans la nuit du 24 et 25 octobre 1917 sous la direction de Trotsky, et ce presque sans effusion de sang. Le 26 du même mois, le deuxième congrès pan-russe des soviets ratifie le premier État ouvrier de l’histoire.
Le rôle du Parti Bolchévik
La Révolution d’octobre n’aurait jamais pu aboutir sans l’existence d’un parti capable, comme le disait Lénine, de « concentrer toutes les gouttelettes et les ruisseaux de l’effervescence populaire qui suintent à travers la vie russe en un seul torrent gigantesque. » (21). La progression numérique du Parti Bolchévik est saisissante : ne comptant guère plus de 3.000 membres en février 1917, le parti, qu’on qualifiait encore en juillet d’une « insignifiante poignée de démagogues », verra en quelques mois ses effectifs exploser, atteignant en octobre le quart de millions d’adhérents. L’éducation politique des masses s’effectue à travers leur propre expérience ; dans le feu de l’action d’une période révolutionnaire, la conscience des masses évolue à la vitesse grand V. Le Parti Bolchévik a, mieux que les autres, su exprimer les aspirations profondes de la population laborieuse de Russie, et formuler les moyens concrets pour les mettre en œuvre. Un monarchiste moscovite de l’époque reconnaissait sobrement : « Les bolcheviks sont le vrai symbole du peuple. » (22). La construction d’un parti à même de grouper et d’organiser les masses ouvrières, et de les amener avec audace jusqu’à la prise effective du pouvoir, tel fut et reste le mérite et l’apport essentiel du bolchévisme dans l’histoire.
Bibliographie :
1) Rosa Luxembourg, Grève de masse, parti et syndicat (1906).
2) Léon Trotsky, Le conseil des députés ouvriers et la révolution (1906).
3) Jean-Jacques Marie, Lénine 1870-1924 (2004).
4) Léon Trotsky, Bolchévisme contre stalinisme (1939).
5) Ibid.
6) Ibid.
7) Rosa Luxembourg, La crise de la social-démocratie (1915).
8) Marcel Liebman, Le léninisme sous Lénine, Tome 1: La conquête du pouvoir (1973).
9) Ibid.
10) Léon Trotsky, Histoire de la Révolution russe, Tome 2: Octobre (1932).
11) Jean-Jacques Marie, Op.cit.
12) Léon Trotsky, Histoire de la Révolution russe, Tome 1: Février (1932).
13) Pierre Broué, Le Parti Bolchévique : Histoire du P.C. de l’U.R.S.S (1962).
14) Ibid.
15) Ibid.
16) Jean-Jacques Marie, Op.cit.
17) Jean-Jacques Marie, Op.cit.
18) Marc Ferro, La Révolution russe (1976).
19) Pierre Broué, Op.cit.
20) Ibid.
21) Lénine, Que faire ? (1902).
22) Jean-Jacques Marie, Op.cit.